« The Work », Susanne Kennedy et Markus Selg en boucle au Festival d’Automne
par Amélie Blaustein-Niddam18.12.2025

Une nouvelle fois, le plus grand duo de l’abstraction s’empare de nos perceptions. Cet univers cringe et glitché aux couleurs si criardes qu’elles en deviennent belles est la signature de Susanne Kennedy et Markus Selg. Cette fois-ci, sur la scène de l’Odéon, nous devenons les personnages, façon Second Life d’un jeu de rôle de plus en plus étrange.
« The Work is about my Work »
Susanne Kennedy et Markus Selg sont devenus ces trois dernières années les artistes les plus en vue de la scène internationale. Les Parisien·nes ont pu entrer dans leur temple ancien du futur lors de leur version d’Einstein on the Beach et découvrir les voix en post-prod qu’il et elle collent sur le visage de leurs interprètes dans Angela, a Strange Loop (programmé aussi à Avignon). Également, on a pu voir le travail de Kennedy appliqué à l’opéra, pour le Parsifal très futuriste présenté à Gand cette saison. Nous voici de retour à l’Odéon, cette fois-ci pour le meilleur des formes contemporaines. On l’a beaucoup écrit cette année : les artistes européens questionnent leur rapport à la représentation. Tout comme l’a fait Gosselin avec son Musée Duras, il s’agit de changer de point de vue et de perspective, dans un alignement de regards égalitaires et horizontaux.
Pour The Work, l’entrée du public se fait de façon classique. Nous voici assis·e·s devant un décor, pour le moment très étroit. Un gros rideau, sur lequel est projeté un mur en béton, clôt l’espace ; il y a des signalétiques de travaux qui clignotent à cour et à jardin, une tente ronde ponctuée d’une entrée de sanctuaire et, au centre, une table basse et deux chaises. Sur les notes de « A Girl Like You » d’Edwyn Collins, un animateur télé, le visage entouré d’un crâne de cinéma, en jean et en veste jaune en latex, demande des applaudissements. On les lui offre, ce qui permet à Xenia de faire son entrée, elle aussi le visage complètement oblitéré par cet accessoire qui ne laisse libres que la bouche et les yeux. L’interview commence, et l’on apprend que Xenia est une artiste qui vient ici présenter son dernier projet : The Work, une œuvre immersive et participative où les volontaires vont devenir les personnages de sa vie. Puis, le rideau se lève…
« It’s ok darling »
L’effet waouh qu’El Conde de Torrefiel questionnait dans La luz de un lago, également à l’Odéon, est ici super assumé. On entre dans le décor, comprenant à l’instant T que nous sommes partie prenante de cette expérience qui ne choisit pas entre les formes. Nous sommes dans un geste d’art vivant pur.
Pour vous expliquer : tout est un tout, et tout compte. L’endroit est recouvert, du sol au plafond, de motifs aussi étranges que fascinants. Le sol est une moquette qui mélange des motifs floraux, des traces de couleurs. Des vidéos, un peu partout, diffusent pour le moment uniquement un monochrome vert. Il y a une passerelle rouge en fer qui surplombe une pièce ; un salon tout blanc qui compte trois adorables vases en 3D, une chambre avec un couvre-lit presque léopard, un mouroir dans lequel on voit des animaux inventés et des monstres flous ; il y a aussi un local à poubelles fluo.
Le jeu se met en place. Désormais, les personnages sont une dizaine, tous vêtus de la même façon : faux crâne, jean, tee-shirt blanc et, pour certains, une enceinte en forme de ras de cou. Ils déambulent moins que nous ; eux se posent et commencent à interagir avec nous, et sans que l’on sache quand, le théâtre est arrivé, il s’est mis en place. Le récit arrive sans qu’on le cherche ; il nous attrape de la même façon que lorsqu’on écoute la radio en faisant autre chose : une bonne phrase nous saisit (par exemple : « Les acteurs sont les damnés des morts-vivants »). Les voix parlent dans un anglais très intelligible, tout de même traduit sur un bandeau.

« Xenia, you are looping again »
«Les acteurs sont les damnés des morts-vivants». Oui. The Work trouble la perception pour revenir aux racines du théâtre, celles de défier la mort en la rejouant sans cesse et sans conséquence. À la fin, il y a des saluts ; le plus souvent, cela veut dire qu’on peut s’en sortir. On entend : « Il faut apprendre à mourir ». Vous le comprenez, nous l’espérons, cette pièce vous laisse très libre dans votre circulation : vous pouvez rester dans un espace, traîner sur le canapé ou bien vous recueillir, saisi·e aux tripes sans l’avoir vu venir, par la vision d’une des Xenia en train d’agoniser dans un halo lumineux gris-bleu.
Tous les personnages jouent les souvenirs assez sombres de l’artiste, de Xenia. La proposition est un palimpseste méta qui brouille « les frontières entre les simulacres et la simulation ». Par touches, la question du vrai et du faux affleure. On entend aussi : « C’est censé être une œuvre fictive, non ? ». Par touches encore, Kennedy et Selg montrent un monde d’après le monde d’après où les aigles roses laissent la place à des territoires en feu. Le fait que les visages soient masqués, les voix postproduites et les bouches en playback laissent au regard la partition sensible ; le reste d’humanité. Le duo berlinois nous balade par le bout du nez ; il nous possède complètement : on se perd dans ce lieu, et l’on s’y retrouve dans ce geste à la maîtrise très déroutante. Une nouvelle fois, le post-réalisme de Kennedy et Selg nous embarque loin de nos codes.
À voir jusqu’au 21 décembre à l’Odéon-Berthier, dans le cadre du festival d’Automne.
Informations, horaires et réservations
Visuels : ©Moritz Haase
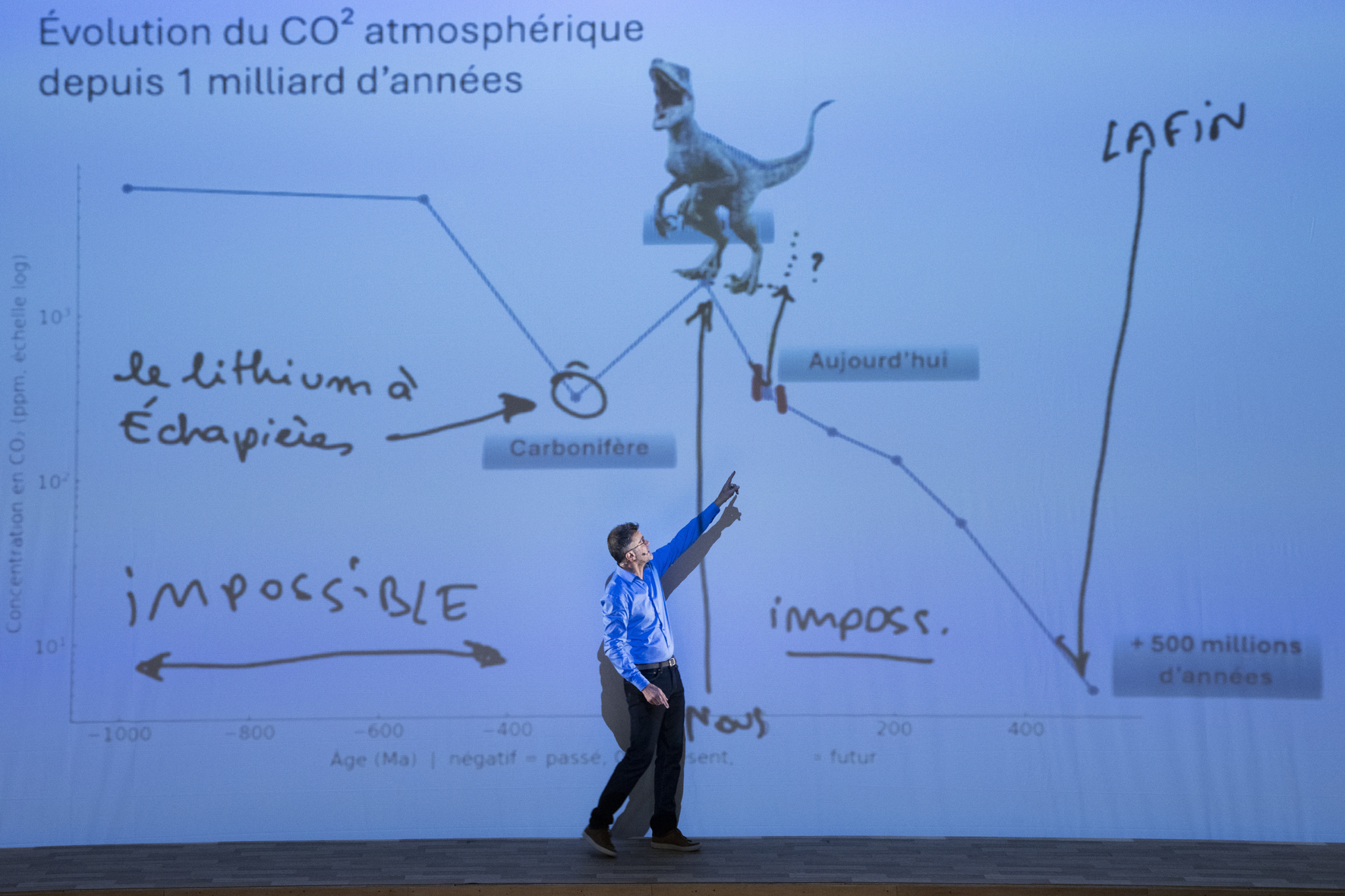
« Comment Nicole a tout pété » au Rond Point : spectacle d’intérêt public!
par Anne Verdaguer02.02.2026
→ Lire l’article

« Bestioles » : Séphora Pondi sonde l’adolescence au Studio de la Comédie Française
par Yaël Hirsch02.02.2026
→ Lire l’article






