L’année dernière si tout va bien «Deux-mille vingt-trois» de Maguy Marin
par Antoine Couder15.03.2024

La nouvelle création de Maguy Marin est à l’image de son introduction : un grand mur de briques éclairées de lumière et de noms-logos qui s’écroulent en quelques minutes et constitueront le décor en morceaux du spectacle. Et c’est à peu près tout. Inutile de dire que l’on n’a pas du tout aimé ce spectacle et ce qui se tisse depuis quelques années, « Y aller voir de plus près » présenté au festival d’Avignon en 2021 qui posait les bases de ce qui est devenu un théâtre politique plutôt qu’un théâtre dansé. Cherchons l’erreur …
«Deux-mille vingt-trois» propose le dispositif suivant : à droite un énorme écran de télévision où se succèdent des visages célèbres et des logos. À gauche des comédiens qui eux-aussi se succèdent pour nous raconter combien toutes cette clique de riches, entrepreneurs, politiques et divinités des médias constitue un tout méprisable parce que stupide et consanguin. Il y a un décor et l’envers du décor, cette lumière du spectacle de la consommation effrénée, orchestrée par ce grand capital dont on découvre ici le visage-logo. Derrière, il y a l’obscurité-poubelle où se tiennent toute en colère digne les victimes de ce génocide mondial et numérique. Des sans-visages réduits à « faire des blagues » sur ces affreux et à taper sur des casseroles et vieux métaux, pour bien nous faire comprendre qu’en dépit de leur dénuement, il reste des âmes vives.
Partir du flou, si possible
Or, ce qui frappe d’emblée en 2023/ « Deux-mille vingt-trois », c’est ce contresens journalistique à propos des écrans ; comme si nous en étions encore à la culture télé, verticale et à sens unique alors qu’il n’est pas besoin de faire un spectacle pour constater que riches et pauvres sont avant tout collés à leur téléphone portable, leurs réseaux sociaux et leur messagerie instantanée, que tous entretiennent de concert le même flou et que c’est peut-être de ce flou dont il faudrait partir. Ensuite, et c’est ce qui va nous mettre vraiment mal à l’aise, c’est cet emploi d’astuces narratives et de montages qui se focalisent sur l’individualité de tel ou tel (ici une députée, Frédéric Beigbeder, Stéphane Bern et Léa Salamé) pour la réduire à la saillie ironique, au gag de bistrot, un « couper-coller » façon stand-up dans le but est de faire rire gras en flattant nos bas-instinct de harceleurs en ligne (un rire= un like). C’est un point majeur dont il faudrait quand même commencer à discuter un jour : cette autorisation que l’on se donne à reprendre les armes et les méthodes de l’ennemi (le capital,le fascisme) sous le prétexte que l’on serait du côté des victimes, est-elle vraiment soutenable, d’un point de vue éthique et scénographique ? On en a déjà assez de voir les appareils narratifs ordinaires réduire les gens à leur statut de victime, faut-il vraiment donner la parole à ceux qui se rêvent en « représentants légitimes » de toute la violence du monde ?
Radical, vraiment ?
On s’interroge sur ces passions tristes brandies comme des étendards… Pourtant cette mise en équation des visages et des logos, la possibilité de traverser les apparences, de forcer l’icône à se découvrir, à justement interroger toutes ces fausses images qui la traversent est vraiment une belle idée. Mais tout ici relève d’un montage en surface, rhétorique pouet pouet entre indignation et déluge de citations (des flots de data pêchés sur Wikipédia qui nuisent à l’idée même de source). C’est que la chorégraphe a demandé à ses interprètes « très habiles pour se balader sur les réseaux sociaux » d’écrire les textes à partir de l’actualité. Or c’est justement sur ce point précis que le bât blesse. Dans le jeu de dupes de cette « étroite collaboration », il n’y a aucune mise en abîme mais le simple autodafé des logos, une messe anticapitaliste diffusée à grand renfort de décibels. Le grand feu réduit au rire gras. Mais qu’en est-il du mouvement derrière l’autoportrait perpétuellement instagrammé ? Juste des mots, des incantations pleines d’ironie haineuse. Au fond, c’est un peu le programme de Cnews projeté à l’envers, comme si nous nous retrouvions en réunion de copropriété politique, comme s’il fallait tout expliquer au spectateur qui ne serait pas « un peu au courant » des détails techniques, des liens entre commerce et média, surveillance et Intelligence artificielle, Histoire et colonisation. Comme si ce spectateur vivait sur une autre planète, comme les super-riches qui trouvent tout cela super-normal.
Pas de danse
On peut être touché par la sincérité de ce spectacle mais sa radicalité mérite d’être examiné de près. Il y a là comme une contradiction systémique et, en fait, populiste dans ces manières de dérouler un grand récit. Certes, « Les images disent ce qu’on veut leur faire dire » comme l’explique Maguy Marin pour le dénoncer. Mais toute la mécanique de sa scénographie tient précisément dans ce « faire dire » et c’est là l’ambiguïté. Le plus désolant ce n’est peut-être pas d’avoir oublié de relire « Dans la jungle des villes » (Bertold Brecht, 1922) -le modèle de référence d’un genre qui serait à la fois humain et radical- mais c’est plutôt cette absence manifeste de poésie proposée en guise de dénonciation du désespoir des peuples. Pas de mots qui portent et, surtout, pas de danse. Maguy Marin nous dit qu’elle pense au sol, à l’air, à la pluie, à la danse tribale. Sauf que l’on ne voit rien de tout cela. Et c’est sans doute le plus triste de toute cette affaire.
Photo :© Blandine Soulage
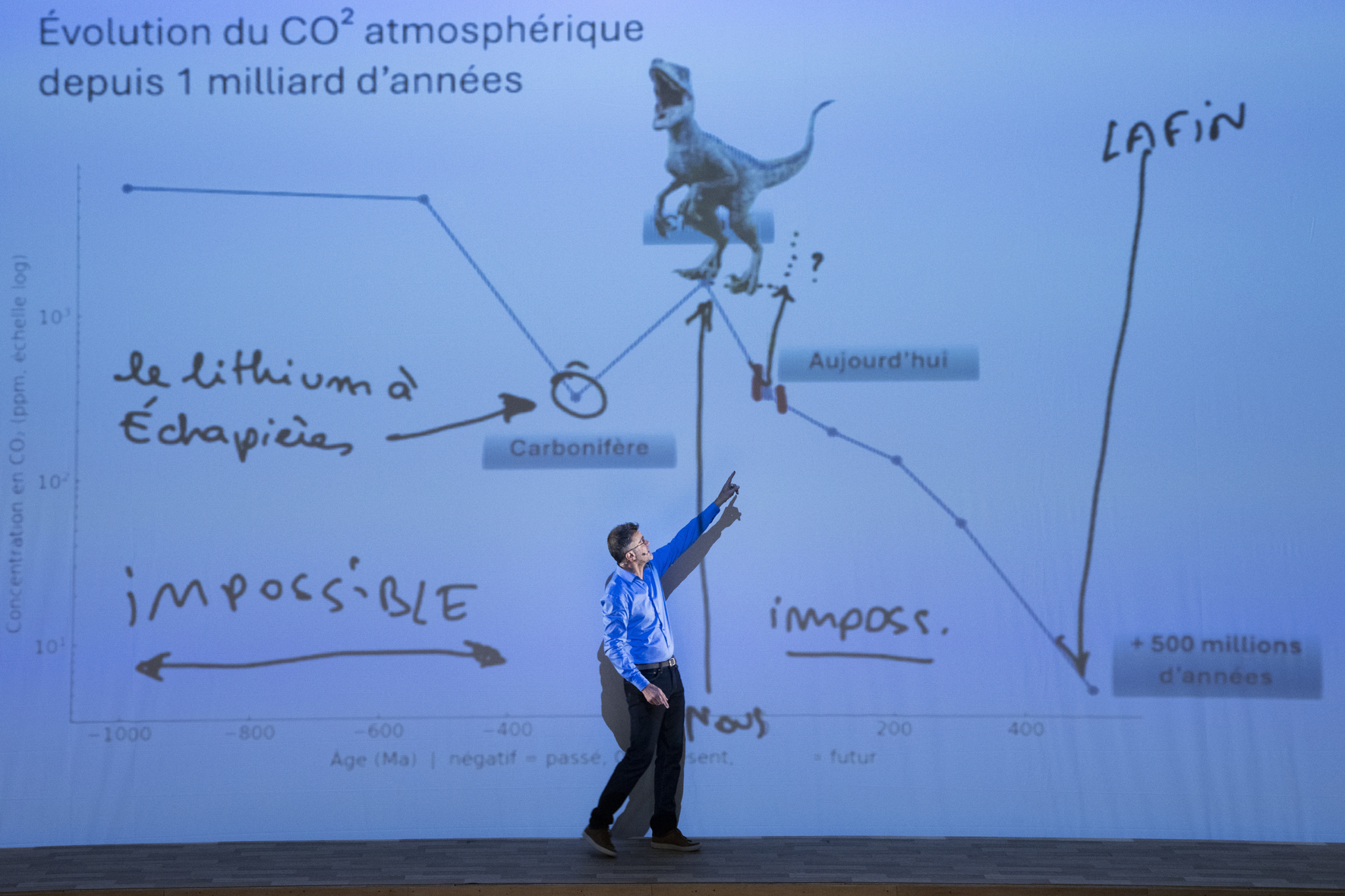
« Comment Nicole a tout pété » au Rond Point : spectacle d’intérêt public!
par Anne Verdaguer02.02.2026
→ Lire l’article

« Bestioles » : Séphora Pondi sonde l’adolescence au Studio de la Comédie Française
par Yaël Hirsch02.02.2026
→ Lire l’article






