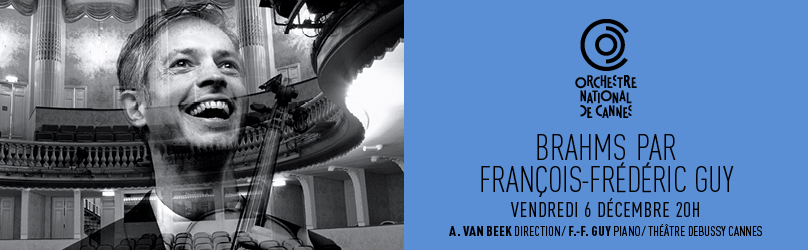À Lausanne, la naissance d’une idole : un « Guillaume Tell » de Rossini magistral révélé par le livre d’images de Bruno Ravella
par Philippe Manoli18.10.2024

Pour l’ouverture de la saison, et les débuts du mandat de Claude Cortese à l’Opéra de Lausanne, le Guillaume Tell de Rossini a été magnifiquement servi. L’alliage de la direction d’orchestre flamboyante de Francesco Lanzillotta et de la mise en scène subtile de Bruno Ravella permet à une distribution globalement excellente de mettre en valeur le dernier chef d’œuvre du maître pesarais comme il l’a rarement été. Un vivifiant retour aux sources en quelque sorte.
Home, sweet home
Claude Cortese voulait frapper fort pour ouvrir son mandant sur les bords du Léman, et donner à voir une production qui fera date. Pour cela, il a choisi une œuvre à la fois emblématique de la culture nationale et mal connue des Lausannois. Car c’est un curieux paradoxe que de constater que le chef-d’œuvre ultime de Rossini, créé en français à Paris en 1829, n’avait jamais été représenté dans une ville qui accueille en son sein non seulement une statue célèbre du héros national helvète (une œuvre d’Antonin Mercié, sur l’esplanade de Montbenon), à quelques centaines de mètres de l’opéra, mais aussi des peintures murales à la gloire de Guillaume Tell, signées Ernest Biéler, aujourd’hui rapatriées à l’intérieur du Palais de Justice pour les préserver. À cela plusieurs raisons : l’œuvre, de format gigantesque (plus de quatre heures trente de musique dans sa version intégrale), réclame des forces musicales et chorales considérables et une distribution importante (onze rôles), ce qui ne correspond pas idéalement à la taille modeste de la bonbonnière voisine du quai d’Ouchy.
Mais si monter une telle œuvre est un défi pour une maison d’opéra de taille moyenne, les défis sont faits pour être relevés, et c’est justement ce que nous a expliqué Bruno Ravella, le metteur en scène choisi par Claude Cortese pour cette production, dans la récente interview qu’il nous a accordée. Quelques coupures bien réfléchies pour épargner au spectateur une trop longue représentation et pour éviter de diluer l’action dans le divertissement des ballets, un chef d’orchestre di primo cartello pour optimiser l’utilisation des forces chorales et orchestrales de la maison, suffisantes dans le cadre de cette salle spécifique, et une mise en scène sobre et esthétique, mais aussi d’une réelle profondeur de réflexion, voilà la recette pour une réussite indéniable, que souligne l’ovation debout qui a salué les artistes à la fin de chaque représentation, celle-ci ne pouvant être liée au seul impact de la figure mythique de Tell sur un public d’avance conquis.
Prima la musica ?
Guillaume Tell est un œuvre charnière, qui se situe aux prémices du Grand Opéra à la française. Installé à Paris en 1824, couvert d’honneurs, Rossini y abandonne le primat de la voix soliste virtuose qu’il avait érigé en système jusqu’alors, pour s’adapter au style français plus déclamatoire issu de la tragédie lyrique de Lully et de Gluck. Il n’y a qu’à voir le volume que représentent les récitatifs et déclamations dans l’œuvre par rapport aux parties chantées, pour ce qui est des solistes, pour s’en convaincre, sans parler du chœur, devenu prépondérant, un personnage à part entière. Le mot finit par primer sur le son, ce qui pour Rossini est une véritable révolution. Pour preuve, une phrase toute simple comme « Je suis Guillaume Tell enfin ! » déclamée par le héros au troisième acte, juste avant l’épreuve de la pomme, acquiert une résonance immense, presque autant que la seule aria dévolue au rôle, qui suit ce récitatif. On s’éloigne ici beaucoup de la tradition italienne du chant orné.
Pourtant, la présence en fosse du chef romain Francesco Lanzillotta, à la tête de l’Orchestre de chambre de Lausanne, nous a permis de comprendre que ce chef-d’œuvre de la maturité ne prend sa réelle dimension que quand il est dirigé avec une vivacité et une finesse de trait propres aux œuvres de jeunesse de Rossini, qui lui sont presque toujours refusées dans cet opus. Car une direction qui tire trop l’œuvre vers le Grand Opéra a tendance à perdre ces deux éléments, à trop vouloir faire surgir le monumental, à force de couleurs trop saturées et de traits épais.
À la fois brillant concertatore et formidable coloriste, le maestro Lanzillotta a également montré combien les ensembles sont fondamentaux dans cet ouvrage, et comment leur imbrication dans la trame musicale et dramatique permet de faire éclore les apothéoses de fins d’actes ; et il a su jouer des fines couleurs d’un orchestre parfaitement en phase avec cette musique (un vrai camaïeu de verts du plus tendre au plus acidulé) pour faire participer tous les pupitres à la vaste palette des nuances délicates dont Rossini use pour établir des climats bucoliques et champêtres au premier acte, confinant à un hymne à la nature helvète.
Dès l’ouverture, célébrissime, le violoncelle solo est parfaitement mis en valeur, profond de timbre et jouant habilement de son vibrato expressif, les trilles de la flûte traversière et cor anglais se répondent avec tendresse, l’étagement des plans sonores est parfait, les piccolos acidulés, et une certaine prépondérance des vents sur les cordes se fait sentir dans l’Orchestre de Chambre de Lausanne, rappelant les Rossini de jeunesse, ce qui n’est pas un mal. Le galop est spectaculaire, d’une tension remarquable dans les percussions comme dans ses accelerandi, et le ton est ainsi donné. Surtout, le chef romain va être tout du long de l’ouvrage un narrateur extrêmement engagé, accompagnant les voix comme un personnage (les bois en réponse à la soprano au début du récitatif avant « Sombres forêts »), soulignant ici un contrechant, là une couleur expressive de la voix chantée, explicitant une émotion, relançant systématiquement le discours, les cordes volontiers tranchantes quand il le faut, le tempo à l’unisson du rythme cardiaque dans l’approche du duo amoureux « Doux aveu » au second acte, avant que la clarinette peigne un véritable clair de lune pour les amants. Les pizzicati aux cordes scandent l’action, l’orchestre infuse une tension dramatique intense au trio patriotique (les vents furibonds, les cordes faisant office de fouet) qui finit comme une danse folle. Quelle délicatesse dans le violoncelle solo qui accompagne l’air de Tell ! Quelle pulsation soutenue dans le trio féminin à l’acte quatre, où les instruments encore répondent aux voix ! Les volutes aux cordes et aux vents expriment à plein la fureur des éléments dans l’orage, les arpèges des vents annoncent ensuite la sérénité retrouvée au dernier tableau, lors de l’apothéose de Tell. Rarement un orchestre aura insufflé autant de vie à cette œuvre depuis des lustres. Le seul prix à payer aura été un volume parfois excessif de l’orchestre qui, sans réellement couvrir les chanteurs, les a poussés dans leurs retranchements, du fait de la résonance de la salle.
Au commencement était le verbe
Si l’orchestre a pris une grande part dans la réussite de la production, l’importance accordée aux mots par le chœur et certains chanteurs a également été cruciale. Le chœur de l’Opéra de Lausanne, préparé magistralement par Alessandro Zuppardo, ne mérite que des éloges. Sa diction parfaite donnant sa juste couleur à chaque syllabe, sa cohésion, l’éventail considérable de ses nuances en ont fait un acteur essentiel du drame, malgré son effectif réduit. L’exemplaire fusion des pupitres de voix lui permet d’obtenir un fondu parfait notamment au moment des danses du premier acte (« Hyménée, Ta journée Fortunée Luit pour nous. ») Il sait se faire quasi transparent, ultra léger (« De la justice voici l’heure ! »). À l’opposé, ce chœur sait parfaitement jouer des balancements de la syncope dans « Voi-ci la nuit » au début de l’acte deux, et il établit un jeu d’échos parfait avec Tell et Arnold dans les échanges des chœurs de Schwitz, d’Uri et d’Unterwald à la fin du même acte (« Parle, et les fiers accents, Jaillissant de ton âme, Soudain en traits de flamme Embraseront nos sens ! »).

In excelsis
Cette parfaite diction qui fait couler la phrase avec un naturel idéal, un soliste la partage avec le chœur et elle lui permet d’obtenir des colorations infinies dans son chant : c’est le ténor Julien Dran, qui faisait ses débuts dans le rôle d’Arnold. Il partage avec de très rares ténors aujourd’hui (Pene Pati, Jean-François Borras, Benjamin Bernheim) la capacité à chanter piano en infusant toutes les intentions dramatiques du personnage dans un chant détendu, comme un peintre à sa palette. Et son ambition est ici de délivrer le rôle des limites que les acrobaties techniques demandées par Rossini lui ont assignées : l’extrême difficulté de l’air « Asile héréditaire » et de la strette qui suit, « Amis, amis, secondez ma vengeance », l’a réduit chez nombre de chanteurs à un quasi-numéro de cirque. Or Arnold est un être proche du Rodrigue de Corneille, déchiré entre, d’une part, son devoir d’orphelin et de patriote et, d’autre part, son amour pour une princesse étrangère liée aux envahisseurs. Fougueux, certes, mais ô combien lyrique, il doit chanter deux duos avec elle, où son âme se met à nu. Nous n’avions tout simplement jamais été émus par un Arnold avant d’entendre Julien Dran dans le rôle. Certes, son profil vocal est plus léger que celui du créateur Adolphe Nourrit, mais depuis le retrait de Bryan Hymel, plus aucun ténor ne peut se mesurer à cet idéal. Et ce que nous perdons en muscles, nous le gagnons en finesse et en émotion, dans la lignée d’un Gedda, à ceci près le ténor bordelais y ajoute les charmes d’un timbre de toute beauté.

Le délié de son chant fait merveille dès sa première intervention (« Ô Mathilde! je t’aime, Je t’aime, et je trahis Mon devoir et l’honneur, mon père et mon pays ! »), et le duo avec Tell atteint immédiatement des sommets grâce à lui : « Mathilde, idole de mon âme » allie l’élan irrépressible de l’amour à l’éclat d’un timbre tout d’or et de lumière. Son legato et le poids des mots qu’il insuffle à son chant donnent un relief extraordinaire à certains récitatifs comme « Ma présence pour vous est peut-être un outrage », avant le duo du second acte, où certaines phrases le propulsent en apesanteur (« Je ne puis étouffer ma flamme, Dût-elle nous perdre tous deux ! »). La transparence de « Doux aveu », puis la parfaite fusion de sa voix avec celle de la soprano le conduit alors à délivrer un aigu proprement extatique (« De plaisir enivre mon cœur ») suivi d’une véritable dentelle de diction ciselée sur la nuance piano. Quand Tell lui annonce la mort de son père, l’arc lumineux de « Ô ciel, Ô ciel, Je ne te verrai plus » étreint le spectateur. Plus que dans la strette hérissée d’uts, qu’il affronte avec une vaillance stupéfiante, c’est dans l’air du quatrième acte que le ténor donne toute sa mesure, pour ce qui est le sommet de la représentation. L’émotion contenue de « Dans cette enceinte quel silence ! », le poignant diminuendo sur « mon père est mort », l’affliction de « Je n’y rentrerai pas » plantent une première banderille dans le cœur du public lors du récitatif. Sa longueur de souffle permet au ténor de tenir sur une seule respiration tant « Asile héréditaire Où mes yeux s’ouvrirent au jour » que « J’appelle en vain, douleur amère ! J’appelle, il n’entend plus ma voix ! », puis c’est un festival de voix mixte sur le souffle, jusqu’à une reprise double piano de l’air, débouchant sur deux vocalises, l’une d’une finesse de dentelle, qui achèvent de subjuguer le public, lequel le récompense par une longue ovation spontanée. Quel moment !
Et le fils Tell dépasse le père
La révélation de la distribution s’appelle Elisabeth Boudreault. La soprano canadienne réussit l’exploit de faire de Jemmy un véritable premier rôle, grâce à un instrument puissant, au timbre clair et charnu, à la projection formidable, sans jamais que derrière le métal argenté du timbre ne perce la moindre stridence. Elle fait preuve d’un foyer vocal particulièrement lumineux au cœur de l’acte trois, devant la brutalité de Gessler, où « Ah, que ton âme se rassure » émeut et éblouit, avant une vocalise de toute beauté et un aigu qui triomphe à l’avance de l’épreuve imminente. Elle prend part avec beaucoup de classe au trio féminin du quatrième acte, avant un final où elle sculpte un récitatif de toute beauté (« Rien n’a pu le soustraire au trait de la vengeance »). Par ailleurs sa coiffure et son costume la rendent méconnaissable, de sorte qu’elle incarne avec une confondante aisance l’enfant touchant, otage du gouverneur autrichien. Nous avons hâte de l’entendre dans des rôles plus étoffés.

La mezzo-soprano Géraldine Chauvet réussit à donner une vraie épaisseur au personnage d’Hedwige. Son port de tête, son allure dans sa belle robe de taffetas bleu clair, lui permettent d’incarner le personnage de la mère inquiète et de l’épouse du héros avec une grande classe, même quand elle ne chante pas.
Sa diction excellente, la lumière d’un timbre plutôt clair proche du soprano, son legato d’école, lui permettent de se mettre particulièrement en valeur dans le trio féminin du dernier acte où sa voix se fait douce et caressante.
D’autres seconds rôles tirent très bien leur épingle du jeu, en particulier l’impressionnant Leuthold de Marc Soffoni, dont le baryton vaillant et splendide de timbre est un vrai luxe pour cet emploi. Sahy Ratia incarne un Rudi de tradition, avec son ténor léger et délicat, qui sait prendre ensuite avec les chœurs les accents de la révolte.
Un ton en dessous
La basse Italienne Luigi De Donato, spécialiste du répertoire baroque, incarne un Gessler de bonne facture – sans préjuger de ce qu’une basse francophone de qualité y aurait produit (et il y en a aujourd’hui). Il assume bien l’ambitus du rôle (joli grave dans « Il échappe à ma haine »), même si l’aigu est parfois un rien tendu, et compose un gouverneur sadique, cruel comme attendu, mais non sans subtilité, comme les meilleurs Scarpia : il donne leur juste poids aux mots (« Daigne à votre faiblesse accord »).
La soprano ukrainienne Olga Kulchynska incarne une princesse Mathilde qui tient son rang, même si elle non plus n’est pas le soprano spinto d’agilita réclamé par la partition. Mais elle dispose d’une technique vocale à toute épreuve, issue de l’école russe, d’un aigu assez puissant, d’un grave relativement consistant et d’un timbre très lumineux, même si le métal dont il est poli laisse parfois apparaître quelques aspérités. Son français, bien travaillé, est correct (et c’est d’autant moins gênant que, comme Luigi De Donato, seul autre non francophone de la distribution, elle incarne un ressortissant étranger dont la pointe d’accent est de ce fait bien en situation). Son phrasé, son souffle, sa technique impressionnante (vocalises, messe di voce) lui permettent de donner vie à un personnage d’une beauté réelle, mais un peu froide. L’émotion n’affleure que légèrement dans « Sombres forêts », car la science du mot ici achoppe. Le premier duo avec Arnold la montre à son meilleur, bien accordée au lyrisme étreignant de Julien Dran, « Ah! Ne perdez pas l’espérance ; Tout vous élève à mes regards » permet à leurs timbres de se fondre avec grâce. Le second duo « Pour notre amour, plus d’espérance » la voit plus à court d’effusion, un peu lisse, malgré l’aisance remarquable de ses vocalises.
Le rôle-titre échoit à Jean-Sébastien Bou. L’acteur n’appelle pas de reproches, il porte beau, peut-être même un peu trop pour un personnage aussi terrien que Tell, mais il sait incarner avec conviction les tourments et les faiblesses du héros helvète. Vocalement, les choses sont bien plus mitigées. Sa bonne projection et sa diction excellente lui permettent de créer un personnage à la hauteur de l’enjeu. Mais son baryton lyrique est trop léger pour le rôle. Ici on n’échappe pas aux classifications : s’il a parfois été chanté par des basses comme Van Dam ou Pertusi, c’est parce que son grave est très fourni. Tell est un rôle faisant partie des « barytons d’Opéra », où se sont illustrés avant-hier Jean Borthayre, hier Philippe Rouillon ou Alain Fondary, aujourd’hui Alexandre Duhamel. Bou ne dispose pas du grave requis, la faiblesse de sa projection dans ce registre le rend bien trop discret dans nombre d’ensembles, et s’il tente souvent de compenser cela en projetant avec force le haut medium (« Il est des traîtres » lors du serment des trois cantons), il déséquilibre le duo du premier acte avec Arnold (« Où vas-tu ? » »), et même son grand air « Sois immobile », très noblement phrasé, grâce à un très beau legato, n’échappe pas à cette difficulté, d’autant qu’auparavant il brise la superbe phrase « Je suis Guillaume Tell enfin » en la coupant entre « Tell » et « enfin ». Il représente donc une réelle déception, comme Frédéric Caton, dont le manque de projection et la difficulté à aborder l’aigu entachent le rôle Walter Fürst, déséquilibrant le trio patriotique du troisième acte, même si son père Melchtal un peu transparent est légèrement plus en situation. Totalement fuori di posto est Jean Miannay en Rodolphe : son ténor peu consistant est à mille lieues de l’éclat et de la puissance nécessaires pour incarner Rodolphe, le violent officier autrichien, dont il fait un pantin falot.
Le livre de la loi
Claude Cortese a confié à Bruno Ravella le soin de mettre en scène cette œuvre qui fait un peu peur à tous. Celui-ci affirme dans sa note d’intention : « Avec Alex [Eales, le scénographe, NDLR ] et la costumière Sussie Juhlin-Wallen, nous voulons recréer l’atmosphère des peintures de Hodler. Chaque acte commence par une image en deux dimensions qui prend vie comme si les personnages sortaient d’un livre d’histoire tel que celui dans lequel les enfants découvrent la légende de Guillaume Tell. »
Si cette intention manifeste a quelque peu échappé à certains spectateurs, elle est plus subtile qu’il n’y paraît. En effet, au premier acte, « nous soulignons la nature romantique des fêtes et des danses dans une « Arcadie » suisse qui tente d’exister même sous l’occupation. » Les couleurs pastel des robes des chœurs féminins rappellent ainsi les personnages de Holder (quand les Autrichiens, en costume et béret bordeaux, portent des chausses médiévales bouffantes correspondant à l’archaïsme de leur fonction d’occupants), la grande toile peinte du fond de scène représente une version rosée du Lac de Thoune aux reflets symétriques (1909) qui sera réutilisé au quatrième acte dans une version en noir et blanc barrée d’une grande tache de sang. Ce symbolisme est assez clair, et permet de situer visuellement les phases de l’action, même si peut-être il avait fallu plus que les trois cadres blancs qui entourent la scène pour symboliser les pages du livre d’images annoncé (notamment durant l’ouverture, jouée à rideau fermé, où une vidéo représentant Tell et sa famille aurait pu montrer plus clairement les pages qui se tournent depuis la naissance de Jemmy). Au second acte la « sombre forêt » chantée par Mathilde est impressionnante : en fond de scène à cour on aperçoit des arbres brisés et calcinés, tandis qu’à jardin une toile peinte de frondaisons est déchirée, et percée par les flammes. Ainsi l’occupation autrichienne fait-elle une entrée brutale dans la mise en scène. Plus tard les frondaisons auront disparu pour la grande scène aboutissant au serment des trois cantons, créant un espace nocturne et angoissant. Au troisième acte, l’entrée de Gessler se fait dans un décor noir assez simple, un fauteuil noir représentant au centre un trône, entouré de deux escaliers de bois noir, et l’ensemble de l’espace est barré au fond par une sorte de trait noir stylisé qui pourrait bien représenter une flèche plantée dans le sol helvétique, symbole de l’occupation brutale. Au quatrième acte, l’orage se déroule sur un fond de nuages rehaussé d’un brouillard de fumée artificielle, et un ponton de bois en fond de scène entoure le rocher où Tell va accoster : ici encore la magie du décor crée une atmosphère lacustre très sombre et particulièrement propice au drame.

Le chœur est mis à contribution pour représenter la chute de l’Arcadie initiale : alors que les jeunes hommes et femmes dansaient une farandole folklorique avec un entrelacs de rubans au premier acte, que des bûcherons simulaient les gestes de la cognée, au troisième acte les soldats autrichiens forcent les jeunes filles à danser et les hommes à réitérer leurs gestes de bûcherons sous la contrainte. Les Helvètes se frappent le cœur, puis à terre frappent le sol de leurs mains, dans un acte désespéré de résistance à l’occupant, qui finit, par l’intermédiaire de Rodolphe, par en abattre deux. Cette violence sur fond de musique de ballet naïve rappelle les plus noires heures de l’Occupation de l’Europe par les nazis, qui forçaient les déportés à défiler dans les camps au son d’un orchestre de prisonniers. L’arrivée extrêmement discrète de Tell au milieu des paysans martyrisés est d’un puissant effet.
La direction d’acteurs en elle-même, si elle n’est pas absolument creusée de bout en bout, recèle quelques trouvailles, particulièrement le concours de tir au premier acte où Jemmy affronte face au public des hommes du peuple qui tentent d’éteindre un gros cierge placé au centre de l’avant-scène, de même que Tell au troisième acte tire sa flèche en arrière-scène en surplomb du trône de Gessler, Jemmy de dos à l’avant-scène près du public. Si Arnold et Mathilde restent le plus souvent à distance lors de leurs duos, cela exprime peut-être les difficultés liées à leur relation quasi impossible. Les diagonales et la profondeur de scène sont utilisées à fond par Bruno Ravella au troisième acte pour la grande scène de la déploration d’Arnold aboutissant au serment des trois cantons. Tell est montré comme un personnage très humain, plutôt sensible, qui étreint facilement ses compatriotes et montre ses faiblesses devant l’adversité en ployant plus d’une fois le genou.
Fiat lux

Après la scène et l’air d’Arnold au quatrième acte, la scène de l’orage est initiée de superbe façon : Hedwige, de dos, éclairée par la lune, apparaît derrière un tulle qui finit par se lever, sa robe de taffetas bleu ciel répond aux nuances de bleu des nuages du fond de scène, et les éclairs de toutes parts annoncent l’orage, dans une ambiance d’eau-forte particulièrement suggestive. On ne peut que saluer le formidable travail de Christopher Ash, arrivé en cours de production, et qui nuance à l’infini les angles et les couleurs de ses éclairages, jouant des ombres sur les visages des personnages, et créant des ambiances de toute beauté. On n’est pas près d’oublier la scène finale, où Tell est porté en majesté par son rocher qui s’élève, le portant au rang de mythe, dans une apothéose musicale, où les tons orange du ciel dépeignent une aube du sentiment national posée sur un bleu tendre. Car, outre le fait qu’elle met un superbe point final au livre d’images de Bruno Ravella décortiquant la formation du mythe de Tell, les spectateurs lausannois, en sortant de l’opéra après cette longue représentation dominicale du 13 novembre, ont eu la stupéfaction de constater que le ciel vaudois était exactement à l’unisson de ces lumières de scène, comme si un signe divin adoubait la représentation. Quel moment magique, après tant de satisfactions musicales et théâtrales !
Visuels : © Carole Parodi