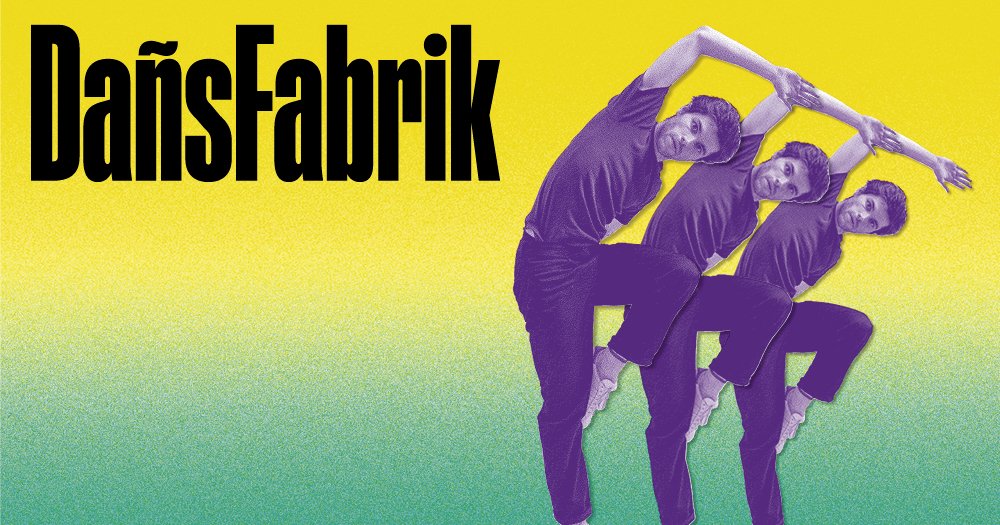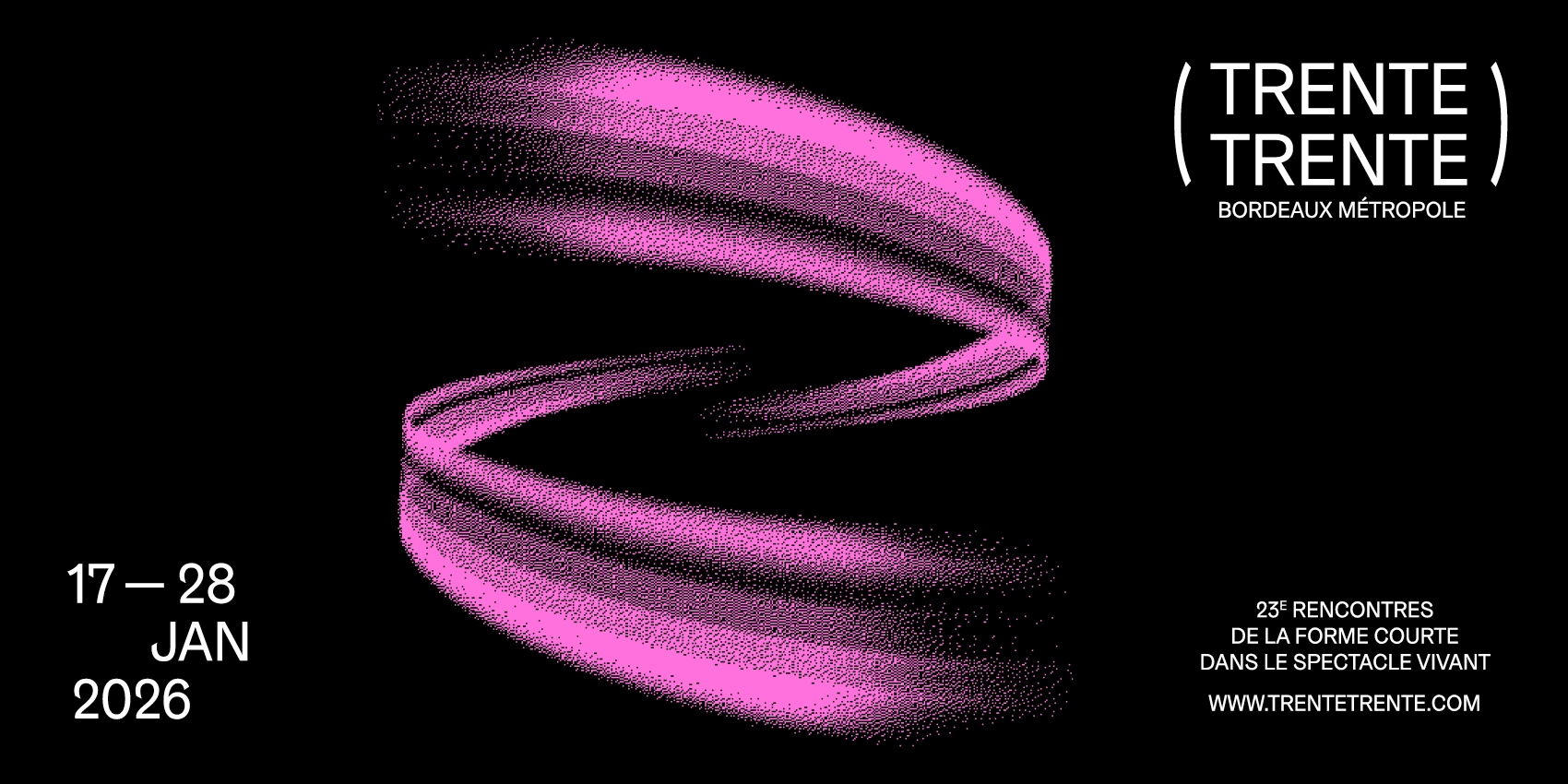« Le Malade Imaginaire » de Tigran Mekhitarian : Molière cherche sa sauce rap
par Laura Dumez22.07.2025

Présenté à Avignon au Théâtre du Chêne Noir jusqu’au 26 juillet 2025, Le Malade Imaginaire, nouvelle adaptation de Molière par le talentueux Tigran Mekhitarian, fait un carton et nous arrache un sourire, qui en attend un peu plus…
Revisiter un classique, à quoi cela tient-il… Reprendre l’histoire, rien que l’histoire, ou tout le texte. Se téléporter à l’heure actuelle ou dans un siècle. Se placer en des lieux nommés ou partir à l’aventure. Se fracasser sur un nom, ou le sublimer de sa relecture. Le défi, depuis toujours, est insurmontable, mais parfois, peut-être par miracle, cela prend. Le Malade Imaginaire de Tigran Mekhitarian est une jolie proposition qui, si elle manque encore un peu de clarté dans son audace, réjouit la salle.
Jolie lecture
Tigran Mekhitarian n’en est pas à son coup d’essai dans sa confrontation à Molière ; après Les Fourberies de Scapin, l’Avare et Dom Juan, cette pièce est sa troisième adaptation de l’illustre dramaturge. Rappelons que Le Malade Imaginaire est l’histoire d’Argan, un hypocondriaque aux prises de sa seconde épouse, Béline, qui n’est intéressée que par son héritage. Argan rêve de marier sa fille Angélique au neveu de son médecin, Thomas Diafoirus, médecin lui-même, pour toujours en avoir un sous la main. Mais Angélique voit son cœur battre pour Cléante. Soutenues par la servante Toinette, vont-elles réussir à ouvrir les yeux d’Argan quant à la vraie nature de sa femme et à le convaincre de laisser sa fille suivre le chemin de son cœur ?
Sur scène, à l’ouverture, l’officine / salle de bain fait décor avec Argan en son antre, trônant, sur ses toilettes, entouré de boites de médicaments. Il est encadré de ces molosses cagoulés dont l’allure, et les liasses de billets présentes dans ses mains, drainent l’imaginaire des cartels de drogues et du trafic de médicaments. Une batterie avec aux manettes le fameux Sébastien Gorski, aussi Cléante, et la guitare-voix de Mélanie Ferrara accompagnent le tout.
Dans la forme globale, les trois actes sont soigneusement respectés et symbolisés par des changements bien pensés de décors ; les scènes elles aussi apparaissent clairement par le ballet des personnages. Aussi, la structure classique de la forme est respectée bien que transposées à l’ère contemporaine – ordinateurs et téléphones en preuve -, et portée avec panache par les comédien•nes. On salue particulièrement Marine dans le rôle d’Angélique et Isabelle Gardien en Toinette. L’ensemble voue une fidélité à l’esprit de Molière et de cette pièce avec en prime une traduction, non sans un brin d’humour, du dédale de tristesse et de solitude dans lequel ère Argan.
PNL versus Poquelin
L’idée générale est belle et louable : donner à voir et à entendre Molière tout en tirant de ce texte de 1673 des ficelles vers notre monde actuel et en remettant à l’honneur une partie de son ADN – l’esprit initial de la pièce était d’avoir des parties dansées et chantées – en lui injectant notamment des rap (de PNL à Dinos). Et là vient le bémol, la scansion de Molière, en elle-même, n’est-elle pas un rap ? On s’attriste qu’à la déclamation cela soit peu appuyé. Il semble par ailleurs que cette écriture, bien qu’ayant plus de trois siècles, puisse être tout à fait intelligible et donner au public, si ce n’est à dévorer, à grignoter, sans qu’il eût été besoin d’y ajouter des propos d’une vulgarité certaine.
Le metteur en scène défend ces utilisations, celle du rap et de la vulgarité, comme des digressions qui rassurent les publics non aguerris à la langue classique. Ils sont, pour lui, des points d’appui sur lesquels ils peuvent se raccrocher pour s’assurer qu’ils comprennent bien le fil de l’histoire. Si l’on entend l’argument, et lui concède le point pour le rap, il semble qu’un « Je n’ai que faire » énoncer d’une certaine manière aurait été bien plus appréciable et provocateur qu’un « je m’en bats les couilles » qui crisse tant il tombe là mal en point et percute le public.
Le génie, ou une poursuite que l’on aimerait voir dans le travail d’adaptation, serait de réussir à mêler les textes des rappeureuses et celui de Molière sans que l’on puisse dissocier qui de PNL ou de Jean-Baptiste Poquelin est à l’origine de cette réplique. Qui saurait dire celui qui a écrit « Ce monde a mal et je ressens ça. Ils sont dans le noir, mais je les vois. » ? Les spectateurices seraient peut-être obligés de se parler pour démêler les fils… Ce défi, s’il est réussi, semblerait un tour de force pour montrer la magistralité de la langue et son intemporalité. Le Malade Imagianire de Tigran Mekhitarian est une jolie lecture du genre, qui conquit le public, et constitue pour celleux qui ne connaîtra pas ou peu Molière, une jolie porte d’entrée ; mais à laquelle il manque, pour aller en relecture, un petit sel d’audace supplémentaire qui saurait nous laisse bouche bée.
Visuel : © Laura Bousque