« Musée Duras », la traversée du désir de Julien Gosselin
par Amélie Blaustein-Niddam24.11.2025

Julien Gosselin présente à domicile, le démentiel Musée Duras. Un spectacle fleuve qui a déjà derrière lui une belle tournée, notamment au Printemps des Comédiens cet été, et qui confirme, une fois encore, le génie de construction de ce metteur en scène. Il met ici tout son savoir-faire au service d’une troupe très jeune, issue tout juste de la dernière promotion du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Autant dire : la crème de la crème. C’est évidemment génial, et c’est à voir jusqu’au 30 novembre.
« Je veux écrire rien d’autre que ça »
Ce Musée Duras, c’est une sélection très bien choisie de textes de Marguerite Duras. Évidemment, rien n’est présenté dans son intégralité : Gosselin a fait un énorme travail de compilation. Nous voyons, entendons et parfois lisons. Les textes choisis sont l’Homme assis dans le couloir, L’Amant, puis Savannah Bay, L’Amant, Hiroshima mon amour, La Maladie de la mort, l’Exposition de la peinture, La Douleur, L’Amante anglaise, La Musica Deuxième et, enfin, L’Homme atlantique. L’ensemble, d’une cohérence folle, permet de comprendre une chose essentielle : Duras n’a écrit que sur ça : le désir, les amours passionnés, passionnels, les amours perdus, les traces que l’amour laisse, ce que crée la rencontre parfaite d’un corps avec un autre. Son attrait pour le corps des hommes, « j’aime bien les garçons », l’a menée à réfléchir à la littérature, au théâtre, à ce que permet l’écriture. Pour le dire plus simplement : elle a écrit la possibilité, ou l’impossibilité, d’aimer.

« Au bout du voyage, c’est la caméra qui aura décidé de ce que vous avez regardé »
Onze pièces, donc, pour une durée totale de dix heures. Chaque séquence est séparée par dix minutes de pause. Avec, en son cœur, vingt minutes qui permettent de manger rapidement un sandwich, et c’est très utile dans ce genre de marathon. On connaît Gosselin, on sait qu’il adore manier la caméra : c’était déjà le cas au Théâtre de la Ville avec le magnifique Extinction. On sait qu’il arrive à manier à la fois la culture pop et le cinéma d’auteur. Et là, il s’éclate. Dans chacune des onze séquences, il fait exactement ce qu’il sait faire de mieux, sans chercher d’autres signatures. C’est du 100 % Gosselin, avec une caméra toujours sur le plateau, qui filme en direct, mais jamais de la même façon. Cela donne des close-up sur des visages qui commencent déjà à marquer l’histoire du théâtre, des travellings avant et arrière sur des couples qui suffoquent ou qui se retrouvent. La virtuosité de Julien Gosselin se manifeste aussi dans les points de vue qu’il impose au public. Onze séquences, donc, qui chacune posent leur focale ailleurs : nous sommes au milieu de l’espace, couché·es par terre, assis·es sur des coussins, sur le côté, ou, à un moment, debout. Les textes changent, les comédien·ne·s aussi, mais le fil, lui, celui de l’écriture de l’amour fou, reste toujours précis.
« Un jour sans ses yeux et elle est morte »
Le public, lui, est constamment déplacé. Ce n’est pas la première fois que Gosselin place le public au cœur du plateau, mais c’est la première fois qu’il le déplace à chaque étape. Par moments, le public se retrouve au centre, assis par terre. On peut aussi rester sur les gradins si on en a envie. On peut aussi être debout. Chacun est libre dans ce spectacle où, d’ailleurs, on a le droit de boire et de manger pendant la représentation — rappelons-le, elle dure dix heures. Dix heures qui passent avec la sensation d’avoir vu un spectacle de deux heures. Chaque partie est fulgurante dans sa construction, qui donne la part belle à des monologues permettant de rentrer dans la matière Duras et de rencontrer le talent de ces comédien·ne·s-machines qui déroulent les mots sans trembler.

« Tu étais fait à la taille de mon corps même »
Mélodie Adda, Rita Benmannana, Juliette Cahon, Alice Da Luz Gomes, Yanis Doinel, Jules Finn, Violette Grimaud, Atefa Hesari, Jeanne Louis-Calixte, Yoann Thibaut Mathias, Clara Pacini, Louis Pencréac’h, Lucile Rose, Founémoussou Sissoko et Denis Eyriey, Guillaume Bachelé, nous submergent de leur talent à être les mots de Duras. La sélection des textes permet de traverser l’époque, la France de la deuxième partie du XXe siècle, entre rebonds de la guerre, droit au divorce, lutte des femmes et faits divers sordides. C’est peut-être La Douleur qui, au bout du chemin, nous laisse le plus de traces dans le cœur. Louis Pencréac’h, l’allure longue, de profil, les mains dans les poches, dans la pénombre d’une lueur saturée, délivre l’attente de Duras de son mari, Robert Antelme, déporté. On garde aussi, au milieu d’un tourbillon de talents, la crise de nerfs de Violette Grimaud, la voix espiègle et les émotions en vrac dans Suzanne Andler, ou encore la partition chorégraphique, ancrée, d’Alice Da Luz Gomes, ou bien encore, Mélodie Adda en bourgeoise désemparée dans La Musica Deuxième.
En sortant, on a la sensation d’avoir traversé un paysage entier : celui du désir, celui de Duras, celui de Gosselin, et celui de cette troupe qui, dès maintenant, incarne le meilleur du théâtre contemporain.
Jusqu’au 30 novembre à l’Odéon, il reste de la place, sur place
Visuel : ©Simon Gosselin
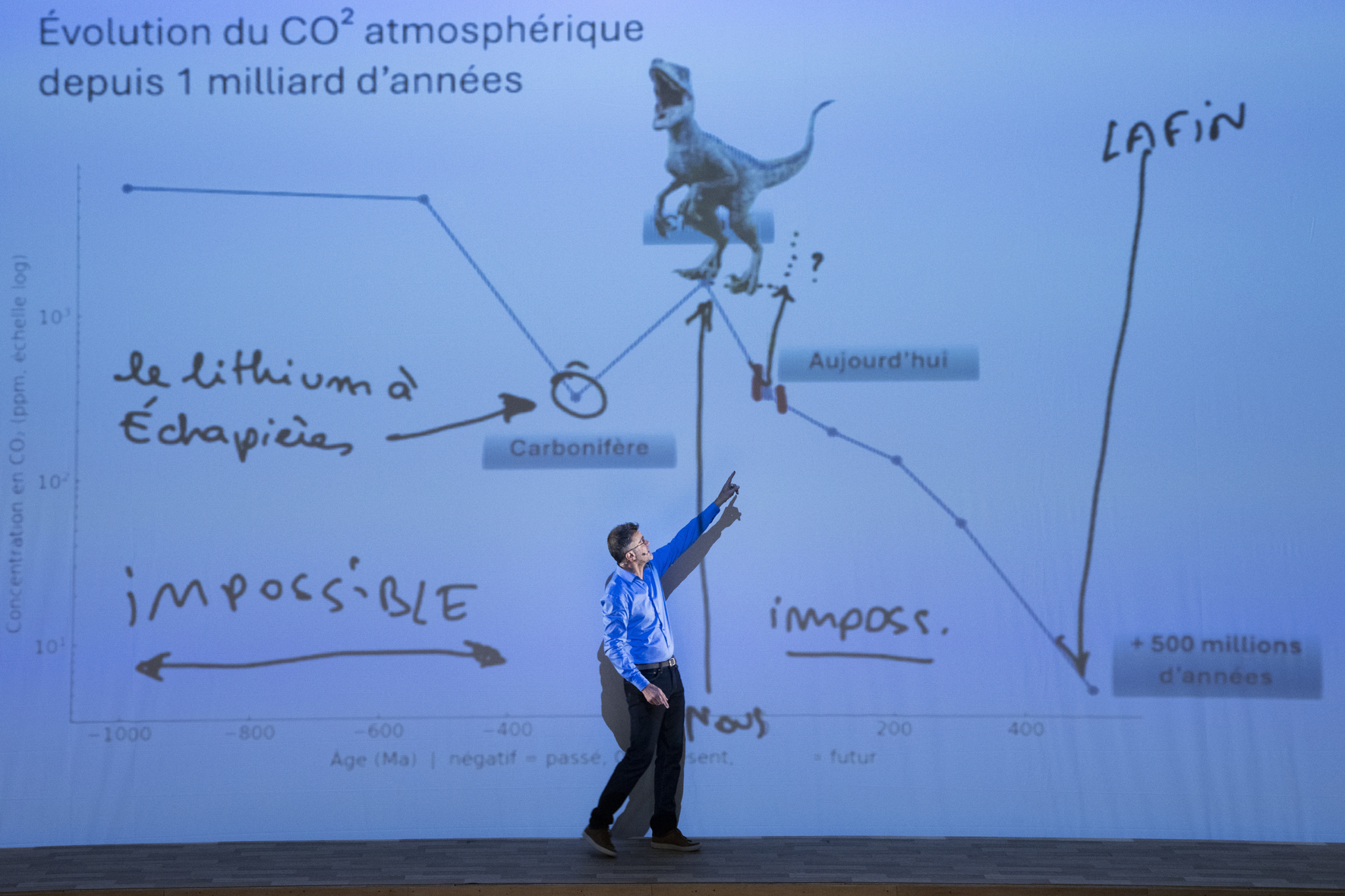
« Comment Nicole a tout pété » au Rond Point : spectacle d’intérêt public!
par Anne Verdaguer02.02.2026
→ Lire l’article

« Bestioles » : Séphora Pondi sonde l’adolescence au Studio de la Comédie Française
par Yaël Hirsch02.02.2026
→ Lire l’article






