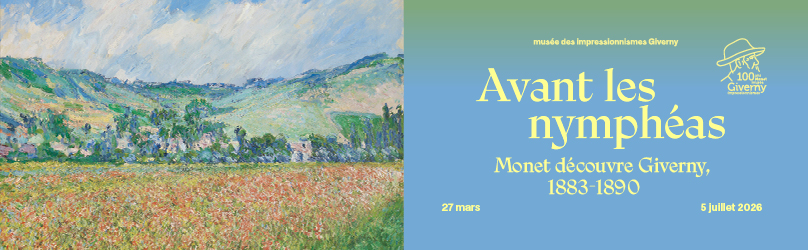« Extinction » de Julien Gosselin : l’amour et la violence
par Amélie Blaustein-Niddam01.12.2023

La fresque européenne de Julien Gosselin arrive enfin à Paris, après une tournée monstre, au Théâtre de la ville dans le cadre de la programmation Hors les murs des Amandiers et au Festival d’automne. Une plongée démente, voir gore dans les méandres du pourrissement de notre civilisation. Magistral !
« Et si nous nous mettions à penser avec les corps ? »
Comme le veut l’air du temps post-covid, le spectacle se fait avec les spectateurices. C’est donc sur scène que tout commence. Nous sommes à Rome, en 1983. Nous sommes en boite de nuit avec un open-bar, deux DJ au centre, et nous tout autour. Le public choisit d’aller où il veut, et comme dans un vrai club, on croise du monde, on se parle, on danse. Le son est techno, totalement 2023. Et puis vient l’image, caméra à la main, un homme suit plus particulièrement une grande femme blonde dans la foule devenue extrêmement compacte. La fiction arrive comme ça, comme un miracle. Et nous, les clubbers ébahis, nous scotchons sur l’écran et nous regardons cette fille chercher sa copine, elle est trop bourrée et donc très lyrique sur l’état du monde et de l’amour. Elle dit des choses sublimes du style : « Me voici mon amour, toi que j’ai tant attendu, prends-moi ». Les langues, l’allemand et le français, se mélangent. Les jeux sont très différents. Voir le naturalisme de la troupe du Volksbühne et le second degré de la compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur » est manifeste.
« Les mots deviennent des yeux pour nous fixer »
Gosselin nous ordonne de fixer justement, de regarder derrière les ombres. La pièce mélange des textes de Thomas Bernhard, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler. Il y opère des mouvements dans le temps et l’espace. Nous sommes en 1983, puis à Vienne en 1913 – juste avant – et enfin de retour à Rome, aujourd’hui. À chaque fois, l’écran, comme au cinéma, est central. Mais Gosselin, en esthète du détail, sait exactement où nous faire regarder, fixer donc. La pièce est un faux triptyque. Elle se déroule en fait en un seul grand temps de 2h30 précédé d’un prologue et succédé d’un épilogue. Le tout est une critique acerbe et la beauté époustouflante des idées nauséabondes.
Le tout dure cinq heures et prend des allures de voyages dans le temps. La séquence viennoise est une leçon de spectacle vivant. C’est éblouissant. Nous voici quelque part entre Eyes Wide Shut et L’année dernière à Marienbad. C’est chic et décadent à en crever (au premier degré !). Gosselin agrège les mots d’Arthur Schnitzler. Nous voici dans une maison aristocrate où nous suivons les ébats et les débats de Else, Albertine et Fridolin, Aurélie et Falkenir… Les mots sont tirés des récits La Nouvelle rêvée, de La Comédie des séductions et de Mademoiselle Else.
C’est beau n’est-ce pas ?
Du mouvement à l’expression en passant par le cinéma et le théâtre, Gosselin utilise tous les ressorts pour nous faire voir, entendre et comprendre les pensées pessimistes de Thomas Bernhard, Hugo von Hofmannsthal et Arthur Schnitzler. L’utilisation de la vidéo est époustouflante. En noir et blanc pour la partie viennoise, l’illusion d’être etouffé.es par le monde d’avant est totale. Elle vous dévore, vous oblige. Le niveau de jeu est merveilleux dans sa diversité de tessitures. Les allers-retours entre la scène où jouent les acteurices et le grand écran qui surplombe le plateau dont les décors sont à vue est un exercice qui nous fait réfléchir aux rebonds entre les nationalismes du siècle dernier et ceux de maintenant. Et quand les mots arrivent, purs, ils sont plus violents que toutes les scènes de drogue, de fête et d’orgie qui ont précédé. Nous entendons la racine du mal tirée des lignes d’Auslöschung de Thomas Bernhard dans un seule en scène en gros plan, où la haine se mue en puissance. Comme en 1913, comme en 1983, comme en 2023, Des temps incertains nous guettent.
Majeur !
Visuel : © Christophe Raynaud de Lage

Faire entendre les silences : rencontre avec Mathieu Touzé et Yuming Hey autour du Temps fort Philippe Besson au Théâtre 14
par Camille Zingraff13.03.2026
→ Lire l’article