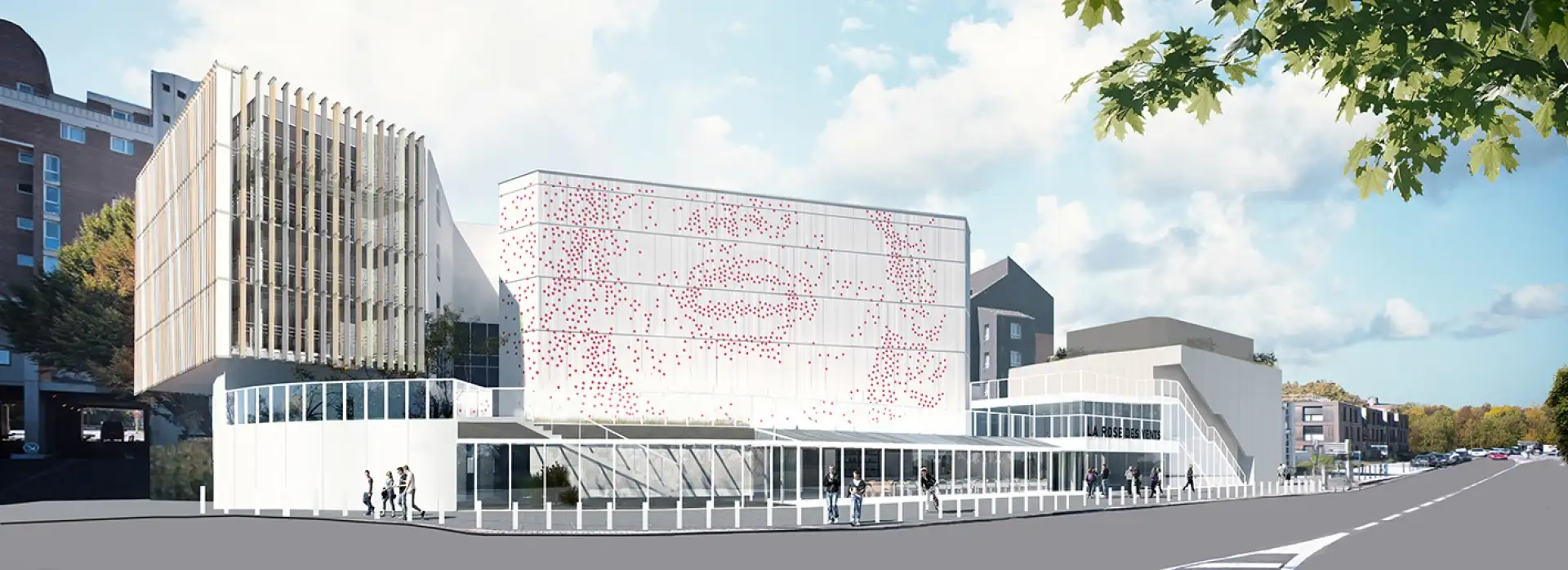« Au bout de ma langue » : Simon Grangeat et Tal Reuveny explorent la dysphorie linguistique
par Julia Wahl23.10.2025

La metteuse en scène Tal Reuveny crée au Théâtre de la Concorde la pièce de Simon Grangeat Au bout de ma langue, qui interroge le rapport des immigré·es à la langue d’origine et à la langue d’adoption.
Taym a neuf ans et vient d’arriver en France avec ses parents. De la langue parlée dans ce pays nouveau, il ne connaît rien. Elle lui semble un intense « brouhaha », qui lui fait mal au crâne tant il est agressif. Alors, il se tait et se réfugie dans les replis de sa langue maternelle, dont il enregistre de longs fragments grâce à un magnétophone prêté par son instituteur. Les contes de sa grand-mère, notamment, le bercent et lui offrent un abri salvateur, loin de la violence du français.
Pour explorer le rapport ambigu des immigré·es à cette langue qu’iels n’ont ni choisie, ni tétée avec le lait maternel, l’auteur Simon Grangeat a mené de longs entretiens. Aussi le personnage de Taym est-il la synthèse des confidences délivrées par ses interlocuteurs et interlocutrices. Il est néanmoins parvenu à faire de ses aveux disparates un personnage cohérent, dont nous suivons le désarroi muet.
« La seule chose qui compte, c’est que je puisse me blottir dans ma langue »
Celui-ci est joué par Omar Salem, lui-même issu d’une mère algérienne et d’un père palestinien, arrivé en France à l’âge de quatre ans. C’est peu dire qu’il connaît les difficultés de son personnage. Surtout, son parfait bilinguisme permet à l’auteur et à la metteuse en scène de proposer un spectacle bilingue, qui place le public purement francophone dans la même situation que Taym : si celui-ci raconte son histoire, face public, en français, les disputes de ses parents, les chansons de son père et les récits de sa grand-mère sont livré·es en arabe, sans la moindre traduction. Aux spectateurs et spectatrices de se laisser alors happer par ses sonorités certes pas tout à fait nouvelles, mais en grande partie obscures.
Destiné à être joué dans des espaces non théâtraux comme des écoles ou des centres sociaux, Au bout de ma langue présente une scénographie simple, mais fonctionnelle : de grands tissus moirés recouvrent le sol avant que de se transformer en pudique fichu ou, par la magie de la marionnettisation des objets, en personnage de conte. Au centre de la scène, deux ventilateurs font voleter des bandes magnétiques de cassettes audio. C’est toutefois bien le magnétophone l’objet principal, que l’on ne saurait désigner sous le nom d’accessoire : il apparaît en effet comme un personnage à part entière de la pièce, symbole de la dysphorie linguistique du personnage en même temps qu’espace de réconfort.
Au bout de ma langue explore avec tendresse et justesse les difficultés de son personnage.