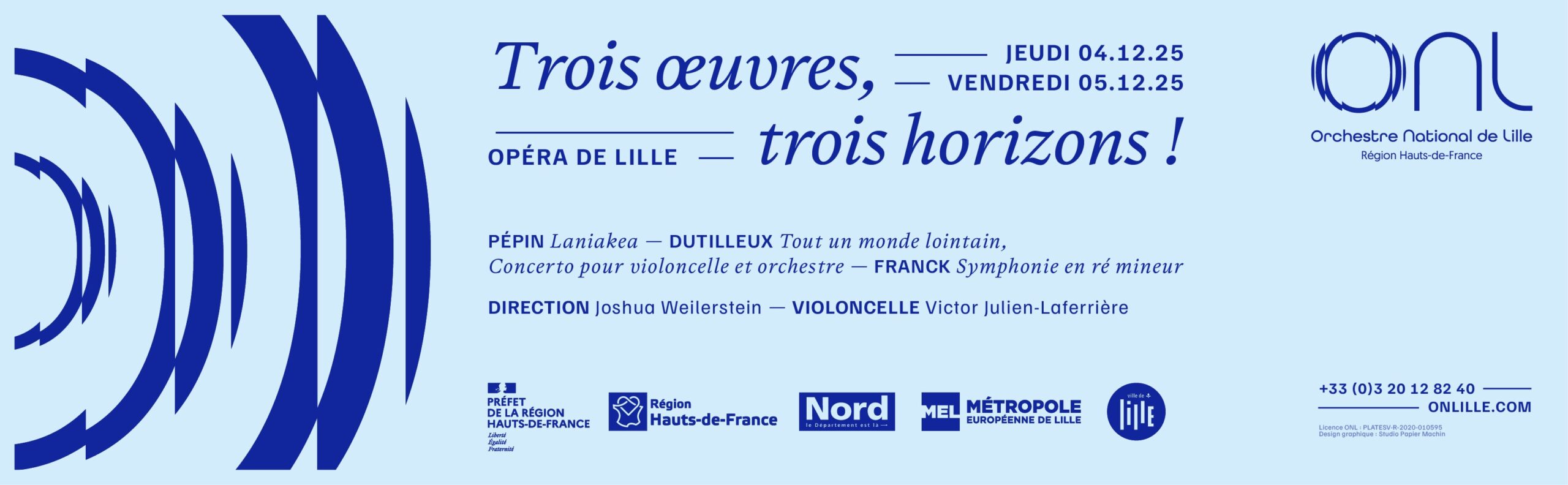Paris : les « Noces de Figaro » dans la joie et l’allégresse d’une reprise réussie
par Helene Adam17.11.2025

Première joyeuse ce 15 novembre pour la reprise de la mise en scène de Netia Jones. Avec une distribution presque entièrement renouvelée et fort intéressante, nous pénétrons avec plaisir dans les coulisses du palais Garnier, où se croisent le petit monde de l’opéra, jeunes danseuses et comédiens-chanteurs s’apprêtant dans leurs loges et autres foyers à donner un spectacle. Une soirée pétillante.
Derrière le rideau
La mise en scène de Netia Jones a été créée en pleine période de restrictions dues à la pandémie de Covid, en 2022 au Palais Garnier.
A l’époque – et malgré de nombreuses annulations et changements de distribution de dernière minute- elle avait rencontré un certain succès, du fait notamment du duo « choc » formé par Peter Mattéi et Luca Pisaroni dans les rôles respectifs du comte Almaviva et de Figaro. Un « couple » de chanteurs mozartiens particulièrement appréciés du public parisien, revenait après une magnifique prestation dans Don Giovanni (et Leporello) en ce même palais, en 2005 dans la production très controversée avant de devenir un « classique » de Michael Haneke.
Avec beaucoup d’humour et un parti pris féministe assumé, Netia Jones convainc bien davantage que pour sa récente Damnation de Faust au théâtre des Champs-Élysées.
Malgré les limites de la transposition moderne d’une œuvre basée sur les différenciations sociales qui ont beaucoup évolué à notre époque, elle nous offre une lecture pertinente dans un cadre esthétique de grande qualité, un peu comme on dévoilerait les dessous discutables d’une trop belle institution.
Sa mise en scène qui prend le parti du théâtre et valorise le livret très directement tiré de la pièce de Beaumarchais, « le mariage de Figaro », caustique et très critique envers les inégalités sociales, les inégalités de genre et la fatuité « de droit divin » des seigneurs et autres aristocrates, dont le règne prendra très rapidement fin après ces Noces. En effet, ces Noces sont chantées sur scène pour la première fois, en 1786, à Vienne. La Révolution française commence trois ans plus tard…
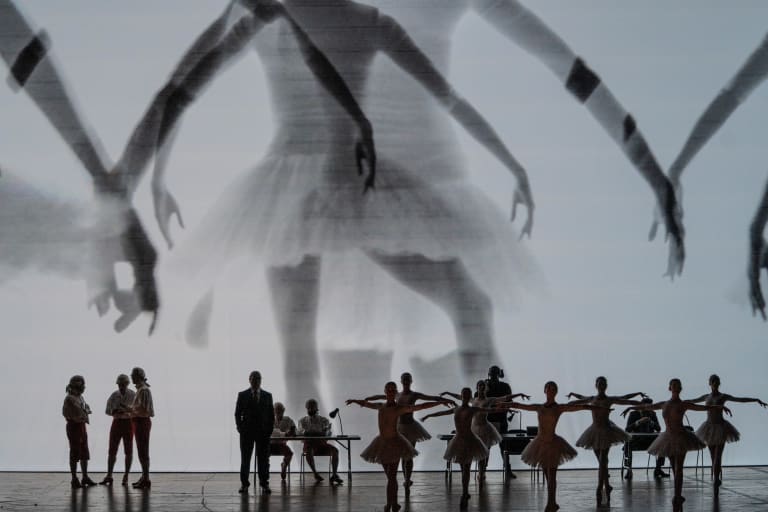
Certes, Lorenzo Da Ponte pour ce premier livret en collaboration avec Mozart, avait gommé toutes les aspérités directement politiques de la pièce de Beaumarchais, interdite à Vienne par Joseph II en 1785.
Il n’en reste pas moins que l’opéra lui-même, au travers de nombreuses situations et paroles explicites, dénonce nombre de droits que s’arrogent alors les princes de ce monde à l’égard de leur domesticité, tout comme à l’encontre du pouvoir de l’homme sur la femme dans une société où celles-ci sont « leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle ; traitées en mineures pour nos biens, punies en majeures pour nos fautes ! » (Tirade de Marcelline).
Et le théâtre, surtout dans la comédie, c’est le faux-semblant, le déguisement, le masque, les décors en trompe-l’œil, et l’ensemble des préparatifs dévolus aux coulisses, ce qui ne se voit pas pour le spectateur tout en étant la source de la réussite sur scène.
L’on doit à Netia Jones un spectacle complet puisqu’elle assure non seulement la mise en scène mais aussi les décors et les costumes et cette unité de style fait merveille jusque dans le mélange assumé entre l’époque de la pièce que préparent les comédiens et l’actualité.
Nous sommes donc d’abord sur une scène nue en préparation avant de voir le rideau tomber sur trois portes dessinées qui s’ouvrent, pour de vrai, sur trois loges identiques, celle du centre symbolisant le futur logement de Figaro et de Susanna, celle de gauche où le Comte lutine déjà une danseuse, et celle de droite où le professeur de musique, Basilio, fait répéter une chanteuse.

Ce sont les loges des artistes solistes de Garnier avec leurs hautes fenêtres d’où l’on aperçoit la rue et les immeubles Haussmann qui font face au Palais. Fauteuils tendus de rouge, élégants canapés, coiffeuses et costumes de scène sur cintre, l’ensemble est esthétique et évoque tout autant la transposition actuelle (Figaro fait ses mesures sur un portable) que la préparation d’une pièce du 18ème siècle (costumes et décors d’époque où dominent nettement le rouge et le blanc).
L’ensemble de la première partie se déroule dans ce décor qui, astucieusement, permet de passer d’une loge à l’autre, de la chambre de Figaro à celle de Madame, ou au salon du comte, voir Cherubino caché sous une robe de scène de la comtesse sur le fauteuil de la loge, tandis que le Comte se dissimule derrière le même fauteuil, le tout sans ces changements lourds de décor qui empêchent le plus souvent la fluidité de la pièce et son caractère comique de faire son effet.
L’on ajoutera une utilisation astucieuse des vidéos, qui projettent sur divers panneaux l’appellation des pièces du décor, des segments entiers du texte de Beaumarchais en français face à celui de l’opéra en italien mais aussi les ombres des personnages se livrant à des actes conformes à leurs pensées (Susanna frappant Marcellina avec un bouquet de fleurs pendant leur duo aigre-doux de l’acte 1).

A l’entracte entre l’acte 2 et l’acte 3, la scène se vide une première fois pour présenter un décor impressionnant d’escaliers menant aux différents étages des costumes avant de présenter la scène de découverte de l’identité réelle de Figaro sur le proscénium devant un rideau sombre puis les loges des chœurs avec des sièges de repos et l’apparition de ballerines parmi lesquelles se cache Cherubino.
Le dernier acte est celui des quiproquos et des tromperies sur l’identité des protagonistes, des pièges et du dénouement heureux. Elle se déroule à nouveau sur la scène nue du début, avec ses décors sombres et ses pendrillons mobiles côté jardin et côté cour, sol noir et atmosphère sombre propice aux dissimulations. De gros projecteurs de scène permettent à chacun de s’éclairer durant son air.
L’ouverture vers le célèbre foyer des danseuses
Lors du dénouement, à l’inverse, tout disparait, la scène apparait claire et immense, s’ouvrant dans le fond vers le foyer des danseuses de l’historique palais Garnier, magnifique salle violemment éclairée, où le ballet forme un gracieux bouquet avant de s’élancer sur la scène.
Cette somme de petites histoire (en coulisses) se termine donc dans la splendeur de la grande histoire (sur scène).

Le fameux foyer, qui a gardé son insolente beauté, raconte l’histoire des danseuses de l’opéra au dix-neuvième siècle. En effet, le style « grand opéra à la française », imposait l’introduction d’un ballet dans toute œuvre lyrique (ballet souvent supprimé de nos jours), et les spectateurs fortunés avaient « leur » danseuse attitrée qu’ils entretenaient et venaient voir à l’occasion. On peut voir encore les portraits peints des plus célèbres d’entre elles. Quand Netia Jones décide, (à l’instar de Robert Carsen dans le final de Capriccio en 2003) d’ouvrir totalement le fond de scène pour montrer au-delà des coulisses, ce charmant foyer, le symbole est lourd de toute cette ambiguïté entre beauté de l’art et exploitation des artistes, à qui elle rend un hommage que nous apprécions.
Le système du Palais Garnier en prend un peu pour son grade dans ce dévoilement des mauvaises manières dominatrices de la puissance masculine et cette vision de « derrière » le rideau, est efficace et bien traitée.
L’on a pu reprocher, à juste titre, à Netia Jones de ne pas toujours exploiter toutes les facettes de l’opéra de Mozart-Da Ponte, en gommant-de fait- les inégalités sociales sur lesquelles repose l’œuvre pour retenir essentiellement l’oppression de genre, des hommes à l’égard des femmes, sa mise en scène garde à l’occasion de cette deuxième reprise, toute sa fraicheur et son dynamisme, servie par une direction d’acteurs très efficace. C’est vif, insolent, enjoué et agréable à regarder.
Les qualités esthétiques et le soin apporté à la partie théâtre de l’opéra compensent largement quelques défauts recensés ici ou là. Et puis la salle rit beaucoup, signe du fait que la vis comica du livret est largement illustré par la mise en scène qui les souligne avec bonheur.
Une distribution renouvelée
Le choix des artistes interprètes nous propose, pour l’essentiel, un renouvellement intéressant.

Parmi les interprètes de la création, on retrouve avec un immense plaisir le Cherubino inoubliable de Lea Desandre, toujours aussi espiègle, rusé, désopilant et charmant, créatrice du rôle en 2022, qui, dans son petit survêtement orange, puis dans un tutu blanc, arrache le rire à chacune de ses apparitions et les seules réelles ovations de la soirée à chacun de ses airs. Car elle est « Cherubino » ce rôle androgyne ambigu qu’elle joue à merveille tout en le chantant avec un sens de la musicalité mozartienne idéal. Légèreté, agilité, très beau phrasé, Lea Desandre nous éblouit dès l’acte 1 avec son « Non so più cosa son, cosa faccio », comme dans son célèbre « Voi che sapete » de l’acte 2 sans oublier sa grande présence dans les duos, trio, ensembles.

Les autres grands rôles sont plutôt bien distribués mais on notera malgré tout des inégalités parfois gênantes dans les puissances de voix des différents interprètes.
La Susanna de Sabine Devieilhe est un modèle de beau chant. Elle incarne à merveille une jeune femme charmante et très amoureuse, virevoltant sur la scène avec une aisance confondante. La soprano excelle à exprimer ses divers sentiments, ses doutes, sa colère contre le Comte, contre Figaro, contre Marcelline. Elle aussi incarne la jeunesse et sa fine silhouette nous offre une jeune servante mutine et innocente, parfois naïve, parfois plus rouée qu’il n’y parait. Elle chante très bien – son « Giunse alfin il momento…Deh vieni, non tardar » est à se damner- les vocalises, le legato, les trilles, sont de grande qualité et l’on apprécie tout particulièrement son et son.
On notera malgré tout une légère réserve sur le caractère un peu menu de sa voix qui ne passe pas toujours la rampe avec autant d’ampleur qu’il serait nécessaire et qui est surtout dominée en décibels émis, par le puissant Figaro du baryton basse Gordon Bintner.
Erreur de distribution à notre sens que de vouloir « marier » deux voix qui n’ont manifestement pas la même projection vocale. En Figaro de haute taille, un peu brut de décoffrage, Gordon Bintner a de nombreuses qualités. Il est notamment doté d’une voix puissante et d’un très beau timbre, mais il nous laisse un peu sur notre faim par une sorte d’irrégularité dans l’émission qui fait que, parfois, la voix sonne mat et le brillant ne réapparait que dans les aigus. Il fait preuve, ceci dit, d’une grande expressivité comme ses partenaires et d’une aisance sur scène particulièrement plaisante. Nous l’avions déjà apprécié dans cette même salle, il y a quelques années en Junior dans A Quiet Place de Berstein.

Toujours parmi les voix puissantes, le comte de Christian Gerhaher, est plus surprenant et s’offre la plus belle ovation de la soirée. Wagnérien accompli, Gerhaher est un pilier du répertoire allemand du Lied et de l’Opéra de Munich et nous l’avons très souvent apprécié dans son rôle fétiche de Wolfram dans Tannhauser. La puissance de l’émission ne lui fait pas défaut et il campe un Comte brutal et peu raffiné où la noblesse ne perce pas sous la carapace de l’homme un peu primitif et très coléreux et … très drôle. La mise en scène le pousse évidemment dans cette interprétation (la DRH de la troupe déchire son contrat et le chasse en fin de représentation !) mais l’on dira, qu’il en rajoute un peu… Côté chant, il se montre irréprochable, beau phrasé, timbre riche, diction impeccable et remporte un vif succès au rideau, comme après un « Vedrò, mentr’io sospiro » (acte 3) de première classe.
Nous connaissons bien également l’interprète de la comtesse, Hanna-Elisabeth Müller, membre de la troupe de solistes de l’Opéra de Munich, que nous avons souvent entendue avec plaisir et dont le répertoire est très varié, allant de Mozart à Wagner en passant par Strauss. Elle paraissait un peu effacée hier soir malgré un jeu scénique intelligent et un très beau « Porgi, amor, qualche ristoro » (acte 2), particulièrement émouvant. La voix semblait parfois amenuisée, voire légèrement confidentielle surtout face aux voix masculines particulièrement puissantes.
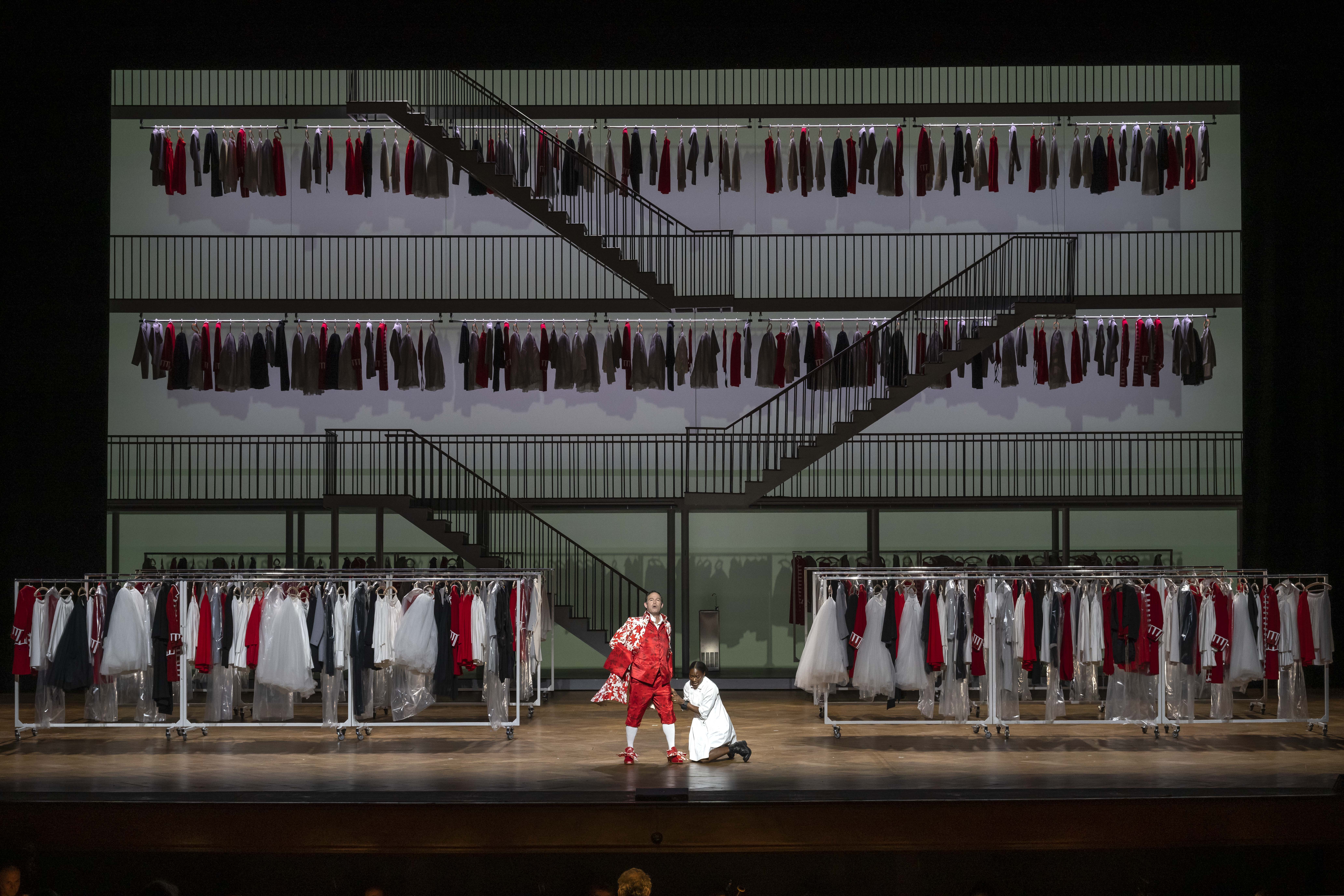
Habituée du rôle de Cherubino, Monica Bacelli se voit offrir le rôle de Marcellina, amputé de son seul véritable air (dont les paroles s’affichent derrière elle) et qui apparait donc essentiellement dans les récitatifs ce qui ne valorise pas sa présence pourtant intéressante.

Également familier des rôles de ténor mozartien, Leonardo Cortellazzi, ne fait qu’une bouchée du rôle de Don Basilio, le maître de musique.
Le Bartolo de James Creswell est le plus puissant du plateau et son « La vendetta, oh la vendetta » est l’un des grands moments de la soirée ! Le juge Don Curzio est très bien incarné par le ténor Nicholas Jones, membre de la troupe de l’Opéra de Paris où il s’est déjà illustré dans plusieurs rôles secondaires à Bastille.
Ilanah Lobel-Torres, qui sera Suzanna dans la deuxième distribution de cette série, nous offre une jolie Cavatine de Barberine « L’ho perduta, me meschina » tandis que le teigneux jardinier Antonio trouve en Franck Leguerinel, un interprète idéal.
Antonello Manacorda dirige l’orchestre de l’opéra de Paris avec une attention permanente portée aux chanteurs -durant les récitatifs avec continuo au clavecin comme les arias- ménageant des moments plus doux voire lents, avec des accélérations musicalement astucieuses facilitant notamment les très beaux « ensembles » à 7 avec le « Voi, signor, che giusto siete » et surtout à 6 avec le fameux « Sestetto, Riconosci in questo amplesso », même si les différences de style entre les voix ne permettent pas toujours de les apprécier dans toute la beauté de l’écriture mozartienne.
L’ouverture paraissait pourtant un peu convenue et l’on pouvait craindre une lecture très académique de Mozart mais la suite nous a montré un grand respect des spécificités et du génie de la composition musicale.
Et comme toujours, laissons la conclusion de cette folle journée au brillant ensemble avec le joyeux « Ah, tutti contenti/saremo così/Questo giorno di tormenti/di capricci, e di follia » !
Opéra de Paris
Les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart

Opéra Garnier : le gala chic et choc du contre-ténor Anthony Roth Costanzo
par Helene Adam16.11.2025

« Iolanta » : une nouvelle production de très belle facture à Bordeaux
par Hélène Biard16.11.2025