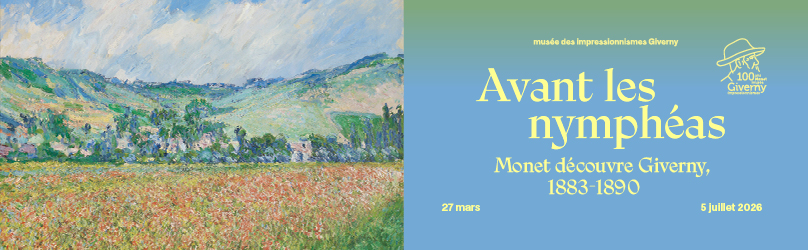Sierra volcanique et Camarena distingué, dans « Romeo et Juliette » à Naples
par Paul Fourier18.02.2025

En dépit d’une mise en scène plate, l’opéra de Gounod a triomphé sur la scène du Teatro San Carlo, grâce à l’orchestre dirigé avec finesse par Sesto Quatrini et à un magnifique couple d’amants passionnés.
La carrière de Charles Gounod connut des hauts et des bas. En 1854, puis en 1862, deux opéras composés pour l’Opéra de Paris, La nonne sanglante et La reine de Saba ne lui apportent pas les honneurs escomptés. Faust, créé en 1859, au Théâtre Lyrique (situé Place du Châtelet, à l’emplacement de l’actuel théâtre de la Ville), qui connaîtra pourtant un énorme succès par la suite, aura mis du temps à conquérir le public, mais Mireille (1864) est un échec sur la scène du même théâtre. La revanche vient donc, dès la création de Roméo et Juliette en avril 1867 ; l’opéra dépasse la 100e la première année et permet alors, à Gounod d’obtenir un triomphe.
La Miolan-Carvalho
Comme Faust, Roméo et Juliette fut composé en collaboration avec les librettistes Jules Barbier et Michel Carré (d’après Shakespeare) et créé au Théâtre-Lyrique avec Caroline-Marie Miolan-Carvalho dans le rôle de Juliette.
L’institution était alors gérée par Léon Carvalho, un impresario qui allait devenir une figure très importante du paysage lyrique parisien. Son épouse, Caroline-Marie, pour qui de nombreux rôles furent écrits, était l’une des chanteuses françaises les plus remarquables et les plus influentes de cette deuxième partie du XIXe siècle. Et si elle n’eut pas la brillante carrière internationale d’une Adelina Patti ou d’une Christine Nilsson, c’est, en partie, en raison de ses intérêts professionnels parisiens. Considérée comme la « directrice du Théâtre-Lyrique », elle travaillait en étroite collaboration avec son mari, Léon, finançant les audaces de son mari… ou épongeant ses dettes.

1867, une glorieuse année : l’Exposition Universelle, Don Carlos, La grande-duchesse et Roméo et Juliette !
1867 est une année tout à fait particulière, car elle accueille l’Exposition Universelle, incontestable vitrine de l’industrie et de la culture du Second Empire, installée dans un impressionnant site d’exposition spécialement construit au centre du nouvel environnement urbain provenant de la rénovation de zones entières de la capitale française par le baron Haussmann. Grâce à l’amélioration considérable des réseaux ferroviaires français, l’Exposition attire, à Paris, onze millions de visiteurs, de l’inauguration officielle par Napoléon III, le premier avril, jusqu’aux mois d’été.
Pour cette manifestation, l’opéra s’avère être l’un des « produits culturels » à exposer. Le 11 mars, l’Opéra de Paris crée, en français, le Don Carlos de Verdi. Dans un tout autre style, à partir du 12 avril, Jacques Offenbach propose La grande-duchesse de Gerolstein au Théâtre des Variétés, avec sa « Star », Hortense Schneider, dans le rôle-titre ; s’y pressent de nombreux spectateurs nationaux et internationaux, dont des chefs d’État étrangers. La première de Roméo et Juliette a lieu un peu plus de deux semaines plus tard, le 27 avril, au Théâtre-Lyrique. Malgré la concurrence féroce, l’œuvre obtient un succès immédiat et retentissant.
« Quatre duos d’amour garnis »
L’œuvre a initialement été conçue selon une structure d’opéra-comique, donc, avec des numéros musicaux, entrecoupés de dialogues parlés ; mais, à l’instar de Faust, qui connut rapidement le succès dans les régions françaises dans une version entièrement chantée, Roméo et Juliette a été, de même, immédiatement transformé, avec l’ajout de récitatifs chantés, et sera finalement, toujours représenté dans cette version (…d’autant que les textes parlés originaux ont été perdus).
L’on aurait dit de Roméo et Juliette qu’il s’agissait de « quatre duos d’amour garnis ». On peut rétorquer que ce n’est que justice pour les deux plus célèbres amoureux de l’histoire. Chacun de ces duos sert l’avancée inexorable des héros vers leur destin tragique. Il s’agit, d’abord du coup de foudre (pendant le bal), puis de l’épanouissement de l’amour (lors de la scène du balcon), de sa consommation charnelle avec les violoncelles qui résume l’intensité des étreintes et les deux voix apaisées qui chantent ensemble « Nuit d’hyménée », alors que les deux héros rivalisent de dénégations successives, afin de reculer le moment de la séparation (« Non, ce n’est pas le jour »)… Et enfin, vient le sacrifice final.

À ces duos sublimes s’ajoute, pour Juliette, la célébrissime « valse » du Ier acte (« Je veux vivre dans ce rêve »), écrite pour permettre à Mme Carvalho de briller, mais qui s’affirme être le reflet vocal d’une Juliette encore naïve et insouciante. Plus tard vient l’air hautement dramatique du 4e acte (« Amour, ranime mon courage »). Il est à noter que cet air n’a pas été exécuté lors de la première parisienne, Miolan-Carvalho ayant négocié avec Gounod de le couper, car elle estimait qu’il mettait à trop rude épreuve son endurance vocale ; en échange de quoi, lors de la composition de l’opéra, Gounod lui écrivit la « valse » qui convenait mieux à sa voix de soprano légère.
Bien évidemment, Roméo bénéficie de l’admirable air du balcon (« Ah, lève-toi soleil ») et plusieurs rôles secondaires (Capulet, Mercutio, Stéphano, le frère Laurent) ont droit à de substantiels morceaux.
Le Chœur, quant à lui, tire avantage du refrain entraînant du bal au 1er acte, mais brille, surtout, lors de ses magnifiques interventions funèbres, lors de la scène du duel qui, au 3e acte, se solde par la mort de Mercutio et Tybalt (« Ô jour de deuil ! Ô jour de larmes ! »).
L’ensemble dont Gounod a composé un riche alliage aboutit à un incontestable chef-d’œuvre et l’on n’est nullement étonné du succès rencontré par l’œuvre dès sa création, un succès toujours renouvelé.
Un parcours linéairement ponctué de succès
Après la création parisienne, les reprises à l’étranger ne se firent pas attendre : Roméo et Juliette arrivent à Covent Garden, le 11 juillet, en version italienne avec Adelina Patti et Mario ; puis, suivent, la même année, Dresde, New York, La Monnaie de Bruxelles et La Scala, ainsi que Vienne et Stockholm (en 1868), Varsovie, Prague et Berlin (en 1869), Moscou (en 1870) et Saint-Pétersbourg (en 1872).
À Paris, en raison de la faillite du Théâtre-Lyrique de Carvalho en mai 1868, des bouleversements de la guerre franco-prussienne, du siège de Paris et de la Commune, ce n’est qu’en janvier 1873 (après certes quelques représentations au Théâtre de la Renaissance, en avril 1868) que Roméo et Juliette est repris à l’Opéra-Comique, avec, de nouveau, Caroline Miolan-Carvalho, puis Adèle Isaac.
Il y reste pendant près de 300 soirées, jusqu’en décembre 1887 (date de l’incendie de la salle Favart). L’entrée, le 28 novembre 1888, de Roméo et Juliette à l’Opéra de Paris, avec Adelina Patti et Jan Reszke, contraint Gounod à ajouter un ballet dans le second tableau du IV° acte, avant l’évanouissement de Juliette. À Garnier, Roméo et Juliette figurera parmi les dix œuvres les plus jouées, dépassant 600 représentations jusqu’à 1963, puis sera repris en 1982.

L’amour, l’amour… Toujours !
Si l’opéra (et bien avant, l’œuvre de Shakespeare) porte la passion amoureuse au plus haut niveau, quelques anecdotes croustillantes ont montré que celle-ci débordait parfois de la scène à la vie des interprètes.
Ainsi, lors d’une soirée au Palais Garnier, peu après son inauguration par Napoléon III, Adelina Patti prolongea la célèbre scène du balcon, donnant – selon les chroniques et les ragots du lendemain – vingt-neuf baisers à son partenaire, le ténor français Ernesto Nicolini. Peu de temps après, la soprano divorçait du marquis de Caux pour devenir Madame Nicolini.
On dit également que lors d’une représentation à Chicago, un spectateur fanatique monta sur scène, déclarant qu’il était tombé amoureux de Juliette, en l’occurrence de la soprano australienne Nellie Melba. Dans la confusion, et devant l’émotion de la gent féminine, le Roméo du ténor polonais Jean de Reszke, prenant au sérieux son statut de représentant de la famille Montaigu, n’hésita pas à dégainer son épée pour dégager l’intrus…
Une Juliette volcanique, un Roméo très distingué
Compte tenu de l’importance de leurs rôles, une grande représentation de Roméo et Juliette repose nécessairement sur les deux protagonistes principaux, exceptionnels. La période récente a permis d’écouter Malfitano et Kraus, Gheorghiu et Alagna, Dreisig et Bernheim dernièrement à l’Opéra de Paris. On attendait donc beaucoup du couple formé par Nadine Sierra et Javier Camarena. Et, si chacun a joué de ses qualités – la première s’imposant, cependant, par un stupéfiant tour de force – ces deux artistes se sont avérés incarner un magnifique couple d’amoureux.
Dès les quelques phrases du « Écoutez ! C’est le bruit des instruments joyeux », Sierra fait une entrée fracassante, avec sa voix puissante et lumineuse. Son français est, certes, moins exemplaire que celui de Camarena qui lui, traduit, immédiatement, la passion de son Roméo dans un « Cette clarté céleste qui semble un rayon dans la nuit » dans lequel la diction rivalise avec la clarté de la voix.
La soprano exprime, ensuite tout son art dans la valse « Je veux vivre dans le rêve qui m’enivre », par une rythmique élégante, une grande longueur du souffle, des trilles parfaits et des aigus stratosphériques et longuement tenus ; sans compter une présence scénique qu’elle prolonge malicieusement au moment de sa première ovation par un public déjà chauffé à blanc par cet air léger.

Le premier duo, sensible, « Ange adorable » est un moment de grâce où chacun affiche ses atouts alors que leurs timbres se marient, lui avec une classe basée sur une diction absolument exemplaire, elle, avec une sensualité exacerbée.
Le français irréprochable de Camarena se confirme sur « L’amour ! Oui, son ardeur a troublé tout mon être (…) Ah ! Lève-toi soleil ! » et l’air est magnifiquement interprété, même si l’on peut regretter que le ténor ait, parfois, tendance à ouvrir exagérément ses aigus, puis à vouloir rendre le dernier trop spectaculaire, brisant, par cet effet, un peu trop appuyé, une ligne de chant racé qui portait l’air au plus haut.
Les deux chanteurs traduisent ensuite la tension existante du fait de leur amour dans le second duo « Ô nuit divine ! Je t’implore… ». L’extraordinaire douceur procurée par le « Va ! Repose en paix ! Sommeille ! », accompagné avec une lenteur extrême par le Chef montre l’adéquation du ténor avec le personnage de Roméo, quand il exprime toute la tendresse du jeune homme amoureux.
Le troisième duo, au quatrième acte, est la scène où le chant doit refléter la consommation physique de l’amour entre les deux jeunes amants. Les voix de Sierra et Camarena fusionnent en un accord parfait dans cette « Nuit d’hyménée » même si, rapidement, ses moyens naturels poussent la soprano à se montrer plus démonstrative que son partenaire. À la sortie de Roméo, alors que le public se laisse emporter par l’émotion et commence à applaudir, le chef lève la main pour permettre à Sierra, restée seule, de terminer la scène avec une douceur infinie.
Ce moment unique où on se dit « il fallait y être ! »
Le moment quasi historique de la représentation arrive avec « Dieu ! Quel frisson court dans mes veines ? (…) Amour, ranime mon courage… », un air de six minutes dont la force dramatique est comparable à l’air final de Marguerite de Faust ou à « l’air de la Crau » de Mireille.
Nadine Sierra s’y montre en pleine maîtrise de ses capacités, impressionnante par sa puissance, par ses aigus dardés, par une incarnation habitée de l’artiste qui joue du poignard et de la fiole. Elle termine sur un aigu fabuleusement tenu, déclenchant le délire d’un public qui va ensuite amener la soprano à faire chavirer le déroulement de la soirée.
À l’issue de l’air, l’interprète, ne semble nullement affectée par sa performance et, alors que les applaudissements s’éternisent et que les « bis » fusent, elle continue de jouer sur scène en gardant intacte sa concentration.
Si l’on se rappelle que, lors de la création, Caroline Miolan-Carvalho contourna l’obstacle, Sierra va alors céder à la demande de bis du public et l’enjamber ce soir par deux fois ! Donné une fois, cet air représente déjà une démonstration vocale que peu de ses devancières ont été capables d’exécuter avant autant d’aplomb ; répété en bis, sans économies, et même en modulant sa voix différemment, elle nous offre une performance physique quasi surhumaine.
Semblant jouer le tout pour le tout, elle augmente de puissance dans certains passages, jette, avec rage, le poignard qu’elle a récupéré, essaye d’extraire les dernières gouttes de poison d’une fiole déjà vide.
La performance encore une fois conclue sur un aigu stupéfiant, laisse les spectateurs abasourdis par cette générosité, une générosité à laquelle on espère, toutefois, que la soprano saura résister dans les prochaines représentations, tant la multiplication de ce tour de force, donné sans modération, pourrait, à terme, s’avérer périlleuse.
Le cinquième acte est entièrement dédié à la confusion de Roméo sur le corps inerte de Juliette et au fatal duo d’amour. Dans son air d’entrée, Camarena y montre encore toute sa sensibilité usant habilement de son français et de son vibrato. La scène finale dans laquelle le ténor et la soprano utilisent le mezza voce, clôture une magnifique performance des deux partenaires.

Des seconds rôles de bonne tenue, un chœur et un orchestre au service de Gounod
Dans le rôle de Frère Laurent, Gianluca Buratto a excellé dans l’air de la scène du mariage, « Dieu, qui fit l’homme à ton image… » avec sa voix bien timbrée, sa diction française impeccable et sa puissance d’incarnation. Il nous a, de nouveau, régalés, de sa voix chaude, lors de son duo du 4e acte avec l’air « Buvez donc ce breuvage… ».
Dans l’air de Stéphano qui débute la seconde partie du spectacle (« Que fais-tu, blanche tourterelle… »), Caterina Piva a, pour sa part, également, affiché une belle diction et, grâce sa voix chaude de mezzo, idéale pour le rôle, donné du caractère à l’insolent jeune homme.
Par ailleurs, un certain nombre de seconds rôles auront vraiment vu arriver leur moment dans la scène des duels ; Alessio Arduini en Mercutio (qui auparavant avait délivré, avec un délicieux accent, un « Mab, la reine des mensonges » tonique) y a montré là ses talents de bretteur. Tybalt (Marco Ciaponi), Benvolio (Sun Tianxuefei) et Grégorio (Maurizio Bove) ont également été de très bonne tenue dans cette scène riche en personnages.
Même s’il a surpris par son rythme relativement mesuré lors de la scène du bal (et des conséquences sur sa dynamique), le chef, Sesto Quatrini a souvent fait le choix d’un étirement musical qui s’est avéré pertinent pour les introductions, les scènes d’amour et la scène finale, et les tempi ont permis aux deux solistes principaux de nous gratifier de leur chant dans un confort idéal. Sous sa direction, l’orchestre du Teatro San Carlo a su montrer qu’il est, à sa façon, à l’aise avec la musique caractéristique de ce type d’opéras français.
Enfin, malgré une diction générale confuse, notamment, au début, le chœur a particulièrement brillé dans les quelques scènes où il est présent ; ce fut le cas dans l’un des plus beaux passages choraux écrits par Gounod (« Ô jour de deuil ! Ô jour de larmes ! ») auquel répond le magnifique « Ah ! Jour de deuil et d’horreur et de larmes » de Roméo. Grâce à l’infinie lenteur du Chef et à la mise en scène qui, par sa simplicité, s’est avérée, ici, apte à sublimer ce moment, ce passage était d’une indéfinissable beauté.
De la mise en scène de Giorgia Guerra, l’on ne retiendra, malheureusement, pas grand-chose. Elle tente bien quelques jeux de lumières différenciées pour les Capulets et les Montaigus qui, se fondant, donnent un blanc de pureté pour les rencontres des deux amoureux ; mais cela se révèle un peu court. Il restera néanmoins de belles images lorsque les deux clans familiaux s’affrontent pendant la scène des duels ou, encore, avec l’image de ce couple disparaissant dans la tour qui se referme sur eux, à la toute fin.
L’on connait la ferveur dont le public de Naples est capable lorsqu’il est enthousiaste. Ce soir, il avait des raisons de l’être alors qu’une soprano généreuse et, disons-le, un peu casse-cou, avait décidé de tout lui donner. L’on serait même tenté de parier que cette première de Roméo et Juliette, qui fait écho au triomphe de la création parisienne de 1867, pourrait s’inscrire dans la légende du Teatro San Carlo…
Visuels : © Luciano Romano

Athénée : la joyeuse « Cendrillon » de Pauline Viardot et… David Lescot !
par Helene Adam13.03.2026
→ Lire l’article

« Nixon in China » : Ping-pong et diplomatie à l’Opéra de Paris
par Yaël Hirsch12.03.2026
→ Lire l’article