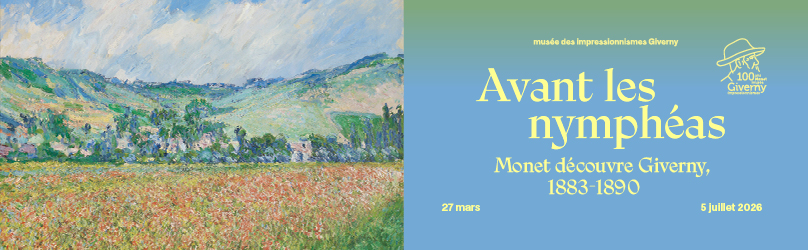« Le Joueur » de Prokofiev à Stuttgart, un foisonnement de sensations et une belle distribution
par Helene Adam16.03.2025

Radical, moderne, complexe et foisonnant, ce Joueur n’est pas facile à mettre en scène. À Stuttgart, en prenant un parti très ludique, Axel Ranisch permet au moins au spectateur de découvrir l’œuvre dans de bonnes conditions et ouvre des perspectives intéressantes concernant son décryptage. La splendeur de la direction musicale et de l’interprétation vocale viennent compléter la réussite de cette audacieuse entreprise.
De Dostoïevski à Prokofiev
Beaucoup connaissent l’œuvre littéraire éponyme de Dostoïevski, l’un des classiques de la littérature russe du 19èmesiècle. Tout en proclamant que le secret de la victoire au jeu, était de contrôler sans cesse ses choix sans jamais se laisser aller à la passion, Dostoïevski était lui-même victime d’une sévère addiction et avait dépensé des fortunes dans les casinos allemands, les seuls où ces jeux d’argent étaient permis. Son expérience a permis d’une part, une analyse très fine et fascinante du mécanisme de l’obsession du joueur, et d’autre part, la possibilité de rembourser ses dettes faramineuses grâce à la vente du livre.
Prokofiev, lui, s’intéresse à la panoplie pittoresque des personnages qui tentent leur chance et risquent leur fortune à la roulette dans cette place imaginaire de Roulettenburg.

L’opéra est d’abord et avant tout marqué par la galerie de portraits qui gravitent autour de la roulette et par la richesse musicale des thèmes qui se succèdent dans un foisonnement sonore illustrant parfaitement cette sorte de ruche permanente de « joueurs » compulsifs qui hantent le casino.
Sur le plan musical, l’audace de Prokofiev fut souvent éclipsée à l’époque par l’arrivée tonitruante (qui créait un scandale esthétique) de Stravinski à Paris, avec ses ballets et notamment son Sacre du Printemps. Ceci étant, Prokofiev avait la même propension à multiplier les sonorités complexes atonales tout en ramassant le tout dans un flux orchestral intense, ajoutant le chœur et les ensembles de solistes pour donner un dernier acte paroxysmique.
L’orchestre de Stuttgart dirigé par Alexander Vitlin, rend justice à cette partition foisonnante en respectant un rythme plutôt rapide et surtout un équilibre entre les voix et les instruments particulièrement propice à donner tout son sens à l’œuvre.
Une mise en scène ludique
Le parti pris d’Axel Ranisch a le mérite de valoriser cet aspect en donnant à chaque personnage, par le truchement de son costume comme de son jeu scénique, une vision haute en couleur qui valorise son rôle.
Avec une première partie où il flirte avec l’idée d’un imaginaire casino en ruine sur Mars qui aurait été victime du temps, de l’usure, de l’inutilité d’un séjour et d’un voyage à la Elon Musk pour milliardaires, et une deuxième partie où à l’inverse, le casino prend vie et s’anime furieusement autour de l’argent qui coule à flots, il permet à l’œuvre d’être facilement abordable même si sa mise en scène laisse dans l’ombre de nombreux aspects de l’opéra de Prokofiev.
Le décor est à la fois unique et se présente de manière radicalement différente d’une partie à l’autre : en première partie, nous avons un paysage extra-planétaire avec d’improbables montagnes couvertes de neige dans le fond et du sable désertique au sol ; un demi-disque circulaire git au milieu des cailloux et est parfois rehaussé avec des chaines pour re-servir au jeu. Il règne le sentiment d’une ancienne activité mondaine abandonnée où les « héros » se croisent dans des demi-vêtements très colorés à l’image de la fin suggérée de leurs conditions de riches aristocrates dépensant leurs sous en jouant.
En deuxième partie, après qu’une fusée très tintinesque se soit envolée vers la Terre, la roulette est redevenue complète, la toile qui la couvre est retirée, tout le monde a retrouvé une allure vestimentaire inspirée du Texas de Las Vegas et les billets verts s’envolent et retombent dans une frénésie sinistre parfaitement en phase avec l’évolution musicale de l’œuvre.
On s’amuse d’abord puis on est submergé par le drame de cette addiction fatale dont la morale est assez simple, mais reste d’actualité : l’argent crée la puissance, mais pas l’amour qui n’y résiste pas.
Bien chanté, bien joué
Pour illustrer ce conte féroce et musicalement complexe pour les voix (et la caractérisation des personnages) il faut une distribution exceptionnelle et de ce point de vue, on est très agréable surpris par le professionnalisme de la maison qui a su donner à chacun exactement le rôle qui lui convient, alliant direction musicale énergique et efficace et direction d’acteurs remarquable.
Le plateau est dominé par l’impressionnante prestation de la soprano lituanienne Aušrinė Stundytė, spécialiste de ces rôles vocalement complexes et de ces personnages féminins torturés à forte personnalité. On l’avait vue récemment dans L’affaire Makropoulos à Lyon et dans « Erwartung » de Schönberg au Grand Théâtre de Genève
On la reverra prochainement dans la nouvelle production de Die Frau Ohne Schatten par Katie Mitchell à Amsterdam. Elle brûle les planches comme à son habitude et la puissance de son soprano comme la beauté de son timbre et la précision de sa diction en russe, en font l’une des meilleurs Polina de ces dernières années.
C’est le ténor américain Daniel Brenna qui chante le rôle principal d’Alexei, son précepteur, amoureux de sa pupille et prêt à toutes les audaces pour lui plaire. Belle voix d’heldenténor il domine son sujet sans la moindre difficulté, mais il incarne un Alexei peut-être un peu trop sûr de lui sans toujours transmettre les fêlures et les désirs du personnage. Il vient cependant à bout d’un rôle long, difficile et soutenu, sans montre la moindre faiblesse vocale et sa prestation est à juste titre saluée.
Venu de France, on attend évidemment avec impatience « notre » Véronique Gens (dont la prestation a été largement saluée outre-Rhin). Et on est tout à la fois éblouis et très très contents de la voir en aussi belle forme de tous les points de vue dans ce rôle de Babulenka (la vieille qu’on attend qu’elle meure vue que c’est elle qu’a l’oseille, comme dirait Brel).
Elle est drôle et même désopilante dans son ensemble orange vif, jamais ridicule et souvent élégante comme elle l’est naturellement, immédiatement remarquée. Ce n’est pourtant pas son répertoire habituel mais celle qui va prendre le rôle de la Maréchale en juin prochain à Paris montre là qu’elle peut dominer sans la moindre difficulté, un rôle tendu vocalement qui doit s’interpréter comme une sorte de dialogue naturel alors que les sauts de notes et les propos (en russe) tenus ne sont pas très simples…

Elle ne montre aucune faiblesse vocale et son timbre est parfaitement homogène y compris dans les aigus. Quant à sa vis comica soigneusement cachée jusqu’à présent, elle devrait lui offrir de nouveaux emplois !
Tous les interprètes, dont beaucoup sont titulaires de l’Ensemble (troupe) de Stuttgart, à la prosodie russe très satisfaisante, se montrent à la hauteur de l’enjeu. Nous citerons bien sûr le Général de la basse Goran Jurić dont l’envie d’être un grand homme gonfle les biceps, mais dont l’incarnation, avec cette voix de bronze admirable, ne peut masquer le ridicule permanent du personnage. C’est très réussi tout comme d’ailleurs, l’humour qui caractérise les prestations de Stine Marie Fischer (Blanche) et Elmar Gilbertsson (le Marquis), ou Shigeo Ishino, (Mr. Astley), à la fois déjantés, bien chantant, donnant un relief bienvenu à leurs personnages qu’on se prend à apprécier dans leur folie ravageuse.
Sans les citer tous, on insistera sur la qualité des nombreux comprimari qui s’agglutinent sur la scène, chacun avec leur propre personnalité dans une vision de la diversité des orientations et des désirs fort bien rendue.
Une belle soirée pour un opéra qui mérite d’être plus souvent joué !

« Nixon in China » : Ping-pong et diplomatie à l’Opéra de Paris
par Yaël Hirsch12.03.2026
→ Lire l’article

Une deuxième distribution épatante pour une « Carmen » parisienne toujours aussi iconique
par Paul Fourier12.03.2026
→ Lire l’article