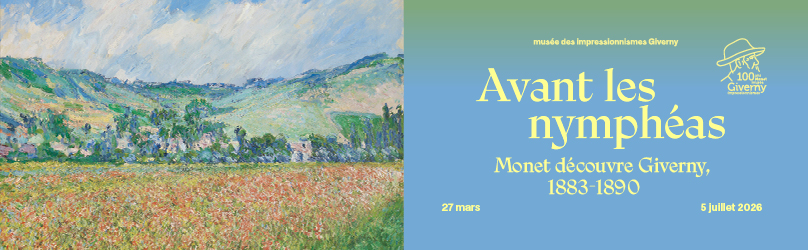La terrible et fascinante plongée dans les tranchées de Lohengrin à l’Opéra de Paris
par Paul Fourier25.09.2023

La première nouvelle production de l’Opéra de Paris pour la saison 2023-2024 est placée sous le sceau de l’intensité des images de Kirill Serebrennikov qui nous renvoie à notre monde fréquemment marqué par la Guerre. La direction d’Alexander Soddy est un enchantement et la distribution absolument éblouissante. Une rentrée en tous points remarquable !
Après Tannhäuser, Lohengrin marque, pour Wagner, un virage vers la révolution qu’il va entreprendre. L’influence romantique commence à se diluer ; le compositeur tourne le dos à l’opéra héroïque et le grand drame légendaire et musical apparaît au bout du chemin. La voie s’ouvre pour le Ring, puis, aboutissement ultime, pour Parsifal.
Progressivement, le récit s’étire, la structure délaisse les grands airs et la forme romantique de l’opéra, l’orchestre prend l’ascendant sur les voix, le drame est placé sous l’autorité de la symphonie…
Certes, Wagner est allé puiser la substance de son Lohengrin dans le Parzival de Wolfram von Eschenbach, mais, en cette fin des années 1840, alors qu’il participe au soulèvement de Dresde, Wagner est impliqué, à titre personnel, dans la vie politique de son pays. Cela entraînera sa fuite puis, en 1850, son absence, lors de la création de son opéra à Weimar.
Car ce Lohengrin, ce chevalier blanc, tisse aussi des liens entre la propre destinée du compositeur et le futur qu’il espère pour son pays. Originellement donc, l’opéra est déjà écrit en différents niveaux de langage et de pensée, car, en quittant le monde des hommes, Lohengrin acte la séparation entre le Graal et l’humanité ordinaire, mais aussi, plus largement, entre le Génie et le reste des hommes, voire entre Wagner et ceux qui préfèrent le conformisme et le matérialisme…
Lohengrin est donc fondamentalement un opéra politique ; un opéra qui, au-delà du mythe, parle des habituels soubresauts de l’Histoire… Et qui parle forcément de la guerre…
La guerre aux Xe, XXe et XXIe siècles… les Révolutions du XIXe…
S’il y a bien une constante dans l’Histoire des hommes, c’est celle de la tentation guerrière. Et cette dimension se retrouve dans le livret même de Lohengrin, car on y fait référence à Henri 1er l’Oiseleur qui vient lever des troupes pour combattre les Magyars.
Comme cela a été souligné, le tumulte armé est aussi présent dans l’histoire personnelle du compositeur puisque, lui-même, a participé au soulèvement de Dresde en 1849.
Mais la guerre ne s’est pas arrêtée à la mort de Wagner et celui-ci n’a pas connu les horreurs du XXe siècle.
Comme l’affirme Serebrennikov dans le programme de salle, « Wagner n’avait pas la même conception de la guerre ou de ses conséquences que celle qu’on a pu avoir après la Première et la Deuxième Guerres mondiales. Il a peut-être romantisé l’idée du conflit et participé à créer un héroïsme romantique… On ne peut évidemment pas, de nos jours, traiter la guerre d’un point de vue du XIXe siècle. Elle avait alors pour visée essentielle de redistribuer des frontières et créer des nations. L’idée d’unification était inhérente à la guerre et associée à un certain pathos héroïque. Au XXe siècle, l’Humanité a engendré l’horreur (…) Plus tard, l’épouvante de la Deuxième Guerre mondiale a poussé Theodor Adorno à se demander si la poésie était encore possible après Auschwitz (…). Les blessures se cicatrisent, l’Histoire continue. Mais je ne peux m’empêcher de penser que la guerre est à nos frontières et que nous continuons à vivre quasi normalement. Cette situation révèle le cynisme de la vie ».
Considérons donc qu’en s’attachant à placer son Lohengrin dans les abominations des guerres modernes, Serebrennikov s’inscrit dans une forme de continuité avec le propos de Wagner.

Bien sûr, l’on assiste en ces temps-ci à une résurgence de l’éternel débat sur le rôle du metteur en scène dans la représentation d’opéra et du « respect » dû au compositeur dans sa démarche.
Indéniablement, la nouvelle production parisienne de Lohengrin va contribuer à nourrir le débat entre deux camps qui se regardent plus en chiens de faïence qu’ils ne montrent leur capacité à engager un véritable dialogue.
En s’écartant de l’histoire telle qu’écrite « littéralement » dans le livret, Kirill Serebrennikov brouille, incontestablement, les cartes. Il s’éloigne du récit initial en nous entraînant dans l’imaginaire d’une Elsa psychologiquement atteinte par la mort de son frère à la guerre, et se retrouve aux prises avec ses fantômes.
Serebrennikov nous renvoie donc vers la dimension guerrière et, en parallèle, vers une interprétation reposant sur la douleur d’Elsa face à la disparition de son frère.
Certes, on peut le dire, la référence à la guerre n’est pas très novatrice, car on y baigne beaucoup à l’opéra ces temps-ci (cf. la récente Aïda de l’Opéra de Munich), mais elle est là, transcendée par la forme, car le spectacle est d’une puissance rare.
Un spectacle d’une puissance rare… et un choix pour le spectateurs
Le prélude nous emmène d’abord dans les souvenirs heureux d’Elsa lorsqu’elle accompagne son frère dans la forêt et que, dans un moment de félicité, il va se plonger dans l’onde d’un lac. Puis, ce frère va disparaître, les visages vont alors se distordre, et la seule eau qu’il verra (avant de mourir) sera celle, croupie, des tranchées.
Comme l’a dit Michel Foucault « La folie commence là où se trouble et s’obscurcit le rapport de l’homme à la vérité ». Elsa sombre, elle est habitée de fantômes ; certains la mettent en accusation (d’avoir laissé partir son frère ?) ; un autre (Lohengrin) auquel elle se raccroche pourrait, sinon faire revenir Gottfried, au moins lui dire ce qui lui est arrivé, car la guerre est, parfois, un puits sans fond où disparaissent les êtres… purement et simplement.
Très rapidement, donc, un choix s’impose aux spectateurs : s’accrocher aux faits et gestes de Lohengrin, Elsa et Ortrud tels qu’ils sont contenus littéralement dans le livret, au risque, ici, de se retrouver perdu (et insatisfait) et, à l’instar des spectateurs qui ont manifesté leur mécontentement lors de la première, in fine… de huer le metteur en scène.
L’autre possibilité – finalement plus confortable – est d’accepter de larguer les amarres, de se laisser embarquer dans le voyage proposé par Serebrennikov et de profiter des images puissantes (et aussi, parfois, belles).
Aux émouvantes images vidéo du prélude succèdent celles, en noir et blanc, de l’horreur de la guerre. Elsa se dédouble, ses pensées s’obscurcissent, et l’un de ses avatars se dévêt et erre nu sur le plateau. Ce premier acte où Serebrennikov figure l’univers mental intérieur de l’héroïne et sa folie, et où apparaissent des hommes aux ailes de cygne, est alors éblouissant par son oppressante beauté.

Au deuxième acte, l’évocation de la guerre en trois espaces distincts (celui où les hommes ont encore cette énergie pour partir au front, celui où ils reviennent abimés, celui, enfin, où l’on entrepose les morts qui ressuscitent et nous hantent), est une peinture plus forte que n’importe quel discours dénonçant les horreurs des conflits.
Elsa peut, dans son jugement troublé, s’imaginer que les morts parviennent à renaître… C’est l’apanage de ceux qui ont perdu l’esprit.
Il y aura aussi les mariages désespérés des soldats… dernier acte lumineux de leur vie, et le constat que le Lohengrin rêvé, n’est finalement qu’un soldat qui n’a pas grand-chose à apporter autre que la désolation.
Une distribution qui se plonge à corps perdu dans cette vision sombre.
On l’aura compris, le Lohengrin a perdu ici de son aveuglante lumière ; le Chevalier n’est plus qu’une image sortie de l’imagination d’Elsa. Et ce Chevalier ne va pas forcément lui donner les réponses qu’elle attend (et lui ramener son frère).
Piotr Beczala, en soldat en treillis, parvient ainsi à porter toute l’ambiguïté de ce personnage. La voix, claire, de ce fantôme semble s’inscrire dans un univers parallèle ; c’est une voix qui résonne comme un écho irréel et qui évolue bien loin de ceux qui cherchent à analyser la guerre. Lui, le soldat, suit son chemin et ne se pose pas de question. L’incarnation est troublante y compris dans un sublime « In fernem land » final.
Johanni van Oostrum campe une Elsa fragile, une Elsa qui tantôt espère et se raccroche à son Lohengrin comme à une planche illusoire de salut, tantôt sombre dans ses cauchemars. La luminosité du chant et l’excellence du jeu, mais aussi les failles qu’elle sait faire transparaître, en font un être fondamentalement émouvant et van Oostrum impose là une incarnation d’exception.

Dans cette production, Telramund et Ortrud ne sont finalement que des individus ordinaires, un couple de médecins en charge de gérer les dommages psychologiques engendrés par la guerre. Ils prennent donc là une humanité inattendue et semblent être les seuls à comprendre les désastres, à les réparer aussi.
Nina Stemme, avec son maquillage noir, incarne une fabuleuse Ortrud. À la luminosité de Van Oostrum, elle oppose l’image d’une autre femme, beaucoup plus terre à terre.
Certes, le vibrato va en s’imposant sur cette voix d’airain, mais, l’artiste, conserve sa puissance évocatrice et dramatique, tout en donnant à Ortrud « la sorcière », la profondeur d’une praticienne qui doit gérer les fantômes des autres.
Wolfgang Koch est tout aussi grandiose en être entre deux eaux, un homme en conflit avec son entourage, et un médecin dont l’humanité est confrontée aux horreurs de la guerre et qui maltraite Elsa.
En remplacement de Kwangchul Youn, Tareq Nazmi, de sa belle voix sonore, est un Roi Heinrich remarquable et Shenyang lui, incarne brillamment son porte-parole.
Enfin, si le chœur de l’Opéra de Paris (direction : Ching-Lien Wu) démontre là une adéquation superbe à la déclamation wagnérienne, à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Paris, Alexander Soddy présente une vision ample et la formation semble se plonger dans Wagner avec délectation. En déplaçant les trompettes dans les balcons latéraux, le chef fait au mieux pour extraire la musique de Wagner de la seule fosse afin d’envelopper le spectateur. À tout moment, en contrepoint de ce que nous voyons, Soddy compose un tapis musical somptueux.
Alors ?… Se laisser envahir par ce voyage dans la guerre et la folie… ou pas ? Telle est la question fondamentale à laquelle le public de l’Opéra de Paris est confronté pour cette nouvelle et marquante création du mandat d’Alexander Neef.
Quelle que soit, la réponse qui y est apportée, à l’issue de cette soirée de première, l’enthousiasme des spectateurs prouvait que cette immersion est une expérience qui doit être tentée.
Visuels : © Charles Duprat / Opéra national de Paris

Athénée : la joyeuse « Cendrillon » de Pauline Viardot et… David Lescot !
par Helene Adam13.03.2026
→ Lire l’article

« Nixon in China » : Ping-pong et diplomatie à l’Opéra de Paris
par Yaël Hirsch12.03.2026
→ Lire l’article