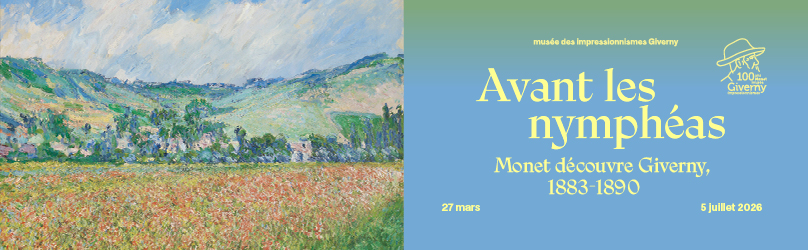Éclatant début de festival d’été à l’Opéra de Munich avec un « Trouvère » étourdissant
par Paul Fourier01.07.2024

Un quatuor détonnant, un chef verdien à l’extrême, que demander de plus pour savourer le plaisir retrouvé d’un chef d’œuvre ?
Toscanini pensait que pour monter Il Trovatore avec succès, « il suffisait » d’avoir à sa disposition les quatre plus grands chanteurs du monde. Outre le fait que l’affirmation (involontairement comique) disqualifierait de facto la plupart des représentations, il est aussi légitime de la considérer réductrice. Il Trovatore exige, surtout, un grand chef verdien qui ait à cœur de faire briller la partition dans ses multiples détails et ses nombreux moments de bravoure, et un quatuor avant tout équilibré, puisque les duos occupent la majeure partie de l’action.
Il Trovatore, l’un des bijoux – avec Rigoletto et La Traviata – de la « trilogie populaire » (et enchantée) de Verdi du début des années 1850, garde sur le public un fort pouvoir d’attraction. Cela nous rappelle, opportunément, qu’avant d’être supplanté par Faust, l’opéra de Verdi fut le plus populaire de son temps. Et ce succès ne se dément pas avec le temps.
Ce n’est pourtant pas la vraisemblance de l’histoire qui a garanti cet intérêt du public. Ce qui fait la force du Trouvère, c’est une forme de quintessence de l’opéra italien, portée par l’excellence de la musique de Verdi. Car, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a place pour aucun temps mort. Au contraire, à l’écoute, l’auditeur peut être saisi d’un certain vertige, tant l’accumulation frise parfois le trop-plein de la part d’un compositeur dont le talent créateur ne semblait pas avoir de limites. Chaque morceau, chaque air, duo ou quatuor, paraît comme avoir été saisi par la grâce et par une puissance où les situations – par moments absurdes – sont, de fait, transcendées par la force de la musique.

Rappeler cela, c’est dire combien la charge qui repose sur les épaules du chef, des solistes et des choristes (comme toujours fabuleusement sollicités chez Verdi) est conséquente.
Olivier Py, foisonnant, pas toujours clair dans ses intentions, mais producteur de belles images
La mise en scène d’Olivier Py date de 2013. Elle fut inaugurée par Anja Harteros et Jonas Kaufmann au temps de leur grande gloire bavaroise et internationale.
Comme souvent avec l’homme de théâtre, Py déborde d’idées jusqu’à, parfois, nous étourdir et, en cela, il y a indéniablement une concordance entre le mouvement omniprésent dans beaucoup de scènes et la richesse de la partition. On retrouve le vocabulaire habituel de Py : un décor métallique, tournant, éclairé aux néons, plus que monumental, dévoilant fréquemment de nouveaux espaces, montant jusque dans les cintres et permettant des visions panoramiques stupéfiantes, comme lors de l’arrivée de Manrico. Ce dispositif extrêmement mobile s’assagira en dernier partie, alors que l’issue fatale approche, pour revenir aux fondamentaux des relations humaines et du pur chant, à mettre seul en avant.
Pour autant, avec tout cet attirail qui ouvre moult possibilités, le metteur en scène n’est pas toujours clair dans ses intentions. L’une est cependant évidente, c’est la dimension « théâtrale » de l’œuvre, comme si l’on voyait une représentation dans la représentation. Py agit comme s’il avait décidé de prendre de la distance avec ce livret souvent absurde, fait de conventions éloignées de la vraie vie. Le livret de Salvatore Cammarano, lui-même tiré d’une pièce d’Antonio Gutiérrez, n’est pas, à la base, un chef d’œuvre, et il est légitime de se demander si Verdi, lui-même, en son temps, n’avait pas choisi de délaisser la cohérence de l’intrigue aux fins de privilégier une trame dramatique qui lui permette d’y accoler sa grande musique.
Ainsi, avec le monologue d’entrée de Ferrando, que l’on peut assimiler à celui d’un maître de cérémonie décidé à nous conter une histoire (assez sordide), Cammarano et Verdi semblaient démarrer en nous disant « il était une fois… ».
Avec sa machinerie, ses énormes poulies, sa locomotive, Olivier Py nous transporte dans la révolution industrielle qui, si elle est un tantinet postérieure à la création du Trouvère, n’en est pas moins contemporaine de Verdi. Py veut-il, par cette référence, nous indiquer que la période qui démarre à partir des années 1850 va être, outre l’ouverture au progrès, porteuse de désastres, humains, mais également écologiques ? Cela s’accorderait, en outre, avec la figuration de la nature, calcinée, qui apparaît de temps à autre.
Par ailleurs, là où Py joue juste si l’on regarde le défilé de guerres qui se sont succédées depuis 1850, c’est lorsqu’il représente les hommes en êtres hybrides, quasi minotaures, se battant pour un oui ou un non… des hommes finalement ramenés à leurs pulsions primaires.
En faisant un lien constant entre nourrisson et homme adulte, Py place aussi les hommes en situation de grands enfants dont la maturité reste à prouver. Cela est d’ailleurs illustré par un Manrico, certes arrogant et querelleur, mais qui, cependant, retrouve une position quasi fœtale, blotti contre son oreiller, lorsqu’il est en présence de sa mère.

Enfin, point ici une idée extrêmement pessimiste, celle que les enfants arrivent dans un monde qui va, avant tout, les maltraiter, ce qui expliquera leurs traumatismes qui, plus tard, se révèleront dans leurs comportements belliqueux.
L’image de la femme est différente, souvent sexualisée et provocatrice. Mais, lorsqu’elle est mère, elle s’avère alors, plus qu’ambiguë. Car si Azucena – elle-même fille de « la sorcière » qui fut exécutée – a enfanté, sa conduite est-elle, pour autant maternelle ? Elle a jeté (par erreur, sic !) son propre enfant au feu. Et, à la fin de l’opéra, elle fait preuve d’un total manque d’empathie à la mort de celui qui faisait office de fils, devenu, en un instant, le frère de son pire ennemi.
Enfin, comme toujours chez Py, la religion est présente, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit là de souligner son rôle néfaste où simplement l’influence qu’elle peut avoir sur les actes des hommes. Quoi qu’il en soit, la représentation de cette croix en flammes alors que Manrico chante « Di quella pira l’orrendo foco » (« De ce bûcher, l’horrible feu »), est probablement l’une des images les plus saisissantes de la soirée.
Un plateau excitant et un grand chef à la manœuvre !
Contrairement à certaines autres productions, Py, toujours soucieux de ses acteurs, donne de l’épaisseur aux personnages secondaires que sont Ferrando et Inès. Et cela met d’autant plus en valeur Tareq Nazmi et Erika Baikoff, deux excellents interprètes.
Nazmi, avec sa voix de basse extrêmement souple, capable de jouer du presque murmuré au forte, qui ouvre le bal avec une puissance et une assurance remarquables.
Quant à Erika Baikoff, elle s’avère fort présente dans un rôle qui se limite pourtant à dialoguer et à précéder le chant de sa maîtresse.

Marina Rebeka a une voix qui, certes, peut manquer de certaines des qualités attendues, notamment les piani qui ont fait la gloire de certaines de ses collègues. Néanmoins, dès le « Tacea la notte placida », elle annonce la voie que va suivre sa Leonora, en accord avec la mise en scène d’Olivier Py ; une femme volontaire mais qui va se faire inéluctablement se faire broyer par les évènements et le conflit entre Manrico et le Comte. Py a eu l’idée d’imaginer sa Leonora aveugle, donc encore plus vulnérable, et cette vulnérabilité est idéalement rendue par la soprano.
Vocalement, Rebeka joue sur un registre émotionnel avec un legato admirable et une diction affirmée et sa cabalette « Di tale amor » rappelle, de surcroît, sa pratique fréquente du bel canto avec une souplesse qui fait ici merveille. Lorsqu’elle apparaît, en fin d’acte II, son solo est déjà profondément émouvant, annonçant là le sommet qu’elle atteindra lors du quatrième acte.
Car cet acte sera son moment suprême. Ce seront 40 minutes durant lesquelles Rebeka va déployer son art, allant jusqu’à éclipser des partenaires, pourtant tous talentueux. Dans cet épilogue, nos réserves restent les mêmes sur les qualités vocales, mais quelle tragédienne, quel souci de faire fusionner le chant, les mots, et les attitudes !
Avec son « D’amor sull’ali rosee », elle nous touche au cœur, usant de toute sa technique imparable, de ses trilles qui vous emportent, et d’une manière d’être où la vulnérabilité et la plainte n’ont pas le goût de l’artificiel, mais de la vérité. Son « Miserere » est magnifique, scandé en parallèle de très belle façon par le chœur masculin, avec un orchestre enveloppant aux sonorités lugubres. Aveugle à la scène, par son chant, Rebeka, semble, à ce moment, en état d’apesanteur. Enfin, l’éprouvant passage de la soprano se clôt par la cabalette (« Tu vedrai che amore in terra ») où elle continue à user des accents de la femme condamnée, sans user d’une brillance qui serait là hors de propos.
La confrontation avec Petean retrouve ensuite les couleurs de l’urgence, grâce à un chef qui mène alors son orchestre à vive allure, sachant qu’il peut s’appuyer sur deux artistes exceptionnels à même de se mesurer à ce duo sous tension extrême.
Avant de finalement s’éteindre dans la scène suivante, Rebeka ose là des aigus qui, s’ils s’éloignent de la stricte beauté vocale, attestent des talents redoutables de la soprano pour éclipser, par son dramatisme, toute forme de prudence.
Dès son entrée en scène, George Petean, pour sa part, montre qu’il va s’affirmer comme un baryton Verdi quasi idéal, ici autoritaire, sans être caricatural.
Sa première scène est frappante de son art consommé pour ce type de personnages.
Puis, cela se confirme avec son air du troisième acte » (« Il balen del suo sorriso »), dans lequel on ne peut imaginer meilleur interprète du Comte tant le chant déployé est noble, tant le legato est parfait, tant les aigus sont présents et contrôlés.
Cette suprématie se vérifie ensuite avec la cabalette (« Per me, ora fatale »), d’autant que, durant tout la scène, Francesco Ivan Ciampa accompagne le baryton avec un grand soin, d’abord lentement, lui laissant le temps de développer sa voix et de soigner son legato, puis, dans la partie rapide, sur un rythme plus soutenu sans être excessif. Sa voix tendra ensuite à se faire discrète, tout en conservant une belle projection lors du chœur très réussi des religieuses. Enfin, comme on l’a souligné, le dernier duo avec Leonora sera d’une vérité étonnante.
Lorsqu’émerge des cintres la voix de Vittorio Grigolo, le visage couvert d’un masque de loup, on est d’abord saisi par la beauté du timbre et par une projection lumineuse qui semble tout survoler tant il impressionne dans le premier trio.
Le rôle de Manrico, ce personnage assez frustre, est un rôle à excès, mais Grigolo que l’on sait souvent capable de débordements, suit, ce soir, scrupuleusement le déroulement rythmé par le chef et le metteur en scène et s’avère-là, être un partenaire toujours en phase avec ses collègues.
À la fin de son premier duo avec Azucena, armé de sa diction italienne évidemment savoureuse, il met une belle ardeur dans la lecture de la lettre que lui apporte le messager, montrant là la fougue juvénile du héros.
Dans le duo de l’acte III, aux côtés de Leonora, le ténor délivre un « Ah si, ben mio, coll’essere » d’un chant absolument contrôlé, d’un timbre de miel et, finalement, d’une beauté saisissante. Cela nous rappelle là, que le rôle écrit par Verdi regorge d’extraits lyriques dans lesquels Grigolo ne peut qu’exceller.
Toutefois, dans cette partition, le compositeur a également prévu un passage particulièrement périlleux, à destination de ces ténors qui n’ont pas les qualités d’un « lirico-spinto » : cette terrible « Di quella pira » sur laquelle beaucoup se cassent les dents. Et avouons-le, en ce seul moment pour lequel il n’a pas la carrure requise, Grigolo saute l’obstacle de manière certes élégante, sans faiblir et même avec un certain panache… mais, en escamotant néanmoins un couplet et en se reprenant à deux fois sur un aigu final écourté.
Ce sera là le seul reproche à émettre vis-à-vis d’un artiste qui s’est avéré aussi exemplaire qu’il peut l’être, lorsqu’il est bien dirigé et qu’il s’est approprié la mise en scène. Car, à l’acte IV, le ténor saura s’effacer, lentement, pour donner un chant simple, émouvant tant aux côtés de sa mère que face à Leonora.

En Azucena, Yulia Matochkina montre tout au long de son monologue d’entrée, puis dans le duo (également long et éprouvant), qu’elle a toutes les ressources vocales pour affronter ce rôle écrasant. Livrant d’abord un admirable « Stride la vampa », elle ne baisse jamais la garde durant les quelques vingt minutes qui suivent, s’appuyant sur ses graves, mais pareillement capable de délivrer des aigus percutants.
Dans la confrontation avec le Comte – menée tambour battant par le chef – en début d’acte III, la mezzo-soprano et le baryton, sans excès, rivalisent, de beau chant.
Alors que cette partition est riche de scènes de groupes, le premier trio entre Luna, Manrico et Leonora montre que l’on a affaire à une équipe totalement en phase, une équipe qui va s’inscrire dans du Verdi de haut niveau et ce, alors que le chef porte des cadences variées sans jamais brutaliser ses chanteurs. Le final de l’acte II est de la même veine sur une rythmique parfaite imposée par Ciampa, faite d’accélérations soudaines, de moments de fureur, atterrissant sur des silences et le chant accordé des trois solistes.
C’est là un véritable moment de grâce. La scène finale s’avèrera être un passage dans lequel Matochkina module à l’extrême, dans lequel Grigolo convoque ses accents désespérés, dans lequel Rebeka jette ses dernières forces jusqu’à une mort théâtrale tout simplement splendide !
Le chœur du Bayerische Staatsoper, très sollicité dans l’opéra, est excellent dès le début, au moment du récit de Ferrando. Il assure également une présence remarquable au début de l’acte des bohémiens, ainsi qu’au début de l’acte III pour un nouveau célébrissime passage brillamment martelé par l’orchestre (« Squilli, echeggi la tromba guerriera ») dans lequel les cuivres donnent toute leur mesure et leur puissance.
Dès le début de la soirée, la direction de Francesco Ivan Ciampa s’est accordée à faire ressortir des couleurs et des rythmes changeants, adaptés à la partition de Verdi.
Lors du chœur des bohémiens, sur un rythme très soutenu, il accentue la scansion de cet air célèbre par un recours admirable aux percussions (et notamment les marteaux sur les enclumes), les cordes graves et les cuivres, qui émergent comme un flot presque effrayant. Il sait encore faire gronder l’orchestre à la fin de l’acte II, puis l’alléger soudainement, pour laisser se déployer la voix de Marina Rebeka.
L’ensemble des ruptures, le tapis enveloppant de cordes, les instants où il fait rugir l’orchestre dans la fosse grâce à des cuivres et des percussions fort bien réglés tout au long de la représentation, auront confirmé que Ciampa est un chef verdien unique qui comprend cette musique et sait porter sa noblesse sans jamais tombé dans la facilité et, encore moins, dans la vulgarité.
Il a, incontestablement, été l’artisan d’une soirée dans laquelle tous les protagonistes ont brillé. Une soirée de celles que l’on l’espère pour une ouverture d’un festival aussi prestigieux que celui du Bayerische Staatsoper.
Visuels : © Wilfried Hösl
Trailer de la création en 2013.

Athénée : la joyeuse « Cendrillon » de Pauline Viardot et…David Lescot !
par Helene Adam13.03.2026
→ Lire l’article

« Nixon in China » : Ping-pong et diplomatie à l’Opéra de Paris
par Yaël Hirsch12.03.2026
→ Lire l’article