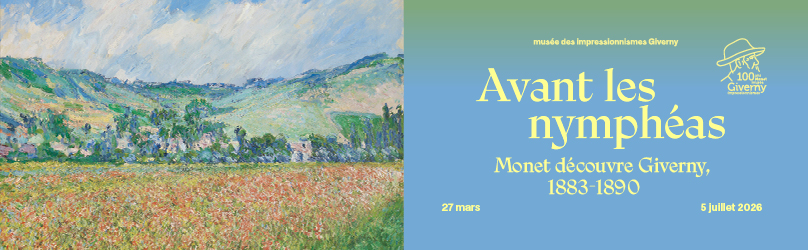« Die Frau Ohne Schatten » à l’Opéra de Lyon, défi réussi !
par Helene Adam23.10.2023

L’œuvre monumentale de Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal, est rarement donnée sur notre territoire alors qu’elle est monnaie courante dans les pays germanophones. L’Opéra de Lyon en propose six représentations pour la première fois depuis sa création il y a 104 ans. Dans une mise en scène intelligente et inventive, sous la direction énergique de Daniele Rustioni, avec une distribution jeune et impressionnante, l’audace de Richard Bunel a payé. Dimanche, la salle était comble et sous le charme.
Un opéra mythique
La Femme sans ombre, baptisée familièrement par l’anagramme de son titre allemand, FROSCH, est un opéra mythique par sa démesure. Quand on l’a vu une fois, on n’a de cesse de vouloir le revoir, encore et toujours, pour s’étourdir de cette partition d’une richesse orchestrale inouïe, de cette histoire, fantastique, mystérieuse et onirique, inspirée des légendes de style germanique ou perses, comme de la psychanalyse alors naissante à l’époque où Hugo von Hofmannsthal, écrivit ce livret pour Richard Strauss, dans l’une de leurs étroites et fécondes collaborations. L’écrivain et poète autrichien, publiera en 1919, l’année de la création de l’opéra à Vienne, une version littéraire de ce conte métaphysique et romantique, où l’impératrice, fille du Prince des esprits, lumineuse métamorphose d’une gazelle, devra conquérir l’ombre dont elle est dépourvue pour gagner le droit à devenir mère et sauver l’empereur son époux de la terrible malédiction qui le menace.
Fascinante pour qui pénètre les secrets de cette œuvre hors norme et se laisse emmener durant plus de trois heures dans ce labyrinthe entre terre et ciel, Die Frau Ohne Schatten est particulièrement complexe sur le plan de la mise en scène – un récit à plusieurs niveaux dans de nombreux espaces différents -, de l’orchestration – l’un des plus imposants orchestres de l’histoire de l’opéra – et du choix des solistes – cinq rôles particulièrement ardus sur le plan vocal.
Sous la direction de Daniele Rustioni
On comprend qu’il fallait beaucoup d’audace et de savoir-faire à un théâtre comme l’Opéra de Lyon pour mener à bien une telle entreprise. Et c’est l’année où l’orchestre de l’Opéra de Lyon fête ses quarante ans que son actuel et brillant directeur musical, Daniele Rustioni, a relevé le défi avec succès. Il en est, de toute évidence, l’artisan principal et son enthousiasme à diriger l’œuvre, est communicatif.
Certes, Lyon nous propose une orchestration légèrement réduite dans le cadre d’une adaptation opérée par Leonard Eröd, pour permettre aux moyens de la maison de réussir le challenge. Ainsi cinq contrebasses au lieu des huit requises, ou vingt-deux violons au lieu de trente-huit, moins de percussions et de cuivres également, peuvent prendre place dans la fosse du théâtre.
Mais à part cette réserve, qui parfois rend la musique moins exaltante, moins riche, moins complexe que celle écrite par Strauss dans son intégralité, le spectacle est d’une très haute tenue notamment du fait d’une direction musicale de très grande qualité et de solistes tout à fait remarquables.
Trois femmes puissantes
Le secret d’une FROSCH réussie tient tout d’abord dans la présence de trois interprètes féminines aux capacités techniques vocales exceptionnelles, deux sopranos et une mezzo-soprano dramatiques, et Lyon a parfaitement réussi cette réunion avec ses trois solistes. En effet il faut tout à la fois être capable de « passer » l’orchestre qui monte littéralement à l’assaut des parties vocales même si Daniele Rustioni fait preuve d’une délicate attention de tous les instants, guidant ses chanteurs dans leurs performances à chaque difficulté. Il faut aussi posséder un organe exceptionnel qui doit tout à la fois exprimer romantisme et lyrisme dans de très beaux passages élégiaques, aigus fortissimo et graves abyssaux se suivant dans la même phrase musicale, bref, des exploits à chaque mesure, sans « rupture » de registre, en évitant les stridences malgré la gymnastique permanente imposée aux cordes vocales. Les personnages, l’impératrice venue du monde d’en-haut, la teinturière, terrienne ordinaire et la mystérieuse nourrice, sorte de gouvernante entièrement dévouée à sa maitresse et au monde d’en-haut, vont se révéler au fur à mesure de l’histoire et évoluer vers divers sentiments très complexes qu’il faut savoir incarner au travers du chant comme de la posture théâtrale.
Et c’est la performance de la soprano canadienne Ambur Braid qui retient d’abord l’attention. Voilà une teinturière magistralement représentée par le talent de son interprète ! Quel charisme sur scène, quelle présence intense, que de pensées et sentiments contradictoires exprimés par le truchement de cette voix qui semble défier toutes les difficultés et se rire d’elles ! L’élégance de la silhouette de l’artiste renforce d’ailleurs judicieusement le contraste avec l’ordinaire de sa vie de « Färberin » (et non de simple « femme » de Barak comme le programme de l’Opéra de Lyon semble le suggérer) rendant crédibles ses rêves d’un ailleurs plus séduisant. Ambur Braid (qui sera Rachel dans une production très attendue de La Juive à l’opéra de Francfort prochainement) nous a éblouis par son chant coloré, nuancé, défiant les décibels agressifs de l’orchestre, et campant ce rôle central de l’œuvre, dans un style qui marquera durablement.
La nourrice de la mezzo-soprano Lindsay Ammann est également une figure remarquable. Toute vêtue de noir à la manière des gouvernantes un peu effrayantes de certains films, coiffée à la Louise Brooks, elle semble suivre littéralement l’impératrice comme l’ombre que cette dernière désire tant posséder pour pouvoir enfanter, et nous offre un portrait saisissant de la mal-aimée, maléfique et rejetée. La voix est superbement projetée sans le moindre défaut dans la tessiture, assumant avec brio des écarts de notes redoutables et nous gratifiant de ses graves abyssaux qui créent les plus grands frissons.
Le fait que la délicate et sensuelle impératrice de Sara Jakubiak ne soit pas en reste, ni dans les qualités vocales ni dans l’incarnation scénique, nous donne des scènes d’anthologie. On se félicite, d’ailleurs , de voir à quel point la soprano, que nous avions pu voir en jeune Eva dans Die Meistersinger à Munich il y a quelques années, et qui a, depuis, élargi considérablement son répertoire, connait une évolution vocale positive qui la place dans les grandes interprètes actuelles de ce rôle, tout à la fois virtuose et dramatique. Elle en donne une lecture très convaincante notamment à l’acte 3 quand elle renonce à cette ombre tant désirée dans un déchirant et percutant «Ich will nicht » (je ne veux pas).

Et bien accompagnées !
Le baryton Josef Wagner se hisse sans peine à la hauteur du seul personnage qui possède un nom dans l’œuvre de Strauss, Barak, lui conférant l’humanité qui le caractérise, et sachant nous offrir de belles couleurs et des nuances subtiles marquant l’évolution du teinturier.
La scène où elle et lui sont dans un souterrain, ne se reconnaissent pas mais avouent chacun regretter amèrement leurs erreurs, est l’un des « duos » les plus impressionnants de la représentation.
Le rôle de l’empereur est particulièrement ingrat puisqu’il a surtout quelques longs monologues difficiles. Victime dès le début de la fameuse prophétie « la femme ne projette aucune ombre et l’empereur sera changé en pierre », il interagit peu avec ses partenaires. Richard Strauss avait la réputation de ne pas aimer les ténors et leur a rarement réservé des rôles très gratifiants. Vincent Wolfsteiner a bien du mal à assumer cette difficile partition, le timbre est trop léger et peu séduisant, les aigus souvent aigrelets et l’ensemble de la prestation manque de noblesse.
Mais c’est la seule réserve que nous aurons pour la partie vocale de cette performance. En effet le chœur, qui chante depuis les coulisses, est admirable, de même que les nombreux figurants et danseurs, sans oublier le messager de Keikobad, qui ouvre le bal en quelque sorte, avec la belle voix du baryton Julian Orlishausen et les rôles plus secondaires, tous très bien tenus, des frères de Barak, Robert Lewis, Pawel Trojak et Pete Thanapat, la voix céleste de Thandiswa Mpongwana, le faucon de Giulia Scopelliti ou le jeune homme de Robert Lewis.
Une mise en scène chargée de mystère
Mariusz Treliński nous propose une scénographie astucieuse et réussie. Le décor impressionnant de Fabien Lédé, parvient en effet à parfaitement représenter les deux mondes où évoluent les différents protagonistes par un système de plateau tournant ménageant une sorte de « sas » entre chaque changement de lieu, et suggérant de nombreuses similitudes dans les décors du monde terrestre et de celui des esprits (même baie vitrée, même intérieur meublé) tout en les opposant par des esthétiques radicalement différentes (beauté mystérieuse de la forêt luxuriante aperçue par la large fenêtre versus opacité des carreaux mal lavés par exemple). Une vidéo, réalisée par Bartek Macias, d’une maitrise technique exceptionnelles, assurée par une équipe de techniciens efficace, vient plonger l’ensemble du décor et des personnages, régulièrement dans une série d’images oniriques et variées qui symbolisent à merveille, les rêves, les espoirs, les illusions et le passage d’un monde à l’autre.

Au-dessus du décor apparait à deux reprises un énorme mégalithe sculpté de mystérieux hiéroglyphes, tout d’abord au tout début de l’acte 1, ensuite lors du dernier acte quand le décor disparaît peu à peu, laissant apparaitre Keikobad allongé comme pétrifié, avec cet énorme rocher suspendu au-dessus de son corps immobile.
L’ensemble est fluide et suit fidèlement le déroulé de cette histoire fantasmagorique, non sans quelques clins d’œil très cinématographiques comme ce rectangle noir encadré de lumière où disparaissent la nourrice puis l’impératrice.
Le final, avec le bonheur et la « normalité » retrouvée puisque l’un et l’autre couple seront désormais pourvu de progénitures, est traité avec un peu d’humour teinté de mystère par le metteur en scène qui laisse le spectateur indécis quant au futur des héros.
Mais c’est très secondaire au regard de la beauté esthétique globale, y compris l’admirable jeu de lumière réalisé par Marc Heinz, la chorégraphie soignée de Jacek Przybyłowicz mettant en scène les personnages imaginaires, et les costumes, stylisés et simplifiés à dominante noire ou blanche des créature célestes, par opposition aux vêtements de tous les jours des créatures terrestres.
L’Opéra de Lyon a réussi son audacieux pari et prouvé qu’on pouvait trouver des distributions adéquates, des mises en scène intelligentes et une direction musicale au dynamisme et à la précision exceptionnelle, au service d’une œuvre rare en France et réputée difficile, pour le plus grand bonheur des nombreux passionnés de cette partition exceptionnelle.
Opéra de Lyon, les 17, 20, 22, 25, 28 et 31 octobre.
Réservations sur le site de l’opéra.
Visuels © Opéra de Lyon / Stofleth

Athénée : la joyeuse « Cendrillon » de Pauline Viardot et…David Lescot !
par Helene Adam13.03.2026
→ Lire l’article

« Nixon in China » : Ping-pong et diplomatie à l’Opéra de Paris
par Yaël Hirsch12.03.2026
→ Lire l’article