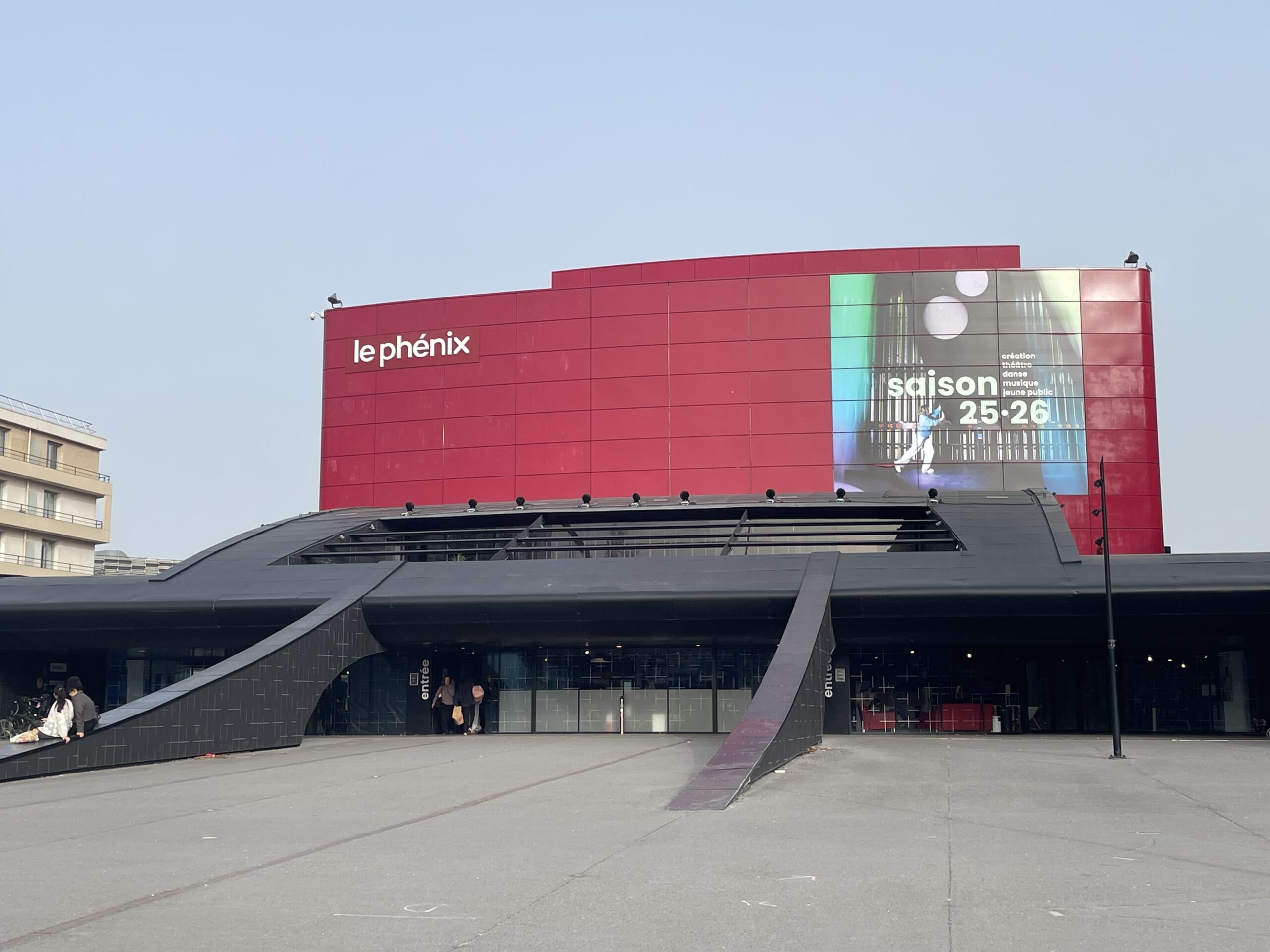« L’Impresario de Smyrne » au théâtre de l’Athénée
par Helene Adam02.05.2024

L’Athénée Louis-Jouvet présente ces jours-ci, « l’Impresario de Smyrne, scènes de la vie d’opéra » d’après deux pièces de Carlo Goldoni, dans la mise en scène de Laurent Pelly avec Natalie Dessay. Intrigue mince et modernisation réductrice, peinent à convaincre malgré le talent des acteurs.
Carlo Goldoni et le monde de la scène
Ces « scènes de la vie d’opéra », résultat de la fusion-réduction de deux pièces de Carlo Goldoni, nous conduisent dans le monde des artistes de l’Italie du dix-huitième siècle.
Carlo Goldoni, auteur prolifique, juriste qui abandonna ses activités professionnelles pour se consacrer à sa passion du théâtre, a écrit des dizaines de pièces, généralement comiques, en vers ou en prose, en italien ou en français. Il a également été librettiste pour les opéras qui fleurissaient un peu partout en Europe à cette époque, notamment pour Vivaldi et sa connaissance de ce milieu a largement inspiré les pièces qui servent de base au spectacle d’Agathe Mélinand et Laurent Pelly.
Goldoni défend une modernisation de la comédie italienne qu’il veut dépoussiérer d’un certain nombre de ses rites immuables, notamment la tradition des « masques » pour les comédiens et dépasser la commedia dell’arte. Il admire énormément le travail de Molière et défend son hyper réalisme dans le traitement des sujets.
Les deux pièces dont s’inspire le spectacle de l’Athénée, ne sont pas parmi les plus connues de Goldoni : « Le Théâtre Comique » (1750) a pratiquement disparu des mémoires et « L’Impresario de Smyrne » (1759), a bénéficié d’une mise en scène inspirée de Luchino Visconti en 1958, ce qui lui a donné une deuxième vie. L’homme de théâtre et de cinéma italien, avait déjà réhabilité l’auteur oublié avec sa Locandiera, créée en 1952 à la Fenice de Venise, avec Rina Morelli et Marcello Mastroiani.
Claude Sarraute écrivait dans Le Monde à l’époque : « J’entendais regretter à la sortie la minceur du prétexte à tant de splendeurs, de raffinements. Pourquoi ? Visconti s’est offert le luxe de raviver les couleurs de ce joli lavis du dix-huitième siècle, à l’encadrer superbement. Comment ne pas lui en être reconnaissant ? » et saluait le « travail de restaurateur, analogue, on le voit, à celui qu’avait nécessité sa vision toute nouvelle de la Locandiera ». (Le Monde, 16 avril 1958). Luchino Visconti avait opté d’ailleurs pour la première version de l’auteur vénitien, celle écrite en vers pour l’ouverture du carnaval de 1759.

.
Une modernisation réductrice
De tout cela, il ne reste guère que le thème -la critique du milieu des artistes d’opéra et la dure loi du bûcher des vanités- et la trame d’une intrigue très mince et très convenue tant elle a été moult fois traitée dans la littérature, le théâtre ou l’opéra
Car en réduisant deux pièces, dont l’une dure deux heures trente à elle toute seule, à un seul spectacle d’une heure quarante, Agathe Mélinand fait le choix d’écrire autre chose sans parvenir à convaincre du bien-fondé de l’entreprise.
Certes, objectera-t-on, il fallait moderniser des dialogues surannés, les rendre conformes au langage d’aujourd’hui. Oui mais… Le thème lui-même reste quand même très daté même s’il est porteur d’une « morale » toujours d’actualité, celle du final : il vaut mieux fonder une société des artistes que de dépendre d’un impresario « privé ». Si l’on peut imaginer qu’existent toujours des querelles de préséance entre divas, divos, et rôles secondaires, et qu’il est incontestable que des artistes, payés au cachet, peuvent dépendent du bon vouloir de leurs agents comme des directeurs d’opéra, tout ce monde professionnel a profondément évolué tout comme d’ailleurs le business afférent.
Pourquoi ne pas revenir à l’original pour lequel Dominique Fernandez avait proposé une traduction pour les représentations de la Comédie Française en 1985 ? Cela aurait permis de laisser opérer le charme de ce témoignage des mœurs du théâtre et de l’opéra, très typiques de ce dix-huitième siècle où de Venise, à Florence, de Bologne à Paris, l’on se prépare à son évolution radicale.
La pièce de Goldoni témoignait de cette époque où les « amoureux » sont forcément incarnés par un castrat et une prima donna, où le ténor joue les nourrices, les maîtres, les empêcheurs de tourner en rond, et où les chanteurs/acteurs sont largement sollicités dans les deux domaines du récitatif et de l’aria, la valorisation venant de ces fameux airs virtuoses et des duos qui en découlent.
Smyrne, possession de l’empire Ottoman à cette époque, est une cité marchande chargée d’histoire qui porte le nom d’Izmir dans la Turquie d’aujourd’hui. La référence à ce pacha Ali, soucieux de former une troupe pour apporter l’opéra dans son pays, et qui se rend à Venise dans cet objectif, participe de la mode « orientalo-exotique » d’alors que l’on retrouve dans nombre d’ouvrages du dix-huitième siècle.

De tout ce tableau pittoresque, il ne reste pas grand-chose tant l’œuvre est édulcorée et réduite. Le langage a été modifié et modernisé, mais par la même occasion, a perdu en authenticité sans gagner en subtilité au contraire. Nombre de répliques sont assez triviales et des expressions d’aujourd’hui cohabitent curieusement avec un obsessionnel « serviteur » qui sert (avec courbette) de salut (hypocrite) entre artistes.
Et l’on se lasse assez vite de ces querelles entendues dont la chute est assez prévisible et où ces pauvres chanteurs d’opéra, caricaturés sans la moindre empathie ni tendresse, s’entredéchirent pour un rôle et échoueront finalement puisque Ali repart à Smyrne sans eux après qu’ils ont accepté tout ce qu’ils refusaient au début (montant des cachets, rangs des rôles).
Belle esthétique de la mise en scène de Pelly
La mise en scène de Laurent Pelly est réduite à l’essentiel, elle aussi, sans manquer pour autant d’idées intéressantes, voire élégantes : le sol en lattes de bois qui occupe tout l’espace, évoque le pont du bateau où ils rêvent tous d’embarquer pour Smyrne, la gloire et la richesse, l’encadrement de la scène est penché et donne légèrement le mal de mer, le trou du souffleur est une trappe dans ce « pont ». Les bruitages (mouettes, roulis) renforcent ce parti pris en donnant finalement aux chanteurs cette part de rêve peu présente dans leurs dialogues. Leurs mouvements en soliste, à deux, trois ou tous ensemble, tient lieu d’occupation de l’espace, et le concept leur impose un jeu un peu outré qui n’autorise pas les subtilités des sentiments, mais traite le sujet façon vaudeville volontairement assez trivial.
Les costumes Julie Nowak, Manon Bruffaerts et de l’Atelier du Théâtre de Liège, sont sobres et esthétiques, loin des multiples et audacieuses couleurs qu’avait osés Luchino Visconti et qui évoquent le plus souvent les scènes d’alors. Ils et elles sont tous, toutes, en noir des pieds à la tête, et aucune décoration ne vient égayer cette représentation austère, d’autant que l’uniformité de leur allure et le masque blanc peint sur leur visage, renforce le côté automate sans âme.

Très beau travail de l’équipe d’artistes
Les artistes tiennent très bien leurs rôles dans le cadre de cette mise en scène et l’on apprécie que plusieurs d’entre eux soient aussi des chanteurs d’opéra, ce qui nous permet de les entendre brièvement, mais brillamment dans leur art.
Car côté musique, s’il s’agit d’une pièce de théâtre, elle parle d’opéra et, de toute façon, des morceaux de musique étaient fréquemment intégrés au théâtre. Cette tradition est assez fidèlement reproduite ici, avec l’ensemble baroque Masques dirigé par Olivier Fortin, qui joue tout au fond du plateau, des airs de Pergolèse et Vivaldi en accompagnement de nombreuses répliques. Nous pouvons ainsi entendre et apprécier le violoncelle de Mélisande Corriveau et Arthur Cambreling, le Clavecin d’Olivier Fortin et le violon Paul Monteiro.
Natalie Dessay incarne l’une des cantatrices, Tognina, la Vénitienne, la soprano la plus galonnée (mais aussi la plus âgée) avec ce talent de comédienne qu’elle avait déjà à l’opéra et son « aria » est si belle, aérienne, souveraine que l’on se prend à regretter encore une fois, qu’elle ait quitté ce monde lyrique où nous l’avons tant aimée.
Ses « concurrentes » sont Annina (la bolognaise) incarnée par la soprano Julie Mossay, qui chante également un bref morceau et Lucrezia, la florentine (victorieuse du match à trois) interprétée par Jeanne Piponnier, actrice talentueuse qui ne chante pas, contrairement au ténor Damien Bigourdan, le troisième artiste lyrique de la distribution. Thomas Condemine joue un Carluccio (le castrat) désopilant tandis que Cyril Collet est l’hypocrite et avide Comte Lasca, faux ami des chanteuses et des chanteurs et Antoine Minne provoque très souvent le rire en Maccario, librettiste plagiaire, puis serviteur de l’hôtel mais aussi souffleur et auteur de bruitages divers.
Malgré toutes ces qualités, on avoue rester un peu sur sa faim.
Athénée, théâtre Louis-Jouvet, grande salle.
La tournée entamée par le spectacle en septembre 2023 à Louvain en Belgique a déjà parcouru de nombreuses étapes, avant les représentations de l’Athénée Louis-Jouvet (jusqu’au 5 mai), sera au théâtre de Caen du 22 au 24 mai prochains.
Photos : © Dominique Bréda