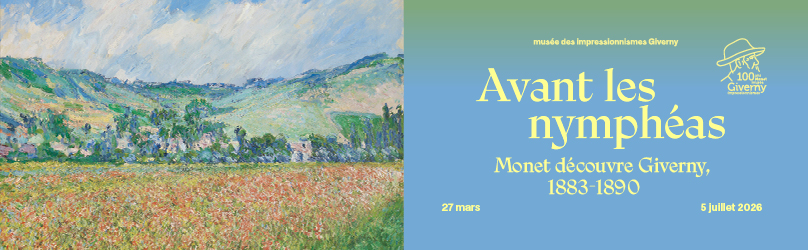Les lignes de Force(s) de Barton et d’Eyal intensifiées par le Grand Ballet de Genève
par Nicolas Villodre16.06.2024

Théâtre des opérations oblige, le « doublé chorégraphique » proposé mi-juin 2024 par le Grand théâtre de Genève en son Bâtiment des forces motrices, sous le titre générique Forces, a permis de voir ou revoir Busk (2009) d’Aszure Barton et Strong (2019) de Sharon Eyal.
Cabaret Op et hip-hop
Aszure Barton écrit dans le programme du GTG : «Je veux que les gens apprécient les êtres humains qui travaillent si dur sur scène et qu’ils quittent nos spectacles en se sentant énergisés et inspirés pour faire leur propre travail, créer leurs propres danses, se battre pour ce en quoi ils croient, sortir dans la rue et jouer et protester, ou voter». Ce rôle accordé à la danse a sans doute son actualité chez nous en période d’élections quoiqu’il contredise Benjamin Constant et Théophile Gautier, l’auteur du livret de Giselle, adeptes de l’art pour l’art. Le titre de la pièce vient du verbe espagnol « buscar » qui signifie chercher – donc expérimenter, être dans le travail en cours ou dans ce que Barton nomme le processus et de celui, anglais, de « to busk » (faux-ami de « débusquer »), qui veut dire se produire dans la rue, hors scène, hors sentiers battus, comme les chanteurs qui font la manche et, à leurs débuts tout au moins, les chorégraphes postmodernes.
D’où, sans doute, l’hommage au musicien underground Moon Dog – à l’instar de celui d’Olivia Grandville dans sa pièce À l’ouest (2019). D’où un côté désuet de l’opus, formé d’une suite de numéros ou de tableaux circassiens (acrobatiques), oniriques (cf. les cagoulards de danses urbaines et les capucins en noir et blanc droit issus du Pendule de Foucault d’Umberto Eco), inspirés par l’Op Art, rappelant ceux d’Alwin Nikolais, de Moses Pendleton (Momix et Pilobolus), Andres Bossard, Bernie Schürch et Floriana Frassetto (la troupe suisse Mummenschanz). Aszure Barton a développé dans cette œuvre emblématique, transmise par Jonathan Alsberry aux danseurs du ballet du GTG «un langage chorégraphique qui à la fois respecte et déconstruit les formes classiques et contemporaines».
Automates ambulatoires
Par la magie de l’électronique, l’alchimie du mixage ou un simple effet «cabalistique», le compositeur Ori Lichtik convertit les mots en phonèmes, et ceux-ci en sons abstraits, en rythmes et musique de danse, donnant le top départ au perpetuum mobile de Sharon Eyal cho-chorégraphié par Gai Behar. Le ballet a rarement fait corps comme dans cette pièce, désormais classique, sobrement intitulée Strong. Les infatigables interprètes le constituant ont pour noms Yumi Aizawa, Jared Brown, Adelson Carlos, Anna Cenzuales, Zoé Charpentier, Quintin Cianci, Oscar Comesaña Salgueiro, Diana Dias Duarte, Zoe Hollinshead, Julio León Torres, Emilie Meeus, Stefanie Noll, Juan Perez Cardona, Luca Scaduto, Sara Shigenari, Geoffrey Van Dyck et Madeline Wong.
Ces Coppélia sont mu(e)s et, comme Giselle, lancé(e)s sans raison dans une longue danse de Saint-Guy, uni(e)s par de semblables poses de top models, postures provenant du voguing et vêtements – ou, plutôt, sous-vêtements – de scène, équivoques et sexy, évoluent trois bons quarts d’heure durant sur demi-pointes, suivant un ordre réglé, mais avec légèreté. Une mécanique d’horlogerie suisse, un sens du juste tempo, des accélérés et des gels gestuels ad lib, des chorus lines, des changements de direction, des hochements de tête métronomiques. Les tics et les tocs de l’automate ambulatoire que Charcot décrit comme « une impulsion à partir et aller devant soi, dans un état variable d’obnubilation de la conscience et sans but défini ».
Visuel : Stefanie Noll dans Strong de Sharon Eyal, ph. © Gregory Batardon

« Baby-Horn » de Bryana Fritz et Thibault Lac : restaurer une tapisserie par des corps dansants
par Camille Zingraff13.03.2026
→ Lire l’article

Faire entendre les silences : rencontre avec Mathieu Touzé et Yuming Hey autour du Temps fort Philippe Besson au Théâtre 14
par Camille Zingraff13.03.2026
→ Lire l’article