«Les Ardents : conte macabre» ou le mal des compagnons au théâtre du Soleil
par Julien Desneuf29.11.2025

Du 26 novembre au 14 décembre 2025, la compagnie 84 propose Les Ardents : conte macabre au théâtre du Soleil. La pièce, écrite et mise en scène par la comédienne Hamideh Doustdar, est touchante en ce qu’elle traite sobrement de pauvreté, de douceur et de folie.
Le théâtre, ce soleil
Il faut quand même du courage pour sortir avec un froid pareil. C’est en tout cas ce qu’on est en droit de se dire en marchant la nuit tombée dans la pénombre du bois de Vincennes. Mais pourquoi faire déjà ? Hier soir, alors que l’hiver battait son plein, s’y jouait un conte macabre au Théâtre du Soleil. Et, le Soleil, dans le bois, à cette heure-là, il faut bien le chercher. Parce que dans La Cartoucherie, on tâtonne un peu pour arriver au point de rendez-vous. Mais on y arrive toujours, froidement mais sûrement, comme il est convenu de dire dans ces moments-là. Alors, l’ambiance change tout à fait. Près d’un baril à feu, quelques spectateurs téméraires se réchauffent les mains en discutant gentiment, et juste derrière eux, une tente, avec de quoi se repaître, et à l’intérieur des gens qui mangent et qui boivent. Il y a aussi ceux, ne les négligeons pas, qui ont oublié d’être courageux et attendent à l’intérieur, au calme. En bref, la chaleur est là. Comme quoi…
Chacun et chacune des spectateurs et spectatrices s’installe dans la salle le moment venu. Puis, comme de coutume, les lumières s’éteignent et le silence se fait. Ils apparaissent, ils sont cinq. Pas un de plus, pas un de moins. Ils remuent, se coupent la parole : le spectacle commence. La scénographie est minimaliste, frugale en un sens. À l’aide d’un petit système de menu-fil, de poids et de poulies, des objets sont suspendus au-dessus des personnages : des tables, des chaises, des paniers avec un petit peu de vivres ou des ustensiles. Au besoin, les acteurs descendent les objets le plus naturellement du monde et s’en servent pour s’asseoir, pour manger ou pour boire. Une lumière simple, chaude et sur leur droite un musicien accompagne paisiblement leurs mouvements et leurs errances avec une guitare électrique. Le théâtre populaire dans tous les sens du terme. C’est Ariane Mnouchkine qui peut être fière.

L’affaire du pain maudit
Tout sauf une surprise quand on sait que la plupart des acteurs de la pièce ont été formés, au moins en partie, au Théâtre du Soleil. La pièce parle d’ergotisme qui, selon les termes gracieusement offerts par le dictionnaire, est une maladie affectant l’homme ou les animaux herbivores qui résulte d’une intoxication par ingestion d’alcaloïdes produits par l’ergot du seigle. Plus particulièrement d’une forme plus lente de cette maladie, gangréneuse et mortifère, qui acquerra au fil du temps le nom de «mal des ardents» ou de «feu de Saint-Antoine». Ainsi, les personnages glissent petit à petit dans la folie et la maladie, malgré leur résistance, leur vitalité, leur endurance. Ils se débattent, tout couverts de cette farine viciée qui s’éparpille partout. Doucement, sous nos yeux, ils sombrent presque sans que l’on s’en rende compte, comme Astrid, la fille de la famille, jouée par Marie Hébert, qui se prend à rêver de plus en plus loin jusqu’à perdre totalement pied.

Ce conte, car c’est un conte, s’inspire directement des événements survenus à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, en 1950, lorsqu’une partie de la population de ce petit village méridional a souffert d’hallucinations ou s’est donné la mort, à cause d’une intoxication au pain. Le pain étant la principale source de nourriture des pauvres, cette maladie fut aussi, indirectement, un mal social. L’occasion pour la pièce de porter un propos plus actuel et universel sur la sanité de notre alimentation et l’impact qu’elle peut avoir sur nous. À cet endroit, l’équipe du théâtre du Soleil a imaginé des rencontres, à l’issue des représentations, qui seront l’occasion pour le public et l’équipe de discuter de la pièce, mais surtout des sujets qu’elle porte. Des bords plateaux où interviendront des personnes de la société civile, des experts sur différents sujets : psychiatre, journaliste, historien…
Certes, il y a cette mère vaillante, incarnée par Charlotte Andrès, et ce père, pataud et touchant, joué par Arnaud Churin. Tous deux luttent admirablement par la bonhomie qu’ils inspirent contre cette tristesse qu’est la misère. Une certaine noblesse et une certaine douceur s’échappent d’eux à leur corps défendant. Ils offrent des moments de grâce bienvenue et adoucissent, le plus longtemps possible, l’âpreté de leur réalité. Néanmoins, c’est forcé, à mesure que le temps passe, l’on rigole de moins en moins, l’horizon s’obscurcit, et presque sans que l’on s’en aperçoive, à l’endroit même où nous sommes entrés pour retrouver un peu de chaleur, l’on finit par se lever, partir et peut-être même pleurer.
Visuels : Patrick Wack
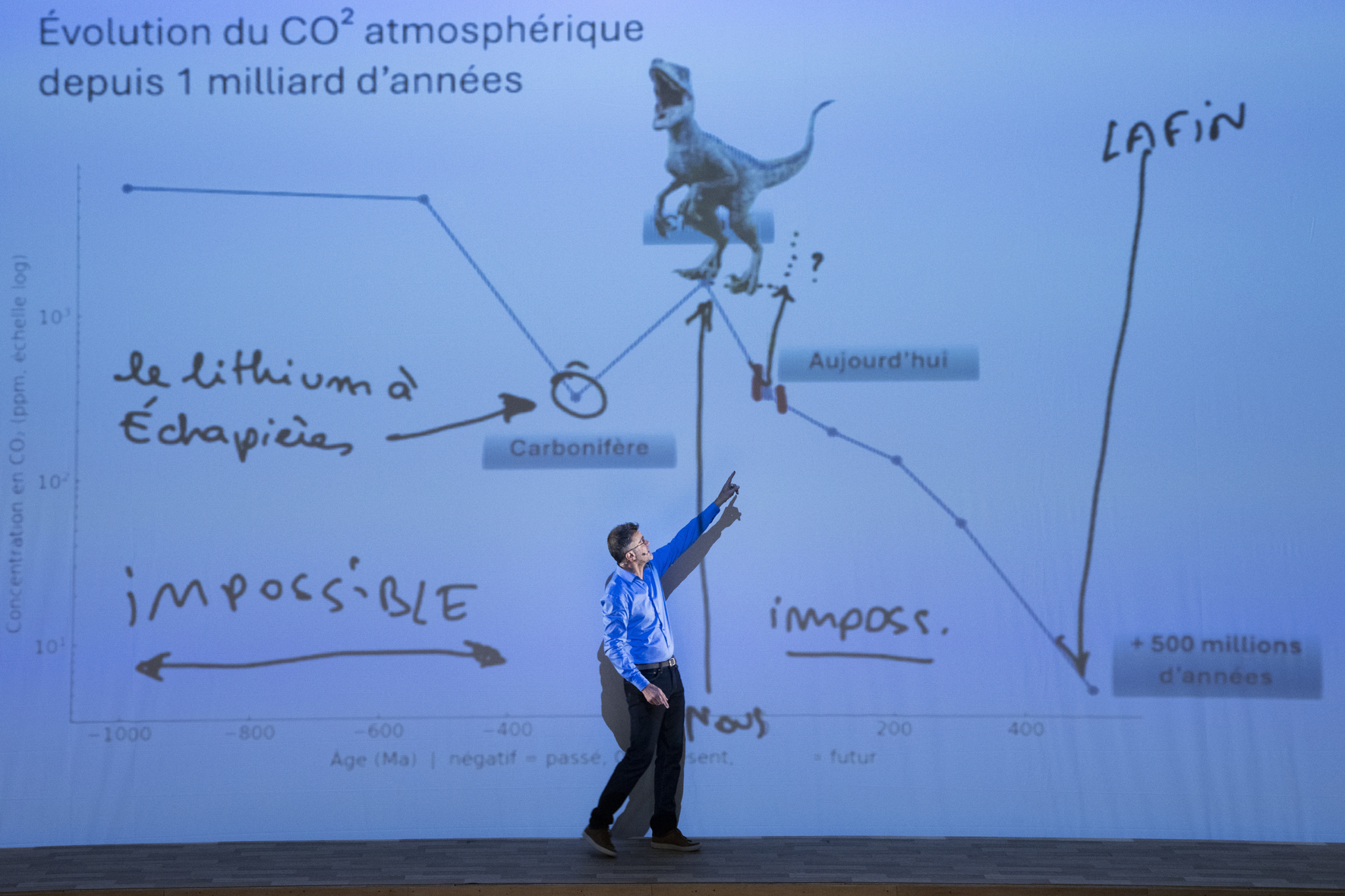
« Comment Nicole a tout pété » au Rond Point : spectacle d’intérêt public!
par Anne Verdaguer02.02.2026
→ Lire l’article

Zig Bang : homme burlesque au Théâtre d’Aperghis en amont du Festival Présences
par Yaël Hirsch02.02.2026
→ Lire l’article






