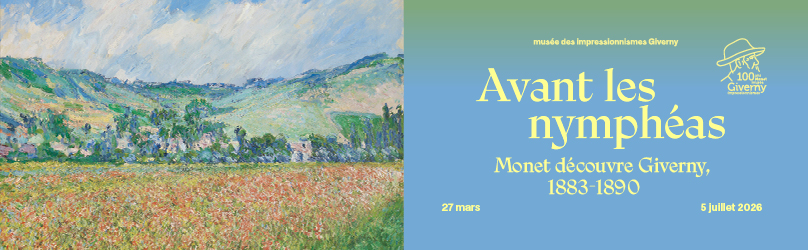« La vegetariana », expérience de dissociation
par Noé Raoulx23.01.2025

Un rêve tâché de sang et un dégoût profond de la chair ; la tâche en bas du dos, débris de naissance en forme de rose à même la peau qui s’effrite. La sœur, la femme, l’amante, tout ceci perdra sens ; il restera Yeong-hye, et son besoin inexplicable de se dénutrir. Comment doit-on vivre la dégradation manifeste d’un rôle social, et pire, celle de l’individu qui l’exécute ? Ce sont des ombres qui tracent des fleurs au pinceau, c’est une masse de patates qu’on ne pourra jamais avaler en une vie, c’est l’essor d’une femme loin des violences normatives ; c’est La Végétariana.
Sécession
Une scène dénudée, une froide inscription cinématographique sur les rebords de la maison vétuste. Rien que deux portes, deux pièces qu’on distingue à peine, trois feuilles de béton d’un gris-vert morne. Un néon unique éclaire mal cet ensemble. Le mari entre et place un matelas en piteux état contre le mur, puis se fige. Sa femme passe drapée de blanc, et déverse sur le sol carrelé un flot de côtelettes et de poissons surgelés. Dorénavant, rien ni personne ne pourra plus la forcer à toucher de la viande. Tous sans exception s’y essaieront pourtant, du père à l’époux en passant par la sœur et le beau-frère, le corps médical ultimement. Rien n’y fera. Nous assistons tous, impuissants, au départ de l’héroïne hors de son corps ; mais dans la traîne de cette sédition tranquille surgissent tous les démons des violences humaines, tous les sévices patriarcaux et normatifs, remettant en doute le bienfondé de l’inquiétude à l’égard de l’autre, de notre volonté à imposer santé et bonne humeur à nos plus proches parents.
Astreindre et sceller
A la direction de cette pièce Daria Deflorian, metteuse en scène italienne aux succès croissants depuis plus de vingt ans, couronnée dans l’intervalle de nombreux prix pour ses œuvres. Dirigeant sur les planches trois acteurs (Paolo Musio, Monica Piseddu et Gabriele Portoghese) ainsi qu’elle-même, elle s’attache à retranscrire l’insupportable mors des comportements sociaux préconçus en prenant appui sur le livre récemment orné du Nobel de littérature, La végétarienne de Han Kang. Pour
rendre compte au mieux de la gravité des sujets abordés par le chef d’œuvre, Deflorian fait le choix d’une mise en scène sobre, où la verticalité préside à l’univers. Tout y est rigide, droit (presque brechtien sur ce point), des murs aux êtres en passant par leurs mouvements. Une staticité latente fige en permanence les interprètes quand ils n’ont pas la parole, et lorsqu’ils s’en saisissent, leur torse et leur parcours semble régi par un réseau précis de filins invisibles ; les scènes sur le lit seront jouées debout, le dos appuyé contre un matelas placardé en parallèle du bloc de pierre où il repose. Tout l’enjeu du texte sera au demeurant de démontrer l’incapacité de l’homme à s’adapter à des normes qu’il s’est lui-même infligé ; les pensées des personnages, leurs commentaires sur la situation (qui constituent la chair des paroles transmises) sont énoncés par eux à la troisième personne, les
dépossédant de leur identité jusqu’au sein de leur crâne. La longue quête de Yeong-hye devient alors également celle d’une parole nouvelle, d’une voix intérieure muette, régie par le rêve et la beauté, l’image, séparée de toute violence que son corps a pu
subir en refusant de la nommer. Le texte suggère d’ailleurs une transmission progressive de cette libération à la parole des autres personnages…
Notre étrange position
Il est assez difficile de regarder la scène dans les yeux (et ce n’est pas uniquement dû aux sur-titres placés en hauteur). La violence y est crue, sèche, explicite, accentuée par l’esthétique d’immobilité. On assistera à plusieurs descriptions brutales de scènes dont le surréalisme et l’onirique déteindront progressivement vers une expérience concrète et douloureuse ; scène de gavage, de viol. L’omniprésence des violences subies par l’héroïne sous prétexte de soutien ébranle ; cependant un traitement très original nous mène à prendre en empathie leurs auteurs, à concevoir leur point de vue, la difficulté que nous aurions dans leurs semelles à influer sur un être aimé qui se laisse peu à peu dépérir. Les plus difficiles, celles commises par les hommes, père et mari, sont sans doute le fruit naturel d’un arbre malade : Deflorian appuiera son intention de ne pas représenter d’hommes profondément mauvais, qu’ils soient au contraire les plus ordinaires possible. Il s’agira de fait de mettre en exergue le noyau pourri de la famille nucléaire, la profonde inadéquation du rôle de femme et mari à quiconque. Dans l’esprit du Shakespeare de Beaucoup de bruit pour rien, c’est peut-être par sentiment d’un devoir de conservation des normes, par ignorance d’un possible dépassement, que les protagonistes s’adonnent à ces actes. Ceci dit, l’atmosphère de la pièce est résolument étouffante, et il est très douloureux d’être invité si directement à y prendre part. L’ensemble est perceptible comme un long et consciencieux éloignement pour le rôle-titre, un prise de distance pas à pas hors de ce carcan qui ne connaît pas de limite tant que sa manifestation corporelle subsiste.
Fleurir la carcasse
Le pendant principal des rudesses a trait à la chair ; forcer le corps de l’autre, briser les barrières qu’il oppose à la manière de la bouche qui reste close devant un bout de jambon. Cependant, l’un des personnage perçoit différemment la détresse de Yeong-hye ; l’artiste. Il cristallise toute la beauté du texte et sa dangereuse ambivalence : figure presque allégorique, d’une extrême fragilité, il est impropre au rôle social en ce qu’il ne gagne pas d’argent et se consacre exclusivement à ses projets. Et pourtant, trop propre à son rôle de personnage masculin, il ne sait trouver d’alternative à un désir bassement sensuel pour s’approprier toute la beauté qu’il conçoit dans la fragilité sœur de l’héroïne. Sentient mais incapable de comprendre pleinement, il est condamné comme on aurait pu l’attendre à la même incompréhension par ses pairs et se détache peu à peu de sa propre image établie d’artiste intellectuel, à projet, pour tomber dans un art pur et immédiat, plein. Questionner l’usage de l’art et démontrer ainsi son inaptitude à soigner le beau lui-même, à influer sur l’univers qu’il effleure pourtant mieux que quiconque entre en pleine résonance avec la figure énigmatique de l’héroïne. Elle qui semble liée intimement au monde par ses rêves mystiques, elle qui sera la première à retrouver la dimension horizontale des fous et des macchabés, des animaux, à mettre la tête en bas comme les arbres pour grandir vers la terre, la prophétesse semble malgré tout résolument incapable de concilier sa nature humaine avec l’univers qui agit sur elle ; il faudra fuir le corps, le réduire pour n’être plus qu’un amas de matière essentielle. Arracher par plaques immenses tout le superflu que la pensée aura ajouté, arracher la chair qu’on aura gavé de protéines issues de violences, bleuie par les violences avant elles.
Somme toute une pièce d’une richesse extraordinaire malgré son sujet obsédant et unique. Le texte est particulièrement beau, l’œuvre littéraire n’a en rien disparu en se cachant sous les planches. Cependant il était assez difficile d’englober pleinement l’ensemble des esquisses tant elles sont nombreuses et doivent combattre le va-et-vient de nos yeux entre la scène et son surtitre. Blâmons Babel pour ce problème qui ne relève en rien de la mise en scène, mais soulignons qu’il vaut mieux s’accrocher à
son siège pour ne rien rater (vous pouvez vous y rendre les yeux fermés si vous êtes italophone (ouvrez les quand même quand la pièce commencera)). Reniez les contraintes de la langue et observez sous vos yeux s’éteindre celles des hommes ; jusqu’à preuve du contraire, être végétarien n’a jamais tué personne…
Retrouvez la compagnie au théâtre Garonne jusqu’au 24 janvier, puis en tournée :
28.01 — 2.02 Teatro Astra, TPE, Turin
5.02 — 6.02 Théâtre Charles Dullin, Chambéry
10.02 — 12.02 Théâtre la Vignette, Montpellier
Visuel : © Andrea Pizzalis 07 (Monica Piseddu)

Poulenc et Escaich, tragédies intimes au Théâtre des Champs-Élysées
par Thomas Cepitelli14.03.2026
→ Lire l’article

« La Gueule ouverte » donne corps et voix à la violence incestueuse
par Julia Wahl14.03.2026
→ Lire l’article