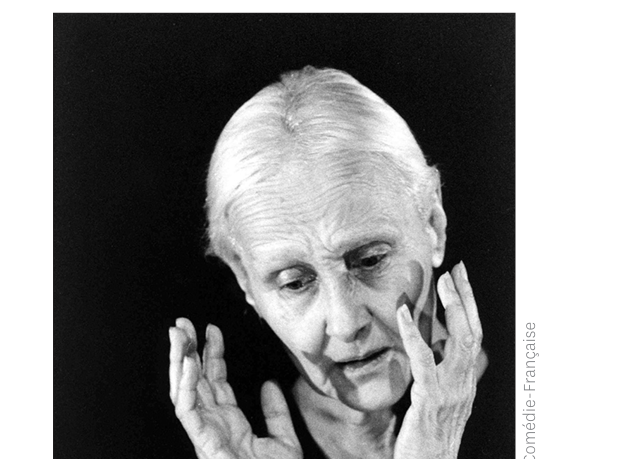La « Giuditta » de Weitz, classique…et poussiéreuse
par Camille Zingraff15.05.2025

Franz Lehár, un des derniers maître d’opérette viennois, rend en 1934 sa dernière œuvre scénique, Giuditta. La musique, avec ses profondeurs et ses nuances, porte un récit dramatique et sublime. Pierre-André Weitz reprend cette œuvre majeure à l’Opéra National du Rhin, dans une scénographie classique mais aux costumes et scènes de groupe puissantes. Néanmoins, les choix de jeux et de mise en scène restent poussiéreux et s’inscrivent dans une double colonisation de l’espace et des corps.
De la Giuditta de Lehár…
Œuvre singulière et ambitieuse, Giuditta se situe à la croisée de l’opérette et de l’opéra. L’intrigue suit Giuditta, femme mariée qui abandonne tout pour suivre Octavio, jeune officier dont elle tombe amoureuse – plus de l’ailleurs qu’il incarne que de sa personne. Lorsqu’il la quitte, elle devient chanteuse de cabaret, puis courtisane. Leur relation tragique, marquée par la fuite, le renoncement et la domination, place Giuditta au cœur d’un récit d’émancipation empêchée.
Dans Giuditta, l’orchestre est un acteur en tant que tel et porte le récit aussi bien qu’il l’incarne et l’élève – ce que réussit à merveille l’Opéra symphonique de Mulhouse, dirigé par Thomas Rössner, pour cette version. La volonté de Lehár d’un orchestre symphonique rapproche Giuditta du grand opéra, pour l’éloigner de l’opérette et placer cette œuvre à l’intersection de plusieurs inspirations. En effet, l’influence de l’entre-deux guerres installe cette pièce dans un entre-deux artistique qui, comme le précise Thomas Rössner « doit autant, si ce n’est plus, à Puccini qu’à Johann Strauss ». De plus, Lehár, qui caractérise cette œuvre de « comédie en musique », réussit avec brio ce mélange entre le répertoire théâtral de la comédie et les codes de l’opéra.
…à la Giuditta de Weitz
Dans sa mise en scène, Weitz déploie une scénographie en trois temps : un cirque grotesque, un Maroc sur fond de colonisation française à peine dénoncée, puis un cabaret décadent. Chacun de ces lieux incarne à sa manière une forme d’enfermement ou de spectacle du corps.

Néanmoins, si les caractéristiques de la Giuditta de Lehár étaient innovantes et contemporaines pour l’époque, elles peinent à briller et à résonner pleinement dans la mise en scène de Weitz. Classique, la mise en scène nous replace dans un contexte socio-politique mais aussi économique complexe, qui se traduit sur scène par une reproduction des oppressions bourgeois.e.s qui vont au cirque voir des attractions humaines. D’une personne naine à des femmes siamoises lors du premier tableau circassien, en passant par des travailleuses du sexe complètement érotisées dans leur condition forcée et une femme caricaturée en hystérique supposée être loufoque lors du tableau cabarétique, les clichés sexistes, racistes, validistes et classistes vont bon train. Ainsi, toutes les problématiques contemporaines, que certain.e.s protègeront d’un « de nos jours, on ne peut plus rien dire », sont exposées et remises en lumière. Mais au profit de qui ?
De plus, les cabarets des années 1930, qui résonnent en contre-point des freak show circassiens, avec les freak off américains font un écho dissonant à l’ouverture du procès de P.Diddy. Si ce hasard est malencontreux, mettre en valeur ces fêtes dont découlent des violences multiples et abjectes, est, en soit, dérangeant. Si Weitz installe un malaise certain, ces stéréotypes ne sont jamais contredits ou complexifiés par une ironie visuelle, un second degré ou une distanciation dramaturgique qui en dénonceraient les ressorts. Ces représentations restent incarnées sans pour autant être dénoncées.
Giuditta désincarnée
De la cage dorée – littéralement -, à une prison à ciel ouvert créée par Octavio, l’itinéraire tragique de Giuditta est créé, modelé et raffermi par les oppressions des hommes qui gravitent autour d’elle au point de l’étouffer.
Personnage féminin en quête de liberté, l’espace artistique, théâtral et cantatoire du rôle est immense pour faire vivre ce désir de liberté et cette volonté intime de s’émanciper par ses choix et ses désirs propres. Cependant, cette dernière est dépeinte en une femme à la beauté fatale, tentatrice, qui trahit et amène les hommes vers le mal. Si elle chante pour une liberté qu’elle rêve bleue, lointaine et emplie d’amour, la nécessité vitale de cette liberté n’apparaît ni dans son chant, ni dans ses danses.

En effet, la jeune femme n’existe jamais pour elle-même au plateau. Si Melody Louledjian peine à donner du coffre et du corps à son personnage, sa liberté d’actrice elle-même semble restreinte dans ces dessous en dentelle – costumes communs à tous les personnages féminins – et de mouvements ostentatoirement sensuels et érotisés – des jeux de bras fluides, des mouvements de hanches lascifs, sans aucun espace réel de mouvement libéré.
De fait, Giuditta, recréée en 2025, n’appellerait-elle pas un regard contemporain, qui, sans changer l’histoire, bousculerait les codes pour redonner toute sa valeur à l’histoire et aux personnages ? Si dans l’histoire, chacun se fait sa Giuditta, Weitz lui-même semble être tombé dans cet écueil de désir d’une figure insaisissable, aussi opératique soit-elle.
visuel : ©Klara Beck
Giuditta jusqu’au 03 juin en Alsace, billetterie.
Distribution
Direction musicale : Thomas Rösner
Mise en scène, décors, costumes : Pierre-André Weitz
Chorégraphie : Ivo Bauchiero
Lumières : Bertrand Killy
Chef de Chœur de l’Opéra national du Rhin : Hendrik Haas
Les Artistes
Giuditta : Melody Louledjian
Anita : Sandrine Buendia
Octavio : Thomas Bettinger
Manuel, Sir Barrymore, son Altesse : Nicolas Rivenq
Séraphin : Sahy Ratia
Marcelin, l’Attaché, Ibrahim, un chanteur de rue : Christophe Gay
Jean Cévenol : Jacques Verzier
L’Hôtelier, le Maître d’hôtel : Rodolphe Briand
Lollita, le Chasseur de l’Alcazar : Sissi Duparc
Le Garçon de restaurant, un chanteur de rue, un sous-officier, un pêcheur : Pierre Lebon
Chœur de l’Opéra national du Rhin, Orchestre national de Mulhouse

Emma Dante, Molière, « Les femmes savantes » et La Comédie Française : le plaisir à l’état brut
par Thomas Cepitelli16.01.2026
→ Lire l’article

Au Liceu de Barcelone, Lise Davidsen d’ores et déjà au tableau des grandes Isolde du XXIe siècle
par Paul Fourier15.01.2026
→ Lire l’article