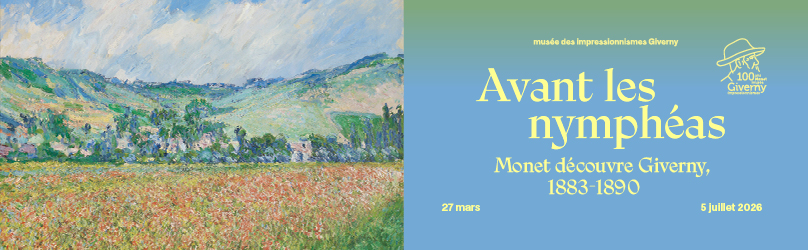« Rêche », l’amas angélique de Myriam Gourfink au Panthéon
par Amélie Blaustein-Niddam26.09.2024

L’iconique chorégraphe de la lenteur s’empare du cœur du Panthéon pour le faire battre encore plus fort. Rêche est une composition pour un groupe de sept danseurs et danseuses qui n’a rien d’aride.
Se poser
Kasper T. Toeplitz se tient comme toujours derrière sa table. Il s’apprête à manipuler une basse électrique. Il accompagne le travail de Myriam Gourfink depuis les premiers jours. Sa musique est de la noise douce. Face à lui se tient Didier Casamitjana entouré de percussions qui seront vibratoires. Tous les deux ont derrière eux deux des œuvres en verre et en métal d’Anselm Kiefer qui chacune accueille une sculpture dont les matériaux (barbelés, plomb, fumier d’âne, etc.) évoquent la réalité des combats de la Première Guerre mondiale. Entre ces deux blocs incarnés par ces deux musiciens, il y a un vide très plein. Entouré·e·s des colonnes corinthiennes, Esteban Appesseche, Suzanne Henry, Noémie Langevin, Deborah Lary, Matthieu Patarozzi, Annabelle Rosenow et Véronique Weil entrent un·e par un·e. Chacun·e s’approche du centre de l’espace, là où les motifs marquent un cercle et s’y allonge. La première se couche sur le flanc, la deuxième sur le dos, les suivant·e·s se posent en prenant appui sur les autres. Et c’est là que l’écriture de base de Rêche se révèle à nous : il ne s’agit « que » de prendre appui sur l’autre.
Soutenir
Dans ses pièces, Gourfink n’a qu’une ligne de conduite qui prend différentes formes. Elle étudie les contractions possibles du corps rencontrant la pression de l’air qui l’entoure. Comme dans Structure Souffle (2021) Gris (2016), ou Amas (2015), l’espace de la danse est restreint. Chaque élément du corps va se nicher dans un autre et l’ensemble devient comme un mikado chorégraphique. Si l’un·e lâche, même si tout se passe au ralenti, la chute est assurée, comme celle des anges. Ils et elles sont aussi des fantômes, des âmes vivantes, tout ça à la fois. En revanche, ils et elles forment un seul bloc, un bloc interdépendant où la confiance et l’écoute de l’autre dans ses moindres détails sont la clé.
S’élever
Techniquement, la pièce est à couper le souffle. Tout n’est que posture en constante évolution, extrêmement lente. Les images subjuguent. Il y a cette étreinte qui met un temps fou à advenir, deux corps qui se tournent l’un vers l’autre, l’un qui tend ses bras et les ouvre jusqu’à enrouler le dos de l’autre. Le geste qui paraît si naturel devient ici un acte fort. Ce n’est pas rien d’enlacer quelqu’un. Les portés aussi prennent l’allure d’envols. On retient le geste de cette danseuse qui s’étend comme un arc en étant juste tenue par la voûte plantaire d’un autre dans son dos. Si la voûte flanche, le monument tombe. Rêche cultive les verbes : tenir, aider, soutenir, s’appuyer, cambrer, lever, enlacer, toucher. La pièce est une sorte de huis clos tant la masse que forme ce groupe de sept reste dense, pas toujours dense, mais cette masse tend à l’amas indivisible. Qu’est-ce qui les relit, ces interprètes entre eux ? Seul·e·s les très people résident·e·s du Panthéon le savent.
Jusqu’au 28 septembre au Panthéon, dans le cadre du Festival d’automne et de la programmation de l’Atelier de Paris CDCN.
Visuel : DR

« Come Back Again », Doris Uhlich essentialise Susanne Kirnbauer en ouverture d’Ardanthé
par Amélie Blaustein-Niddam11.03.2026
→ Lire l’article

L’art de vivre de Clédat & Petitpierre au Festival DañsFabrik
par La redaction10.03.2026
→ Lire l’article