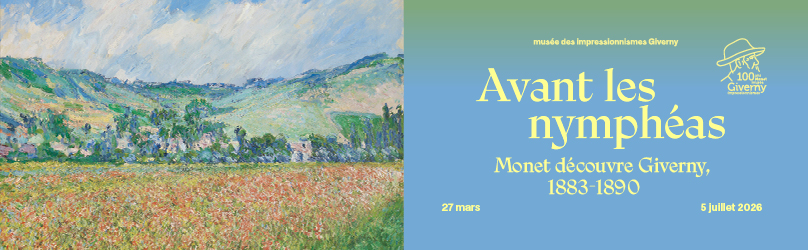« Nous le radeau » : création extatique et totale, voyage au cœur du magma humain
par Bérénice Clerc10.12.2024

Jeudi 7 décembre 2024, le soleil caressait le ciel parisien le matin avant de plonger sous la fine pluie grise d’un automne à vivre. Nous le radeau, création extatique et totale, va bouleverser la soirée des spectateurs réunis pour ce beau voyage au cœur du magma humain où son, images, mouvement et danse s’entrelacent pour vivre et mourir en un même souffle. Dès l’entrée dans le hall de La Philharmonie, une œuvre musicale, plastique et lumineuse annonce le voyage. Les spectateurs s’installent, un danseur, vêtu de noir, est seul sur scène, au milieu d’une scénographie multiple. Il danse, tourne, virevolte au son d’une musique que certains qualifieraient de contemporaine.
Les spectateurs, comme souvent, se lancent dans un pré-concert de toux diverses et variées, se répondant d’un bout à l’autre de la salle. Franck Krawczyk pourrait les intégrer à sa composition. La lumière de la salle s’assombrit petit à petit, la scène devient le centre.
L’entrée dans l’univers de cette création, adaptation musicale de Franck Krawczyk et la conception, chorégraphie d’Emio Greco et Pieter C. Scholten, n’est pas si simple ; elle se déroule par couches, comme si des voiles d’appréhensions se levaient en nous pour nous permettre de nous immerger totalement dans cette matière artistique totale.
Une fois aspirés dans ce radeau, plus rien ne nous empêchera de vivre chaque son, chaque respiration, chaque note, chaque souffle, chaque mouvement comme le nôtre. L’humanité peut naître face à nous, nous attraper comme un morceau d’elle, ou se laisser croire à l’illusion vaine d’être la transcendance de l’Homme, la version passive qui peut aisément remettre en question les humains en action.
L’entrée des chœurs, Ensemble vocal du conservatoire à rayonnement départemental de Pantin, Chœur philharmonique du COGE, Ensemble vocal du COGE, à cours et jardin du premier balcon, est une première claque de réel.
L’œuvre fait référence à la frégate Méduse.
Théodore Géricault plongea dans la folie pour cette œuvre gigantesque, des cadavres jonchant son atelier. Il voulait donner à voir le réel de l’atmosphère régnant sur l’embarcation.
Combien de radeaux, combien d’embarcations de fortune partirent à mille sur un esquif, et sans prompt renfort, arrivèrent sur des côtes non accueillantes à moins de dix ? Le corps brûlé par un soleil déchirant, rongé par le sel et l’eau de l’océan, après avoir vu mourir ses enfants, sa famille, et l’océan comme sépulture inacceptable. Devoir prouver sa minorité, dormir sur un carton en proie à de violents cauchemars et délires, tout aussi puissants qu’une réalité altérée par les drames répétés, puis parfois réussir à trouver une résilience et construire une vie sur le chaos…
De l’espoir total d’une terre promise naît l’horreur de la nuit éternelle de la vie, quand tous les nôtres sont morts : pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi nous ici, et eux nulle part ?
Ce spectacle est un chaos au sens le plus noble du terme, le chaos qu’il faut pour que la vie naisse : le chaos de l’injustice, le chaos de nos vies individuelles et collectives, le chaos que nous expérimentons tous, à petite ou grande échelle. Nous marchons au bord de la chute, nous tombons, nous nous relevons, certains ne se relèvent pas. Certains quittent le radeau de la vie sans raison, d’autres tombent comme au Bataclan, avec l’image du riff de batterie et ses corps au sol, illuminés de rouge.
Les danseurs de la compagnie ICK Dans Amsterdam se perdent, apparaissent comme des ombres fantomatiques au loin, sont seuls, ensemble, avec la musique, contre elle, s’étreignent, tombent, se relèvent ; un mouvement quasi perpétuel, animal, humain, actif et passif. Une IA modifie le son de la musique en fonction de leur mouvement.
Les solistes sont la chair de l’homme, épaisse, sèche, souple, rigide. Sonia Wieder-Atherton danse avec son violoncelle, un duo fusionnel caché sous un voile de lumière, puis, comme perdue sur un if, elle avance sur un radeau, esseulée. Elle enveloppe le monde de ses notes caressées, piquées, déchirant le silence laissé par le doute sur l’existence de Dieu, qui, tel qu’il est décrit, ne pourrait pas laisser le monde se noyer dans sa violence.
La clarinette de Carjez Gerretsen démultiplie l’espace. Le temps disparaît, et le musicien devient une figure christique, ces sept derniers sons avant de tomber produisant des images somptueuses qui saisissent les spectateurs. Le piano de Wilhem Latchoumia est un radeau porteur sur le radeau de l’œuvre ; ses sons puissants éclatent en textures multiples. Leur virtuosité est si bien servie.
Le voyage musical orchestré par Franck Krawczyk est un fil tendu sur un espace vide, en équilibre ; jamais il ne chute. La traversée est remuante, avec des évocations, des effleurages comme des apparitions de nos univers classiques que tout le monde connaît, parfois sans même savoir qu’il s’agit de Michael Gordon, Ludwig van Beethoven, Heinrich Schütz, Arnold Schönberg, Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Gustav Mahler et tant d’autres. Comme si nos vies étaient là, livrées en images sonores, comme In utero, où un bébé découvre, via le prisme placentaire, les sons écoutés par la personne qui le porte.
Le boucan de Benjamin Munier à la basse et Raphaël Aboulker à la batterie explosent comme un feu crépitant, ardent. La musique populaire explose, elle n’est pas là juste pour être placée sans réflexion. Elle sculpte la toile sonore, semblable à nos veines, crée des ponts entre les temps, les continents, les cœurs qui battent d’un corps encore plus fort, à s’en déchirer la poitrine.
La scénographie précise et démultipliable, les lumières, tout participe à cet art total. Le travail de chacun et de tous est inimaginable, comme seul l’art peut le produire.
Visuel :© Alwin Poiana

« Come Back Again », Doris Uhlich essentialise Susanne Kirnbauer en ouverture d’Ardanthé
par Amélie Blaustein-Niddam11.03.2026
→ Lire l’article

L’art de vivre de Clédat & Petitpierre au Festival DañsFabrik
par La redaction10.03.2026
→ Lire l’article