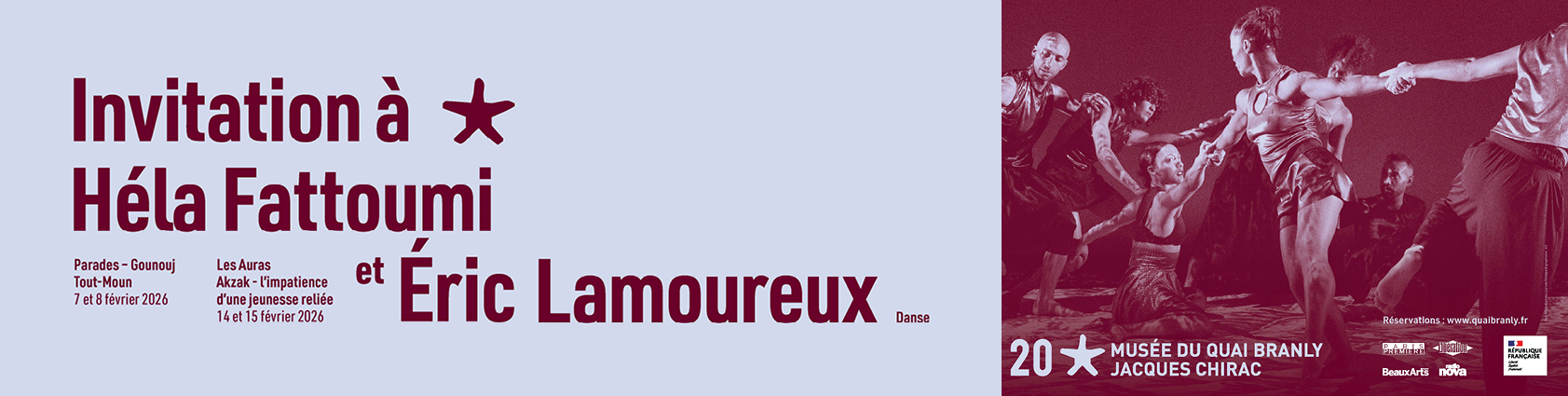Nager, plonger, bousculer – Une grammaire de la violence dans « Ophelia’s Got Talent » de Florentina Holzinger
par Beatrice Lapadat07.07.2025

Connue pour ses spectacles déployés dans un cumul de surenchère, de prise de risque et de pratiques corporelles extrêmes, Florentina Holzinger revient à la Grande Halle de La Villette avec « Ophelia’s Got Talent ». En partant des stéréotypes culturels occidentaux, la chorégraphe autrichienne explore une série de figures féminines mythiques et littéraires liées à l’espace aquatique, plaçant sa dramaturgie à l’intérieur d’une simulation de talent show. Fervente défenseure de la liberté de création, Florentina Holzinger a livré aussi un discours percutant à ce sujet depuis la scène de La Villette le soir de la première parisienne.
Une violence revendiquée et assumée
À partir de combien d’actes d’automutilation, de souffrance extrême et d’expositions à des risques outrageux un corps féminin peut-il se transformer en sirène ? À partir de combien de centaines de bouteilles en plastique envahissant la gigantesque piscine sur le plateau peut-on espérer que l’homme prendra conscience du fait que les océans doivent appartenir aux espèces qui les peuplent ? Et à partir de combien de litres d’eau peut-on s’imaginer métamorphosé.e.s en fluides soustraites à toute violence
surgissant d’une autre source que son propre corps ? Après « Tanz », spectacle ravageur et cruel dans le sens artaudien du terme, présenté à La Villette en décembre 2023, Florentina Holzinger et son équipe de performeuses sont de retour au même théâtre pour présenter « Ophelia’s Got Talent », performance-marathon dédiée à l’eau et à son « caractère mystérieux, menaçant, parfois violent », comme le souligne la chorégraphe autrichienne.
Souvent associée aux actionnistes viennois en raison de son esthétique radicale et d’un usage du corps qui ne craint aucun excès et effet spectaculaire, Holzinger affirme vouloir porter sur scène « un corps libre, qui s’exprime sans contrainte ». Sur scène, tous les dispositifs indiquent un potentiel violent et menaçant pour l’intégralité corporelle des treize artistes féminines ; en fin de compte, tout se joue dans la manière dont les performeuses détournent ces potentialités destructrices pour atteindre plaisir, extase, jouissance et métamorphose. Les deux aquariums présents sur l’aire de jeu configurent un espace mythique, hors de ce monde, pendant que la piscine opère, entre autres, comme liant entre l’actualité et les codes de l’espace fictionnel. Les écrans placés des deux côtés de la scène, marque distinctive de la dramaturgie holzingerienne, créent une sorte de malaise – pourtant inévitable, voire indispensable dans ce type d’expérience théâtrale – mais aussi une forme d’intimité difficilement atteignable autrement dans cet espace où tout se déploie à vaste échelle. Malgré la présence impressionnante des outils scéniques qui annoncent la violence, ce sont bien les corps féminins qui la génèrent et l’absorbent sous de nombreuses formes. Une manière de dire – encore et encore – qu’ici la violence physique est choisie, contrôlée par les femmes elles-mêmes, célébrée et désirée tout au long de cette traversée baroque d’acrobaties, cascades, funambulismes, body art et tant d’autres images sorties tout droit d’un freak-show « interminable ».
« I’m your biggest fan » – La téléréalité comme miroitement de l’histoire
du théâtre
Et ce n’est pas dans n’importe quel cadre que cette violence surgit de ces corps hors-normes : il s’agit, comme le titre l’indique, de la simulation d’une émission de télé-réalité du type talent show, présidée par une pirate au rire agressif, désinhibée et aux tendances compulsives. Les juges – encore plus excentriques et imprévisibles dans leur posture et discours que les candidates – enchaînent leurs verdicts entre appréciation exacerbée, ironie, cruauté et ambiguïté. Volontairement assujetties aux jugements de leurs consœurs assises sur les chaises investies de pouvoir, les concourantes ne lésinent pas sur les moyens les plus saugrenus pour impressionner : en voici Fibi Eyewalker, l’avaleuse de sabres qui nous fait connaissance avec ses organes vus de l’intérieur grâce à une caméra insérée dans sa gorge, Sophie Duncan dont les acrobaties génèrent un type d’érotisme qui ne peut naître qu’à la conjonction du corps avec la mort et le risque extrême, ou Xana Novais qui se perce les joues avec un crochet pendant qu’elle déclare avec sérénité qu’elle est « le poisson que j’ai moi-même attrapé. »
Ce qui au début pourrait être lu comme une simple parodie d’un show de télévision superficiel et à la recette facile s’avère être une adoption festive et assumée de ces codes compétitifs, en y insérant une panoplie de références érudites qui se greffent néanmoins organiquement à cette proposition théâtrale-chorégraphique particulièrement hybride. Au fond, n’est-ce pas un défilé similaire à celui qu’englobe l’histoire occidentale des arts de la scène, avec ses créateurices qui se sont efforcé.e.s, au fil des siècles, à impressionner et convaincre critiques et spectateurices pour se forger une place dans le canon et dans la mémoire de l’art théâtral ou chorégraphique ? Tout comme dans « Tanz », l’irrévérencieuse Holzinger fait confronter le public à une sorte d’histoire parallèle de l’art occidental, proposant une réflexion peu commode sur ce qui est accepté comme digne ou non d’être montré sur scène et sur la constitution et la destitution des canons artistiques.
Et le public épaule véritablement ses favorites – l’on fait preuve de peur et de compassion lorsque le pacte fictionnel est suspendu, pendant quelques instants, dans nos cerveaux qui veulent que personne ne soit blessé ou mis en danger « pour de vrai » – notamment dans la scène de la plongeuse ligotée, « formée à l’évasion », qui simule un malaise et brouille ainsi, très tôt dans le spectacle, les frontières entre danger réel et danger surveillé et contrôlé. Il est donc judicieux d’affirmer que l’émergence de la compassion à l’intérieur de ces nouvelles conventions cathartiques consacre une nouvelle réussite, tant artistique que sociale, de Florentina Holzinger. La pitié, la solidarité, le désir de voir les artistes réussir ne sont plus strictement l’apanage d’un divertissement mièvre et sentimental ; ces états affectifs font leur beau retour au théâtre et l’on se sent tout à fait légitimes à les subir et à les laisser faire leur effet.
La joie du kitsch gratuit
Un tel enchaînement d’effets de choc et de sensations corporelles perturbantes ne serait pas envisageable de la même manière sans ce mélange assumé de genres musicaux, dont les horizons se déplacent entre le techno et Schubert, en passant par la variété allemande et le dance-hall, d’expressions corporelles qui, encore une fois, explorent avec tout autant de volupté le ballet comme le tissu aérien – transformé par Holzinger et l’artiste en question à leur façon – et de genres spectaculaires fluctuant entre divertissement, sport extrême et moments opératiques. La chorégraphe convoque sur scène des références savantes jumelées à des références issues de la contre-culture pour célébrer la gratuité du kitsch et de la violence, dans une dramaturgie où l’économie lisse, sage et équilibrée des moyens esthétiques et performatifs est abolie pour accueillir une véritable orgie de l’hybride et de la démesure. Une orgie littérale, comme le montre de manière si plastique la scène de jouissance avec les corps nus accrochés à un géant hélicoptère éjaculateur. Dans la scène de Mélusine, une performeuse déclame : « C’est beau, mais aussi dégoûtant » – on ne saurait mieux décrire l’univers de Florentina Holzinger, dont l’empouvoirement passe forcément par une prise de conscience perpétuelle par rapport à la manière dont le corps le plus puissant est le corps le plus proche de la mort et de la décomposition.
L’eau et les avatars subtils de la violence
Si la présence de l’eau qui remplit les trois bassins sur scène peut fonctionner comme contrepoint face à la composante plus déjantée du spectacle, elle n’est pourtant pas moins évocatrice de la violence, bien qu’à la différence des épées, du feu et des crochets, le liquide n’en laisse pas de traces. Dans ce territoire où la transparence des eaux nous permet d’y saisir autrement les blessures et les marques corporelles, se démarquent de nombreuses figures féminines associées à l’eau dans la culture occidentale. La mystérieuse Mélusine, les sirènes et les ondines sensuelles et, bien sûr, l’immanquable « Ophélie, espèce de nymphe » shakespearienne trouvent dans l’eau un safe space où la radicalité du corps n’exclue plus le repos, « la pureté et le calme ». L’eau est une « invitation à mourir », mais aussi une plate-forme narcissique – elle est par ailleurs doublée par la présence de miroirs ovales – ce qui s’avère pourtant rédempteur dans ces profondeurs à un moment donné trop dures à supporter. Léda raconte son vi*l allongée sur une structure placée dans la piscine, spéculum à l’intérieur et trauma à l’extérieur. Florentina Holzinger donne elle-même vie, en allant à l’encontre des indications d’Inga Bausch, qui émet un discours patriarcal, à une Ophélie qui refuse d’être tragique et poétique, préférant rester ancrée dans une sorte de force sportive.
Tous ces tableaux bâtissent un parcours qui mène à une métamorphose finale, au prix d’une traversée agonisante des eaux maintenant ensanglantées, comme dans un tableau apocalyptique. Des menaces spectrales sèment la terreur dans le ventre d’une femme enceinte et violentent les queues des sirènes dont le rapprochement avec la mort semble inévitable. C’est dans cette ambiance qui vire à la destruction et à la torture que six petites filles à profils divers viennent sauver les créatures aquatiques, dont la piscine aura entre-temps été envahie de centaines de bouteilles en plastique. Ce qui fut une fois une étendeur de projections fictives et mythiques se voit maintenant réduit à une sordide surface détruite par l’espèce humaine. Tout comme Ophélie, les enfants incarnent non tant l’innocence, mais plutôt la promesse d’une vitalité renouvelée qui risque de bousculer la planète « hors de ses gonds », pour revenir à une expression shakespearienne, afin d’en faire une moins assujettie à la violence humaine. La présence des enfants dans « Ophelia’s Got Talent » est un nouvel exploit pour Florentina Holzinger : sans être ni sentimentale ni cynique, elle leur trouve une place parfaitement cohérente et élaborée pour raconter son allégorie écologique en plein milieu d’un espace de débauches, de risques et de plongées dans tous les extrêmes physiques et symboliques.
Censure et combat : la liberté artistique sur scène, 20 ans après Avignon
2005
À la fin de première parisienne qui a eu lieu le 30 juin, Florentina Holzinger a pris la parole, entourée par ses Ophélies en colère, pour parler de la censure dont l’équipe d’artistes-femmes aurait fait l’objet en France, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres endroits, comme le Volksbühne Berlin, lieu de naissance du spectacle. En cause, la présence des enfants sur une scène où des femmes se montrent nues. Ainsi a-t-on appris qu’à Paris, malgré le soutien de La Villette, on a assisté à une performance « radicalement différente » de ce que Holzinger avait présenté ailleurs depuis 2022, acte que l’artiste qualifie de « censure ». Lorsqu’elle enchaîne les arguments invoqués par « les autorités françaises » qui, selon elle, associent inconditionnellement la nudité féminine à la disponibilité sexuelle et donc à la sphère privée, l’on comprend l’ampleur des dispositifs psychologiques et juridiques qui ont été mis en place pour que les enfants puissent occuper la scène dans les meilleures conditions de santé affective et corporelle.
Il n’est pas question ici pour nous de nous prononcer de manière catégorique sur le sujet – surtout en absence d’informations officielles plus précises – car la problématique énoncée par Holzinger demande un débat distinct. Il n’est pas non plus question d’ignorer les aspects potentiellement problématiques dans le travail de la chorégraphe et qui méritent d’être discutés entre les confins d’un discours critique théâtral et sociétal. Toutefois, la prise de parole de Holzinger a de quoi inquiéter et alerter. Reste à voir comment et si la communauté locale se mobilise pour défendre le droit à la création dans la même mesure qu’elle a l’obligation de défendre un cadre de travail sécuritaire, juste et respectueux de la dignité de tout.e agent.e impliqué.e dans la création, l’exécution et la diffusion d’une œuvre scénique. Car on ne peut pas ignorer et minimiser ce progrès que l’on doit à Florentina Holzinger : dans la tourmente de #MeTooTheatre, notamment après le scandale Jan Fabre, artiste par excellence de la violence sur scène, la chorégraphe autrichienne a multiplié les efforts pour démontrer que la violence et la radicalité y sont encore envisageables dans un cadre professionnel éthique et attentif aux sensibilités de toustes, sans qu’elle contamine en même temps (jusqu’à preuve contraire) les pratiques de travail. Et une telle démarche, que l’on adhère ou non à l’esthétique de Holzinger, reste impérative et urgente, vingt ans après une certaine édition tonitruante d’Avignon. À l’époque, une série de metteur.e.s en scène et de chorégraphes, issu.e.s de France et de Belgique en particulier, scandalisaient les audiences en raison de ce qu’il était plus convenable d’appeler une « esthétique du choc » plutôt que de confronter l’omniprésence de la violence dans toutes les sphères de la vie. Une violence qui n’a et n’aura pas de meilleur exutoire que la scène.
Visuel : © Marianna Wytyczak

The first word of the first poem of the first collection is basket : un duo déroutant mais jubilatoire
par Marc Lawton12.01.2026
→ Lire l’article

Entre étoiles et cendres, La Bayadère revisitée de Jean-Christophe Maillot
par Maria Sidelnikova12.01.2026
→ Lire l’article