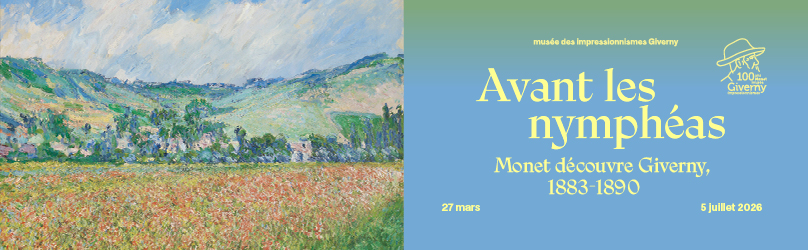Avec « Forever », Boris Charmatz dans les pas de la Pina Bausch de « Café Müller »
par Amélie Blaustein-Niddam15.07.2024

Peut-on faire plus Cult ? Plus mythique ? Plus mystique aussi ? Sous les néons subtils d’Yves Godin, Boris Charmatz invite l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal et des danseurs et danseuses extérieur.e.s à réincarner et décaler l’œuvre la plus célèbre de la chorégraphe allemande. Magistral.
Circuler
Forever n’est pas un spectacle. C’est une installation chorégraphique qui dure sept heures et dans laquelle vous pouvez en théorie circuler librement par tranche de deux heures environ. Au démarrage, il y a un décalage entre le projet et la contrainte qui entache la réception de cette œuvre. En ce jour de première, dimanche 14 juillet, la tension est palpable et l’agressivité des agentes d’accueil est permanente vis-à-vis du public. Il faudrait circuler vite et en silence alors que le projet est vaste et généreux.
Se souvenir
Une fois en salle, ces tensions s’apaisent. Comme à son habitude, Boris Charmatz, l’actuel directeur du Tanztheater Wuppertal, décadre le regard. Le public est assis partout, tout autour de la grande scène de la FabricA vidée de ses gradins. Il est possible et hautement recommandé de monter sur les coursives. Des témoins passent et racontent « leur » Café Müller. « Ah, tu es la personne des chaises ? Pour moi, je suis la personne des personnes. » Une autre plus tard : « Quand Pina est morte, je n’avais que huit ans. » Boris Charmatz s’est demandé comment faire vivre le plus grand monument de Pina Bausch aujourd’hui. Café Müller est une chorégraphie de Pina Bausch créée en 1978 sur une musique d’Henry Purcell. Elle est fondatrice de ce que la danse-théâtre était, et est toujours. Le décor est un café, rempli de chaises et de tables.
Le monument
La pièce Café Müller est écrite sur des musiques d’Henry Purcell : l’aria « O Let Me Weep » de The Fairy Queen et l’aria « When I am Laid in Earth » de Didon et Enée. Elle occupe une place très particulière dans le panthéon de Pina. En effet, Café Müller dure cinquante minutes environ, c’est la plus courte de ses pièces (ses chorégraphies durent très souvent entre deux et quatre heures) et elle s’inspire directement du café de ses parents. C’est une pièce encore plus intime que les autres. Cette intimité se niche aussi dans le petit nombre d’interprètes, trois filles et trois garçons, alors que les autres pièces de Pina étaient écrites pour de grands groupes.
La mort et la vie
Café Müller est une pièce sur le temps. Elle était du vivant de Pina Bausch déjà hantée par son propre fantôme. Aujourd’hui, comme en 1978, une silhouette erre, avec un contretemps dans le pied, sans se soucier de la temporalité en cours dans ce café. Les gestes de Café Müller ont dépassé les cadres de la connaissance chorégraphique. Le lâcher-prise en boucle, les corps jetés aux murs, les errances… Tout, tout est mythique, vu, revu, filmé. Pour assumer la nostalgie et la dépasser, Boris Charmatz choisit de nous offrir deux versions du chef-d’œuvre, une en costume (dans laquelle, oh joie, il danse en compagnie de la star Simon Le Borgne) et une autre en tenue de training.
Passer dans le futur
La pièce nous parle du temps qui passe et d’amour fou. On se réfugie dans les bras d’un autre jusqu’à l’embrasser, on se laisse porter, on se laisse abandonner, on retourne dans les bras du salaud, on coule en chute libre, on y retourne encore inlassablement, on erre comme des âmes en peine, jusqu’à se faire clouer au mur entre désir fou et violence. Tout cela en 1978 comme quarante-six ans après, c’est de la pure humanité, ça ne vieillit pas. L’écriture de Pina Bausch continue d’être actuelle. Boris Charmatz la met dans les corps d’aujourd’hui et cela fonctionne à merveille. Il réussit à sortir l’archive du chloroforme pour la rendre vivante. C’est un exercice qu’il maîtrise à merveille, lui qui a inventé le Musée de la Danse et qui a commis pour l’Opéra de Paris 20 danseurs pour le XXe siècle.
Plus près encore
La proximité avec ces danseurs et danseuses est éblouissante. On est collés à elles et eux, et jamais on n’a pu toucher les inversions des longs bras de la sorte, jamais, on a senti les courses rapides faire tourbillonner l’air sur son passage. Et puis quand on monte dans les coursives, on prend conscience de cet espace envahi de chaises et de peu de tables. On regarde d’en haut les lignes des têtes sur les épaules, c’est du grand art. En bas, on pensait que tout partait du ventre, en haut, on réalise la tension immense posée sur les clavicules.
L’écriture est intacte, sa transmission est parfaite et très addictive. On aimerait vraiment pouvoir passer les sept heures dans ce café. On aimerait que ce Forever se pare d’un dispositif qui soit réellement forever. Cela n’enlève rien au génie du geste de Pina Bausch que l’on peut enfin voir comme s’il avait été écrit aujourd’hui. Aujourd’hui encore, on tombe raide amoureux ou amoureuse et quand le mur approche, on s’y jette. Humain, trop humain. Pina, forever.
Visuel : © Christophe Raynaud de Lage
Retrouvez tous les articles de la rédaction sur le Festival d’Avignon ici.

Le retour controversé de la Russie à la Biennale de Venise
par Kenza Boumahdi13.03.2026
→ Lire l’article

« On a 80, 90 ans, mais en fait on vit » : cabaret et haute couture dans une maison de retraite parisienne
par Melodie Braka13.03.2026
→ Lire l’article