« This is Unreal » (and what ?)
par Antoine Couder25.11.2025

Là où commence la machine, sur cette zone d’indécidable où la danse prend corps dans l’imaginaire artificiel. Une nouvelle production de Liz Santoro et de Pierre Godard.
Pour faire simple, commençons par soulever le capot de la danse, et dire que les chorégraphes ont ici choisi d’entraîner une intelligence artificielle à reprendre, répéter, les mouvements de Liz Santoro, son répertoire « classique », quotidien, ordinaire. Cette IA a appris la danse selon Santoro, c’est-à-dire quelque chose comme « gratter les bordures de l’improvisation » après une formation classique (Boston Ballet) et des expérimentations new-yorkaises en danse contemporaine. Des pièces que l’on reconnaît à chaque fois à travers quelques grands traits. L’énergie, la sportivité américaine que la danseuse conserve dûment réglée. Des traits francs, staccato, des embrasements progressifs, une perspective de ballet. Une danse mentalisante, mais étrangement « surréelle » portée par des gestes tracés dans le souffle, par des échos vocaux plus libres. Souvent, la danse de Liz Santoro est celle d’un animal en captivité, en capacité d’imaginer une plus grande liberté et de s’en féliciter. Ainsi, ses cris sont aussi des cris de joie, moins de l’enfance que d’un très lyrique éternel recommencement.
Parler en dansant
Mais cette fois, il y a autre chose, il y a la voix, demie-fiction racontant des sensations et des demis-souvenirs sur le mode de la paramnésie dont on nous dit ici qu’elle est un attribut d’un cerveau en capacité de créer de faux souvenirs. Un véritable gouffre quand on y pense. Un gouffre acousmatique comme si ces paroles sorties de cette bouche venaient en vérité d’ailleurs. Un gouffre psychanalytique, pour le coup tenu à distance avec humour (américain), par la discipline et la répétition. La danse donc et son extension performative qui consiste à parler en bougeant. Le concentré de ce principe d’incertitude qui donne son nom à la Compagnie de Santoro et Godard. Le lointain souvenir (fabriqué sans doute) d’une Trisha Brown rangeant sa cuisine en énonçant des consignes de mouvements. Ici la consigne est biographique, façon « Véronique Doisneau», la danseuse raconte sa vie : sa collaboration furtive avec Madonna, une brève situation de rétention où elle prise en otage ou plus exactement prise pour quelqu’un d’autre et à ce titre retenu. Des souvenirs littéralement dramaturgiques qui nous font oublier (alors il faut le rappeler) à quel point il est difficile de parler en dansant ; à quel point le chemin est long entre la restitution de la machine (six heures, croit-on se rappeler) et le temps que Santoro a passé à apprendre cette chorégraphie (générative un peu, restitutive surtout) de six ou huit minutes. Combien de temps, de répétition ? Une vingtaine de jours. Pour le coup, une bonne mesure de ce qui est « réel ».
Un mélange par déversement
Tout cela évidemment, nous l’ignorons lorsque que nous assistons à la représentation, cinquante minutes d’un théâtre de l’ in-décidé, de plis vocaux et de pulmonations dont parle joliment le texte remis au spectateur en guise de programme. Ce que l’on voit, c’est d’abord – comme toujours- un espace géométrique, cette fois éclatant d’un vert pomme, enfantin. Une scène fortement éclairée. Ce que l’on ne quitte plus des yeux, c’est ce costume fantastique que porte la danseuse, mélange hardcore de texture out door et de dessous chic. Un mélange de costume de nageuse et de meneuse de revues. Un mélange par déversement de l’un sur l’autre. Toute une vie dans la prégnance du studio chéri, dévorateur des emplois du temps, des plannings de répétition. D’un accompagnement tendre et sécurisant du piano enregistré de Pierre-Yves Macé, entre répertoire classique et boucles pop, dans ce prodige de la discrétion et de l’ultra-présence. Du presque parfait et d’ailleurs, on aurait presque pu s’arrêter là.
Le bon sens du terme
Mais non, « This is unreal » n’est pas un rêve, ce n’est pas une danse stress mais plutôt une danse tresse, cousue des fils blancs de l’autofiction, de la musique et du mouvement. Une narration dont on peut saluer le story telling, particulièrement inspirée parce qu’au fond portée par un dispositif simple et lisible. On finit par se demander : et si ce divertissement hautement philosophique était tout simplement un best of des créations du Principe d’incertitude ? Un best of au bon sens du terme, celui qui fait découvrir, qui révèle l’originalité du travail de fond. « Unbelievable ».
« This is unreal », Liz Santoro et Pierre Godard, IA générative : Léo Chédin. Spectacle présenté aux Ateliers de Paris les 24 et 25 novembre, à venir les 28 et 29 novembre à Gif-sur-Yvette, scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, dans le cadre de la biennale Némo.
Crédit : CNDB Archive. Photo: Claudiu Popescu

Georges Aperghis : « Dans ma musique, il y a toujours une dimension théâtrale »
par Yaël Hirsch30.01.2026
→ Lire l’article
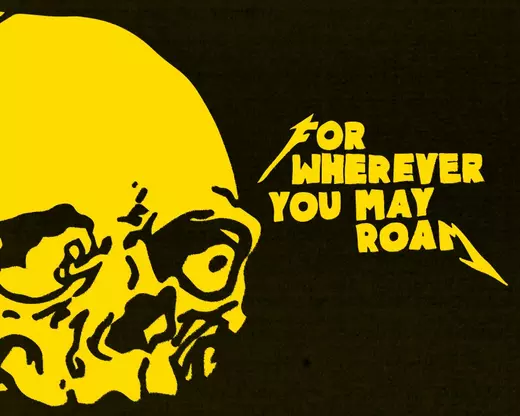
Doc Martens X Metallica : une collaboration étonnante, mais pas surprenante
par Agnès Lemoine29.01.2026
→ Lire l’article





