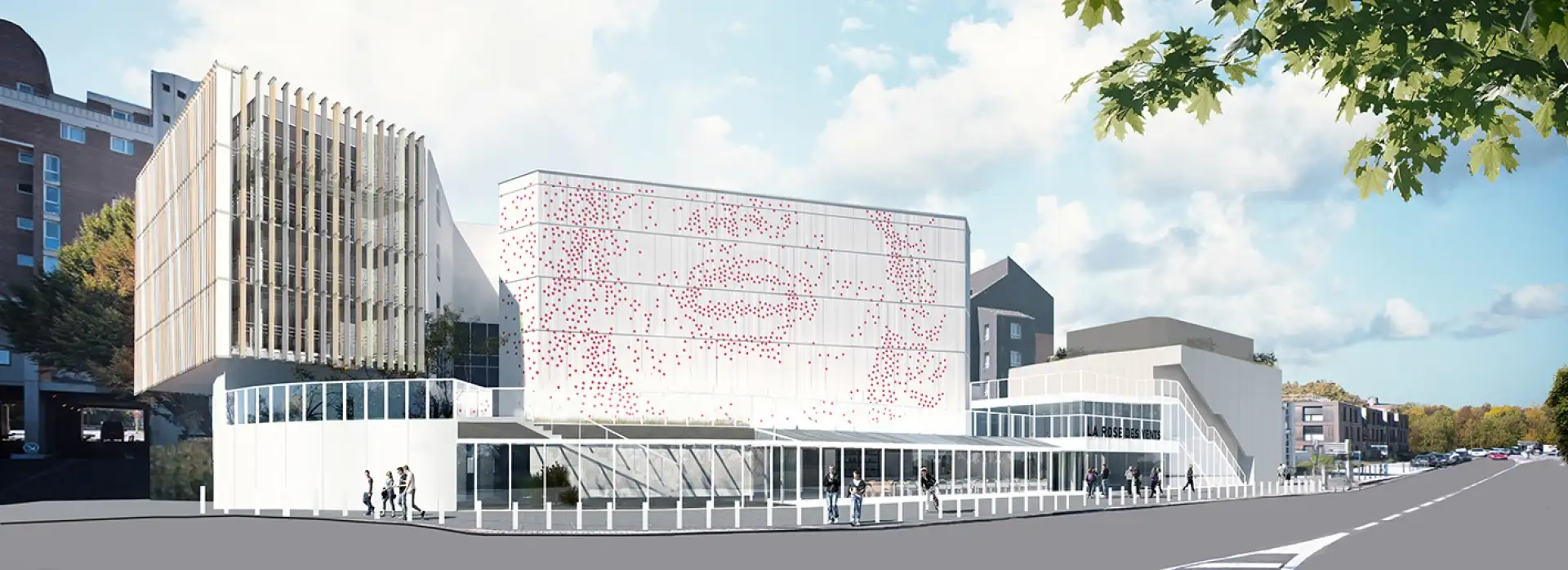Opéra Bastille : des origines à aujourd’hui, discussion sur l’avenir !
par Helene Adam02.07.2025

Quelques propos provocateurs concernant l’opéra Bastille suite aux déclarations diverses officielles ou officieuses – dont celui de Jean-Pierre Robin dans son article du Figaro – nous ont conduit à proposer à un ami mélomane et architecte, Yves Aquenin, de nous livrer ses réflexions à partir de son expérience.
Bonjour Yves, vous étiez élève architecte en 1982, et il se trouve que dans le cadre de votre stage, vous avez été amené à croiser quelques protagonistes du futur opéra Bastille, l’un des grands chantiers de Mitterrand, pouvez-vous préciser le contexte ?
Bonjour Hélène, tout d’abord je souhaite donner quelques précisions ayant trait au contexte : l’opéra de la Bastille (livré en 1989) est l’un des « grands projets » de la période de la présidence Mitterrand, dont les plus importants étaient à Paris : le Musée d’Orsay (1986), la Cité des Sciences et le parc de la Villette (1986), l’Institut du Monde Arabe (1987), la Grande Arche de la Défense (1989), le ministère des Finances à Bercy (1989), l’achèvement de la Pyramide du Louvre (1989), la Bibliothèque nationale de France (1996). Chacun de ces projets relevait d’un établissement public ayant la vocation d’en assurer la maîtrise d’ouvrage.
En 1982, j’étais en toute fin d’études. À l’occasion d’une recherche de mission, le hasard a fait que j’ai pu en trouver une au sein de la toute première entité (qui s’était installée tout près de chez moi !). Cette entité – intitulée APERNOB (association pour l’étude et la réalisation du nouvel opéra Bastille) dite aussi MOB (Mission opéra Bastille)- avait été créée en 1982 afin d’établir le programme du projet et, partant de là, de constituer le dossier qui allait être soumis aux concurrents lors du concours international d’architecture lancé la même année.
Je suis intervenu, à titre très temporaire, en tant que prestataire avec pour mission de faire l’analyse de l’occupation des sols et sous-sols autour du site, et avec pour finalité de produire un document résumant les possibilités d’accès au futur opéra par le métro. Cette préoccupation des programmateurs domine mon souvenir puisque j’étais impliqué, mais ce n’était évidemment pas la plus importante. Les préoccupations dominantes me paraissaient être l’insertion urbaine, la polyvalence de l’équipement (trois salles de trois tailles différentes) et l’autonomie (fabrication des décors, ateliers de costumes, répétitions musique et voix sur le site même).
Néanmoins grâce à cela, j’ai pu participer à l’aventure et avoir brièvement un regard « de l’intérieur ». Au cours de cette mission, il m’est arrivé de croiser quelques acteurs célèbres du monde lyrique (Jacques Bourgeois, Pierre Boulez …), ceux-là mêmes dont les voix m’accompagnaient pendant mes nuits de veille avant les rendus de projets. Vous imaginez donc ma fascination !

Démolir Bastille comme suggéré dans un article, est-ce bien raisonnable ?
Le sens commun rappelle à juste raison que ne pas aimer une personne ou une chose n’autorise pas pour autant à la détruire. C’est évidemment vrai pour Bastille. Et ne serait-ce qu’au regard de ce qu’il a coûté, cela ne me paraît vraiment pas raisonnable – voire pas acceptable !
Ce bâtiment a les qualités de ses défauts, dont la taille. Ses techniques de construction (c’est une très grande structure mixte (verre, métal, béton armé)) le rendent très difficile aussi bien à modifier qu’à transformer. De plus au moment de sa construction (1983/89), on est en pleine période d’utilisation de produits amiantés dans le bâtiment.
Démolir Bastille relève donc plutôt de la formule polémique qu’autre chose. Cela dit si la « dé-densification » du site et la restructuration des espaces communs sont mises en œuvre (ce que je crois nécessaire), alors des démolitions seront inévitables.
On parle à présent du coût de rénovation d’un bâtiment qui ne serait pas si vieux pour justifier de tels travaux, qu’en pensez-vous ?
L’idée qu’un bâtiment est figé pour l’éternité est une idée fausse, mais communément répandue.
Tous les architectes ayant travaillé sur des immeubles existants (et c’est mon cas) vous le diront : il est très difficile de faire passer l’idée qu’un bâtiment – malgré son apparente immobilité – s’use et se transforme.
Des travaux sont toujours nécessaires, imposés tant par le vieillissement naturel des matériaux, par l’usage, par l’évolution des techniques (éclairage, ventilation, équipements techniques, ascenseurs). Enfin – et c’est de toute évidence le cas pour Bastille – l’évolution des besoins impose aussi des changements.
La réflexion n’est plus alors seulement d’ordre technique, mais aussi d’ordre programmatique, sur l’usage du lieu. La difficulté est alors de s’entendre sur le terme « rénovation » et sur les limites qu’on lui donne.
Selon la ministre de la Culture Rachida Dati, le coût serait estimé à 400 millions d’euros. Cela vous parait-il surestimé ?
N’ayant pas les éléments nécessaires, je ne puis répondre ; de quels coûts s’agit-il, quels en sont leurs montants, ce qu’ils comprennent, d’où sortent ces chiffres ? Cela fait beaucoup d’inconnues donc, pour ce qui a pour moi plus l’apparence d’une rumeur que d’un projet.
L’obsolescence vous parait-elle trop rapide ?
La « machine » Bastille a plus de trente-cinq ans, et c’est déjà un âge respectable pour un bâtiment. Il y a eu des « défauts de jeunesse » qui ont été – il est vrai – nombreux et marquants (défauts de fixation des habillages des façades, transparence jugée excessive des marches du grand escalier, ventilation, sonorisation, étanchéité des terrasses, rideau de scène coupe-feu).
Rappelons qu’un bâtiment de ce genre doit être considéré comme un prototype – même si les techniques utilisées sont déjà bien connues. Ses défauts ont opportunément nourri d’une joie mauvaise les tenants de la tradition contre ceux d’une certaine modernité.
Il faut reconnaître que Bastille est en constante (et la plupart du temps inconsciente) compétition mémorielle avec Garnier – qui reste dans les esprits LE modèle emblématique et immuable. Il s’est ainsi formé une sorte de sophisme : Garnier est un opéra et est immuable, Bastille est un opéra, donc Bastille doit être aussi immuable. Or, Garnier comme Bastille aura souffert du vieillissement dès ses premiers trente ans, mais gageons qu’on l’a oublié.
Depuis que Bastille existe, Garnier a subi autant de campagnes de travaux qui ont aussi concerné des ouvrages de structure – remplacements de pierres de façades, rampe du pavillon de l’empereur, toute la toiture, et j’en passe. Pourtant on ne parle pas d’obsolescence à son sujet, alors qu’on n’arrête pas de le faire pour Bastille. L’obsolescence me paraît à géométrie variable selon que l’on s’intéresse à l’un ou à l’autre.
Comment définiriez-vous les raisons du « vieillissement » de Bastille.
Elles sont multiples. Il faut se rappeler que Bastille a été conçu à une époque où il n’y avait ni contrôle d’accès dans les bâtiments publics, ni restaurants dans les opéras, ni internet pour réserver ses places, et où la sonorisation était l’apanage du music-hall.
Commençons par la sécurité et le contrôle d’accès. Chacun a pu se rendre compte combien le passage du portique et le contrôle des sacs perturbent l’entrée dans les salles – en raison généralement d’une absence totale de lieu dédié. Bastille ayant été conçu et réalisé bien avant l’apparition de cette contrainte, l’accès s’en ressent particulièrement.
Ensuite il y a internet : la révolution numérique a permis d’une part l’explosion de la diffusion musicale, et d’autre part, en facilitant l’accès aux places de spectacles, a entraîné une croissance sans précédent de la demande. Comme il devenait juste possible d’avoir une place, d’une certaine manière, Bastille – ça n’est pas là le moindre de ses paradoxes – a participé à la formation de ses détracteurs ! Beaucoup d’entre nous ont pu enfin accéder plus facilement à l’opéra à des prix abordables – leur permettant ainsi de former leur oreille (je parle du « grand » public et laisse évidemment de côté musiciens et mélomanes avertis). Bien des critiques d’aujourd’hui seraient restés, il y a encore peu d’années, des mélomanes de radio ou de tourne-disque.
Enfin, il y a l’acoustique : je ne m’aventurerais qu’avec prudence sur ce terrain glissant, tant il est soumis à la subjectivité de chacun (ainsi qu’à ses capacités auditives ). Il faut reconnaître que la technique, par la mise en place de la sonorisation des parties hautes, a su grandement palier à ce défaut qui me paraît avant tout lié au gigantisme de la salle.
Ayant eu l’occasion de comparer avec d’autres salles européennes – et notamment allemandes -, je peux affirmer que Bastille a de grandes qualités, notamment la clarté des espaces communs et des distributions, ainsi que la vue vers l’extérieur depuis ces mêmes espaces communs, ce qui n’est pas négligeable pour l’« expérience client » (comme on dit au service relation spectateurs). La salle est impersonnelle certes, mais les fauteuils sont confortables (et encore en bon état) ; on a une vue correcte d’à peu près partout.
Alors me direz-vous, pourquoi tant de critiques ? Je note qu’à ma connaissance la plupart des critiques ont été émises par le public – et non par les techniciens et les professionnels – ce qui veut dire que la machine Bastille, quant à elle, semble avoir donné satisfaction. Disant cela, je ne veux pas nier les évidences, et dire que Bastille n’a pas de défauts. Mais ceux-ci ne me paraissent pas tant tenir à la réalisation, au degré d’équipement technique – sommes toutes toujours perfectible -, au style architectural – discutable, daté, mais lui aussi possible à améliorer – qu’aux principes qui ont prévalu lors de la création.

Vous suggérez finalement que le projet Bastille comportait de véritables lacunes et des contraintes préjudiciables à sa réalisation d’entrée de jeu ?
Ce sont en quelque sorte des péchés originels, et ils sont de plusieurs sortes :
1/ les critères de nature idéologique dans le choix du site :
La coïncidence des dates 1789 / 1989 et des volontés politiques (un opéra prenant la place d’une prison !) a fait qu’aucune réflexion sérieuse sur l’implantation n’a été vraiment menée. Il existait une illusion concernant la position à l’Est de Paris – dans un quartier dit à l’époque populaire (mais qui a fortement évolué depuis quelques années), ce qui a fait de Bastille non pas l’opposé, mais le « miroir » de Garnier – donc orienté vers le même public à peu de choses près. Au lieu de l’ouverture vers un public vraiment différent (ce que la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris parviennent à réaliser aujourd’hui), Bastille se trouve être devenu le double de Garnier en plus grand.
2/ les contraintes physiques et administratives :
Le site choisi souffre de nombreux défauts physiques : terrain exigu et de forme irrégulière, étroit et malcommode, impossibilité de modifier les tracés routiers (tabou à l’époque où l’automobile était triomphante), étroitesse et intangibilité des gabarits urbains qui faisaient de ce futur monument un bâtiment peu visible et à la marge de toute perspective urbaine (ce qui est vous en conviendrez contraire à l’idée même de monument). La forme même du terrain rendait très problématique l’ancrage volumétrique et visuel sur la place.
3/ le programme :
Beaucoup trop dense – on a voulu y mettre beaucoup trop de fonctions – sans leur donner la place nécessaire. Celui-ci comportait trois salles de tailles différentes, accompagnées de trois volumes scéniques distincts, d’un atelier de fabrication des décors forcément immenses, d’ateliers de fabrication de costumes, de loges d’artistes, de locaux administratifs, d’un parc de stationnement auto, selon la volonté clairement exprimée de « tout trouver sur place », de créer une « cité de l’opéra » en quelque sorte.
4/ la taille de la grande salle :
Influencés par la jauge du Metropolitan Opera de New York (MET) qui faisait alors référence – mais le débat n’est jamais tranché entre amateurs de chant sur le format des salles – un grand format a été choisi, qui s’est révélé trop lourd à exploiter. Il faut dire que si les jauges sont comparables, les configurations en diffèrent considérablement puisque le MET se rapproche du modèle classique en fer à cheval tandis que Bastille est en « éventail ». Il en a résulté une salle aux dimensions et à l’ambiance plutôt proche d’un palais des congrès. Mais, affectée à une programmation artistique, il lui manque cette sensation de proximité entre scène et salle qui est une donnée de base en la matière. Un tel défaut ne peut être corrigé sans une modification substantielle de la salle. Il me semble que ce sur-dimensionnement a entraîné corrélativement un sous-dimensionnement des deux autres salles, et en particulier de celle dite modulable – ce qui l’a rendue inexploitable par la suite.
Cela faisait au total beaucoup de contraintes que les nombreux concurrents (plus de 740 projets reçus par le jury !) ont eu beaucoup de mal à synthétiser et à résoudre. L'(ex)concepteur qui sommeille encore en moi vous l’affirme : l’accumulation des difficultés et des obstacles de nature programmatique n’est pas toujours porteuse de créativité (contrairement là encore à une idée largement répandue).
La solution retenue finalement (le projet Ott) est une bonne solution de compromis – mais c’est un compromis.
Quelles sont les principales fonctions d’origine qui n’ont jamais vu le jour ou ont disparu rapidement ?
Aucune fonction ne me parait avoir été oubliée par le projet lauréat, sans quoi il n’aurait pas pu avoir été retenu – chaque projet ayant été scrupuleusement épluché par des équipes spécialisées dotées de cahiers de critères à annoter. Il faut dire que personne n’avait d’idée bien claire sur la question, le dernier exemple d’opéra connu à Paris étant … Garnier (1875), et même le lobbying des grandes agences s’est avéré vain. La densité des fonctions à caser, et l’exiguïté du terrain ont fait que les espaces qui devaient leur être consacrés ont été soit sous-estimés, soit ont dû être réduits lorsqu’on est passés à la réalisation.
L’un des exemples les plus visibles est la fonction « accès » qui avait été répartie sur trois niveaux (au lieu d’un habituellement) : le niveau sous-sol (par liaison avec le métro), le niveau 0 rue de Lyon par le trottoir, le niveau 1 par les « grandes marches » extérieures pour les officiels et les événements. Cette fonction (qui donne son image à la façade principale) est habituellement distribuée entre niveaux une fois à l’intérieur du bâtiment lui-même.
À Bastille, elle a été repartie en pied de façade en raison du fort volume du bâtiment et du parti pris de proximité avec la place – résultant eux-mêmes des exigences du programme. Ceci a généré une confusion et une ambiguïté dans la lecture de l’entrée, laquelle s’est résolue à l’usage par le sacrifice de deux d’entre elles (le grand escalier et l’accès métro)

Si mes souvenirs sont bons, celle-ci contrevenait à l’un des points du programme qui prévoyait un accès direct (façon BHV Hôtel de Ville ou Darty sous la Madeleine) depuis le métro dans un grand hall au sous-sol de l’opéra même – espace actuellement occupé par l’Amphithéâtre -. Je veux pour preuve de cette modification la disproportion que chacun aura pu remarquer entre la petitesse de cette salle et la taille généreuse de ses accès. Là se trouvait en effet l’un des accès à l’opéra lui-même désormais fermé, avec une grande baie vitrée noircie.
Autre conséquence de l’étroitesse du terrain et de la lourdeur du programme : le parcours intérieur « de la rue au fauteuil ». Ce qui se déroule ordinairement de manière progressive avec une montée par étapes suivant la succession porche + grands escaliers + galeries de distribution, a été « empilé » verticalement à Bastille. Bien que heureusement magnifiée par le grand escalier principal sous verrière – qui fait la marque du lieu – le parcours est ressenti comme assez peu fluide en raison notamment du croisement malaisé avec les vestiaires et les bars. Les espaces de restauration ont aussi été répartis verticalement (un peu à chaque étage). Les vestiaires quant à eux ont été réduits à la portion congrue – quasiment à l’usage unique des spectateurs du parterre..
Je passe enfin sur l’accès auto – là encore le parc de stationnement étroit et difficile d’accès, à une trop grande distance et sans lien direct avec le hall principal.
Pour ce qui est des deux autres salles – salle dite de répétition et salle dite « modulable » (désignation reprise par le projet récent de 2016), il est difficile de faire la part entre les causes de son non-usage. Il semble que cet aspect du programme ait servi de « variable d’ajustement » budgétaire, et que les crédits aient dû être affectés ailleurs. Une opportunité financière a permis l’émergence du projet de 2016 – puis a disparu. La salle est exploitée actuellement comme salle d’expo sous l’enseigne « Grand Palais Immersif ». Considérons cela comme une amorce d’ouverture vers de nouveaux publics !…
Le projet affichait la volonté d’opéra « populaire », largement ouvert sur le quartier et l’extérieur ?
À la notion d’opéra populaire (qui fleure bon la démagogie), je substituerais celle – plus inclusive – d’opéra pour tous. La chanson peut être populaire, mais le chant opératique peut-il l’être ? La danse peut être populaire, mais le ballet peut-il l’être ? La musique peut être populaire, mais la musique dite savante peut-elle l’être aussi ? Le théâtre peut être populaire, mais l’art dramatique peut-il l’être ? Et le mélange des quatre – qui constitue la matière même du spectacle d’opéra peut-il l’être par conséquent ? Il ne m’appartient pas de trancher, mais je suis convaincu que, quel que soit le type de répertoire, l’exigence d’excellence et de qualité est centrale. Ceci ne peut être satisfait qu’à partir d’un enseignement très ouvert, auprès du plus grand nombre, dès le plus jeune âge, suivi d’un recrutement très sélectif ensuite – à l’image exacte du sport de haut niveau.
À votre avis une rénovation devrait-elle permettre d’en retrouver un certain nombre, dont l’utilisation des espaces du public très peu conviviaux actuellement ?
Il ne me semble pas y avoir d’obstacle à cela – en particulier d’ordre technique. La difficulté – outre le financement – est de trouver la bonne échelle d’intervention (je veux dire par là qu’elle ne doit pas être trop timide), et ensuite de faire admettre qu’une telle rénovation est hors de question avec l’édifice en fonctionnement. Il faut se résoudre à le fermer longtemps (comme l’avait fait la Comédie Française lors de la rénovation de la salle Richelieu) – ce qui peut être l’occasion de tester d’autres lieux (Opéra de Massy, ou MC93, par exemple) et le rapprochement de l’opéra avec d’autres publics. Cela serait la solution la moins coûteuse en tout cas.
Quelles pistes voyez-vous ?
Aujourd’hui, il me semble qu’il s’agit davantage de faire évoluer le concept, dans le sens de l’idée de départ d’une « cité de l’opéra » ouverte à toute heure aux amateurs, ainsi qu’à d’autres activités – mais ça n’est pas seulement une question de bâtiment…
Par ailleurs – je sais ce que l’idée peut avoir de rebutant pour beaucoup -, deux salles pour un opéra national – cela me parait trop. Si l’on a le souci du patrimoine, remettre Garnier aux normes actuelles – techniques et de sécurité – me parait incompatible avec la préservation de son intégrité physique et esthétique (voir la tentative désastreuse de restaurant dans le Pavillon des Abonnés). Il me parait plus pertinent d’en faire un lieu de représentation sociale (ce pour quoi il a été fait d’ailleurs) et d’attraction touristique (ce qu’il est devenu en partie – n’en déplaise à certains), d’événements exceptionnels (n’en déplaise à d’autres – tous ceux qui détestent la notion de mécénat pour ne pas les citer), et non une salle de spectacles au dernier cri de la technique, car la modernisation des équipements ne saurait être menée sans détériorations de l’existant ( je vous laisse déjà réfléchir aux difficultés qu’il y a actuellement à simplement changer la distribution électrique et les ampoules dans les espaces communs – alors pour des équipements techniques « lourds » de type, chauffage, ventilation, cage de scène, éclairage, ascenseurs… !
Il me parait plus pertinent de porter un tel effort sur Bastille où la notion de préservation est vraiment moins présente (c’est un euphémisme). Pour cela il y a plusieurs pistes :
– Extension de tous les espaces communs – chacun dans leur spécialité (accueil, vestiaire, restauration de différentes catégories). Hall d’accueil : des surfaces peuvent être réappropriées au rez-de-rue (ruelle sous l’escalier extérieur, emprise de l’accès métro, volume et surface de l’Amphithéâtre Messiaen).
– Utilisation d’espaces laissés pour compte : par exemple, en plus du potager actuel, les toits pourraient accueillir un ou plusieurs restaurants panoramiques avec accès propre (comme au TCE ou au Centre Pompidou).
– Réduction de la jauge et du volume de la Grande Salle : cela me parait nécessaire en vue d’améliorer l’ambiance intérieure, le caractère, et surtout les caractéristiques acoustiques. Une piste en ce sens serait la restructuration du parterre ( modification de l’altimétrie et de la pente ) – mais c’est difficile à résumer ici…
En conclusion, je dirai que le programme Bastille me paraît avoir été conçu au départ comme trop ambitieux et trop spécialisé, sur un terrain trop petit et trop informe. La priorité me paraît aujourd’hui d’agrandir et de diversifier de manière très significative les capacités d’accueil et de distribution, de façon à en faire une véritable « maison d’opéra», capable de vivre même quand il n’y a pas de représentation. Cela doit passer par un remodelage interne, et non par une extension qui ne ferait qu’alourdir une barque déjà trop chargée.
Merci Yves pour toutes ces précisions utiles à la réflexion collective concernant l’opéra de la Bastille. On pourra utilement comparer ce dernier avec d’autres bâtiments de même génération construits en Allemagne par exemple, comme les opéras de Karlsruhe, Dortmund, de Baden Baden ou d’Essen qui ont su offrir des lieux de convivialité au public tout en ménageant une très belle salle de spectacles ou les récentes améliorations du Royal Opera House de Londres ouvert toute la journée au public, qui permet à ce dernier, de découvrir d’autres facettes de l’art lyrique tout en dégustant d’excellents gâteaux !
Visuels : L’opéra Bastille © Opéra Bastille

Flora Hibberd : Arlequin enlève son masque à la Maroquinerie le 20 janvier
par Yves Braka23.01.2026
→ Lire l’article

Strasbourg : miracle à l’ONR avec la création française d’un chef d’œuvre méconnu de Korngold, « Das Wunder der Heliane »
par Helene Adam23.01.2026
→ Lire l’article