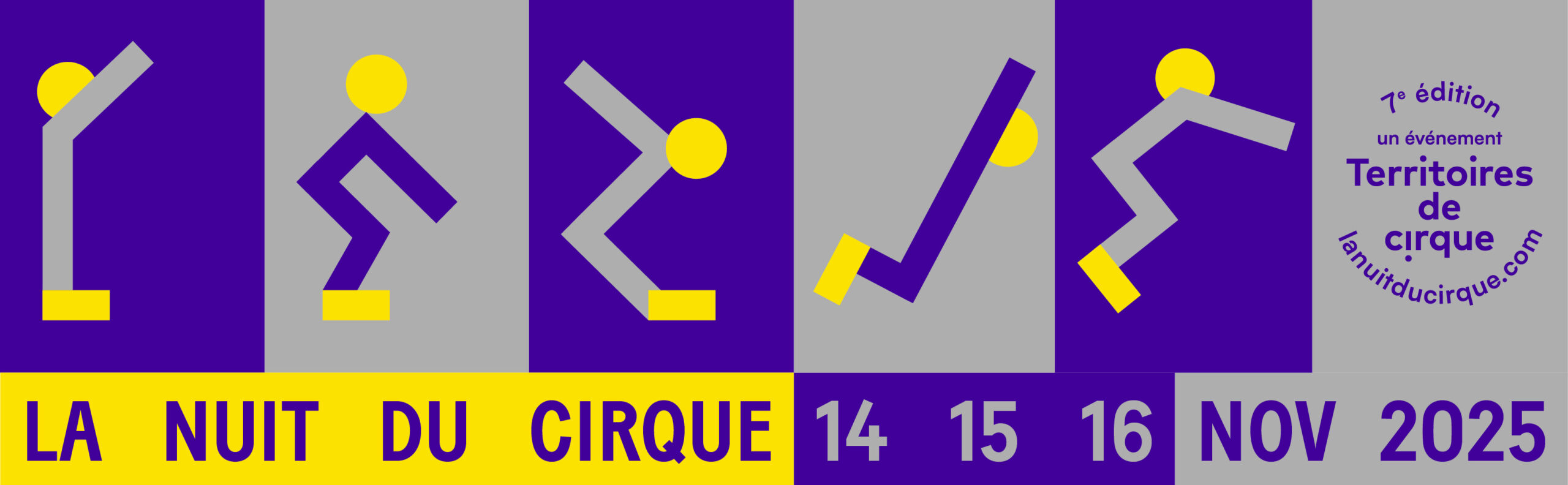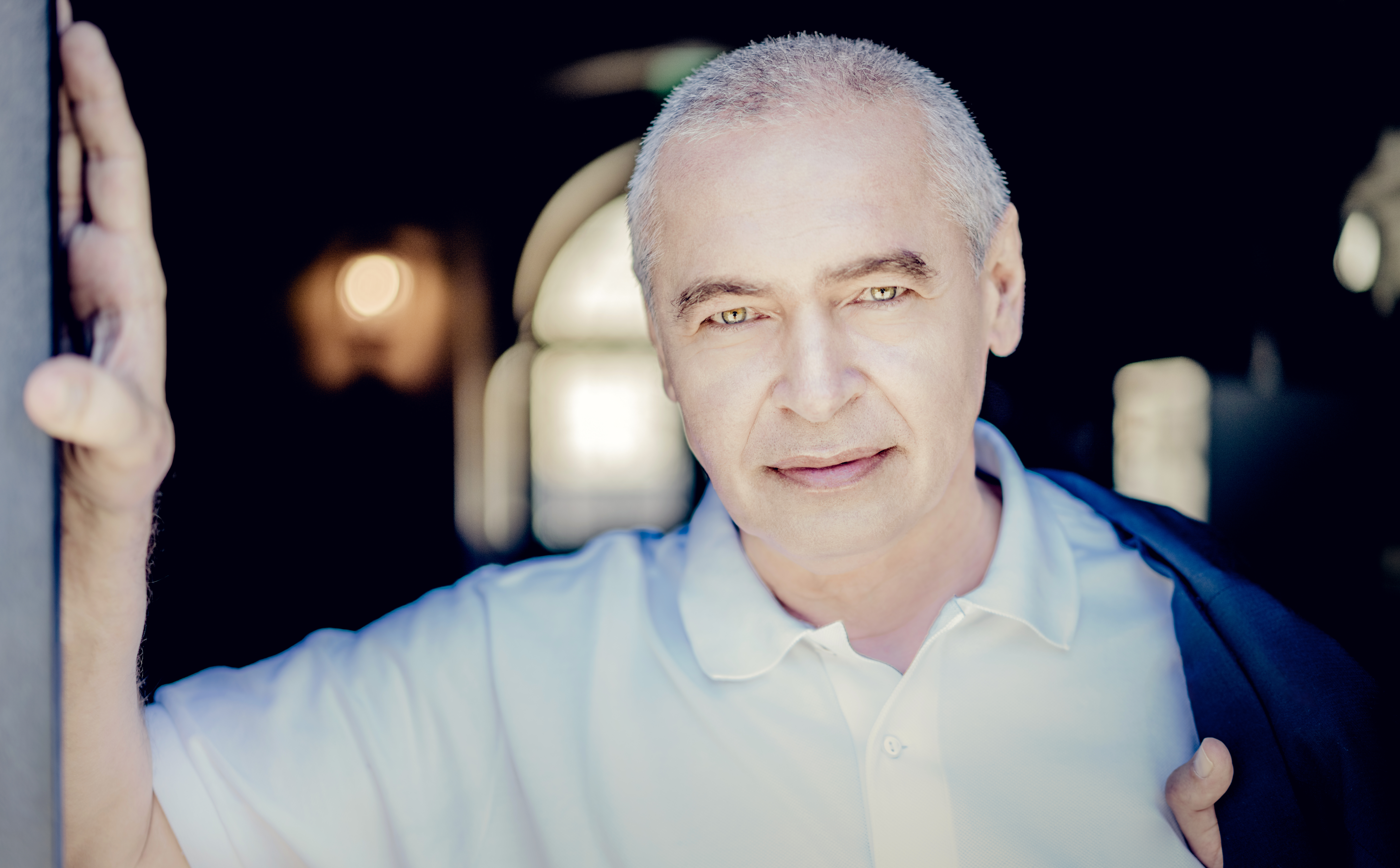Randall Goosby joue TchaÏkovsky à la Philharmonie de Paris
par La redaction10.11.2025

Le programme, ce jeudi 30 octobre, était prometteur. L’Orchestre National de France sous la direction de Christian Măcelaru proposait en deuxième partie la symphonie n° 2 en ré majeur d’Elsa Barraine, compositrice française contemporaine longtemps oubliée ainsi que Daphnis et Chloé de Ravel dans sa version en suite n°2 d’orchestre. Mais, l’attrait majeur était Randall Goosby, soliste à l’affiche pour interpréter le célèbre Concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovsky.
Par Guy Zeitoun
Un Everest des concertos pour violon
De fait, Randall Goosby cochait toutes les cases pour attiser la curiosité. Inconnu en France, jeune, élève pendant dix ans d’Itzhak Perlman, séduisant et… noir américain. Ce dernier élément est important pour deux raisons.
La première raison est que les violonistes concertistes noirs sont rares. Le plus célèbre est Joseph Bologne (1745-1799), chevalier de Saint-Georges, franco-caribéen, surnommé le « Mozart noir » violoniste virtuose du XVIIIe siècle et compositeur talentueux de symphonies et opéras ; également Sanford Allen, premier musicien noir à devenir en 1962 membre permanent de l’Orchestre Philharmonique de New-York avec qui Goosby a étudié.
La deuxième raison, et la plus importante est que Randall Goosby se réclame de cette culture afro-américaine. Vainqueur en 2022 du prix Isaac Stern décerné par l’organisation Sphinx, une organisation américaine à but non lucratif dédiée au développement de jeunes musiciens classiques noirs et latinos américains, il déclarait alors : « J’ai pris conscience du potentiel qui s’offrait à moi et à d’autres musiciens de couleur pour marquer de leur empreinte le monde de la musique classique. J’espère continuer à rendre la musique classique toujours plus accessible aux jeunes musiciens, notamment ceux de couleur, et à mettre en lumière le travail des créateurs marginalisés dans ce domaine ». C’est d’ailleurs l’angle promotionnel choisi avec sa maison de disque Decca. Sa discographie se compose essentiellement d’œuvres de compositeurs afro-américains comme les deux concertos de Florence Price ressortis à juste titre de l’oubli. Ce faisant, Goosby n’a enregistré qu’un seul concerto occidental connu, le concerto n°1 en sol mineur, Op. 26 de Max Bruch. C’est dire qu’entendre ce jeune virtuose, arrivant sur scène en chemise blanche portée de manière décontractée, jouer le concerto pour violon de Tchaïkovsky avait de quoi enthousiasmer.
Mais voilà, dès l’attaque de l’orchestre et les premières notes de Goosby, la déception s’installe. Le tempo est lent. Ralentir le tempo peut se comprendre chez ce violoniste façonné depuis l’âge de 14 ans par l’enseignement d’Itzhak Perlman, qui, à l’opposé d’un Jascha Heifetz mettant en avant la virtuosité, la fulgurance, et la brillance, privilégie les émotions en faisant chanter son violon. Un interview de Goosby réalisé en 2021 confirme ce choix : « Une grande partie de mon apprentissage était axée sur la technique : je voulais maîtriser tous les coups d’archet et m’assurer de jouer parfaitement juste. Mais Perlman me répétait sans cesse : Il faut jouer juste, certes, mais ce n’est pas tout. Il s’agit de la façon dont on perçoit les harmonies, de l’effet qu’elles produisent, des émotions qu’elles suscitent. Si l’on ne touche pas à cette dimension de notre art, il est très difficile pour nous, en tant qu’interprètes, de communiquer véritablement avec le public, de créer un lien. ». Mais ici le tempo est vraiment trop lent semblant frustrer Christian Măcelaru dont on connaît le caractère flamboyant. Car avec ce concerto on plonge dans le romantisme russe et tous ses excès, au point que lors de sa première représentation en 1878 à Vienne, Hanslick, le critique mondain de l’époque parlait « d’une atmosphère de gaîté malhonnête, d’orgie aux odeurs rances de lampes à l’huile et de visages vulgaires de bas fond ». Goosby, en pensant appliquer à la lettre l’enseignement de son maître, sacrifie l’énergie vitale de l’œuvre au profit d’un chant surjoué qui finalement s’essouffle, passant à côté de cette communion recherchée avec le public. Si l’idée de s’effacer devant une œuvre inconnue peut être un argument, cet argument est impossible à invoquer pour le concerto de Tchaïkovsky.
Comment expliquer ce qu’il faut bien considérer comme un rendez-vous raté, bien mal venu pour cette première apparition à Paris ? L’explication est peut-être à chercher dans les racines culturelles de Goosby, plus complexes que la seule culture afro-américaine mise en avant. Car si son père est afro-américain, sa mère est coréenne et a été élevée au Japon. Randall Goosby a été nourri à la double exigence de l’excellence et de l’humilité, à la culture de la réussite à l’américaine mais aussi à l’art de la discrétion. Son statut d’icône de la culture afro-américaine forgé par sa maison de disque l’oblige à être en représentation permanente installant des contraintes nuisant à la sérénité nécessaire pour un concertiste.
Oscar Wilde raconte qu’à l’époque de la ruée vers l’or, dans un saloon d’une petite ville minière du Colorado, il avait vu un panneau où il était écrit « S’il vous plait ne tirez pas sur le pianiste, il fait de son mieux ». Un environnement plus serein permettrait peut-être à Randall Goosby de se recentrer sur son art. Car la concurrence est rude, tel Christian Li, jeune violoniste australien de 18 ans et également de l’écurie Decca, qui vient d’enregistrer ….le concerto de Tchaïkovsky.
Symphonie n°2 en Ré majeur, op.35 d’Elsa Barraine ou la séance de cinéma
Heureusement, L’Orchestre National de France retrouve toute son énergie dans cette œuvre d’Elsa Barraine sous la direction de Christian Măcelaru. Compositrice ayant remporté en 1929, à l’âge de 19 ans, le Grand Prix de Rome, ses œuvres sont depuis peu remise à l’honneur après de longues années d’oubli. Pourtant cette compositrice ne manque pas d’intérêt. Jeune femme juive communiste, elle voit sa carrière mise en veille au moment de la seconde guerre mondiale où elle va activement participer à la résistance. À la fin de la guerre, elle va connaître une renommée certaine notamment en composant des musiques pour des films, des pièces de théâtre et des publicités radiophoniques. Cette capacité à évoquer des images et solliciter notre imagination se ressent dans cette deuxième symphonie qui, bien que n’ayant pas une ligne musicale facile à appréhender immédiatement, nous donne l’impression d’être dans l’action d’un film. Pas surprenant que Paul Dukas fut son maître. On s’imagine errant dans des ruelles sombres et inquiétantes de Paris, traqué par un danger non identifié mais qui nous guette à chaque recoin. Măcelaru, magistral, transporte littéralement la salle.
Daphnis et Chloe, suite n°2 : la symbiose de Christian Măcelaru et l’oeuvre de Maurice Ravel
De sa composition initiale qui était un ballet achevé en 1912, Ravel extrait deux suites orchestrales. La suite numéro 2 qui nous a été présentée reprend à l’identique la troisième et dernière partie du ballet. Ravel nous laisse voyager au travers de l’histoire de Daphnis et Chloé dans la Grèce fantasmée du compositeur. La musique nous transporte dans les fresques colorées et paradisiaques des peintres du XVIIIème siècle. On ressent ici pleinement la symbiose entre Măcelaru et son orchestre. A la fin de l’exécution de cette suite, la salle fait une ovation parfaitement justifiée. Măcelaru et son orchestre remercient le public en nous offrant, comme une folle cavalcade une interprétation orchestrale d’une chanson (Hora mărțișorului) du compositeur roumain Grigoraș Dinicu.
La magie de la Musique
L’alchimie entre un soliste, un orchestre et son Chef ne se décrète pas. Si celle-ci était parfaite entre l’orchestre national de France et Christian Măcelaru, trop de différence de tempérament existait entre Măcelaru et Goosby. Parfois ces différences provoquent une émulation, mais ce ne fut pas le cas ici. C’est d’autant plus désolant que les ingrédients d’un grand musicien se perçoivent chez Randall Goosby.
Visuels (c) Guy Zeitoun
« Amours interdites » : David Kadouch célèbre les amours cachées de certains compositeurs
par Hélène Biard06.11.2025
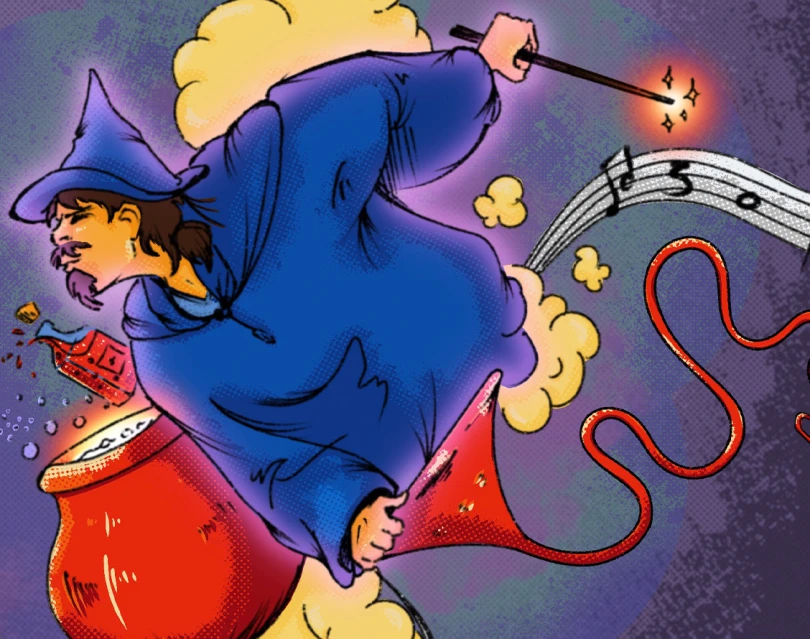
En famille : Concert hanté pour enfants un peu sorciers (et sorcières !) ce dimanche à Paris
par Helene Adam03.11.2025