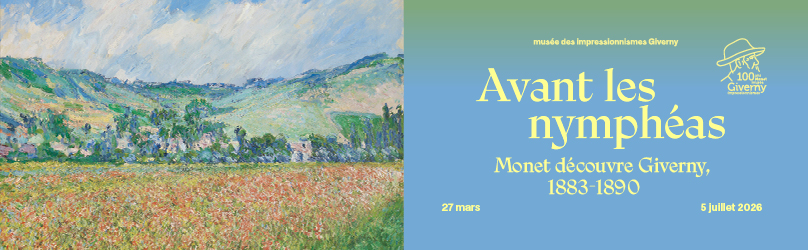Au Théâtre des Champs-Elysées, le quatuor Diotima à son sommet
par Thomas Cepitelli08.12.2025

Le Quatuor Diotima a réussi l’exploit de donner une unité saisissante à un programme éclectique réunissant Szymanowski, Saariaho et Ravel. Une interprétation d’une précision et d’une sensibilité exemplaires.
Il y a des concerts où l’on ne voit qu’une succession d’œuvres et où l’on se demande, parfois, pourquoi elles ont été réunies. Et il y en a d’autres où l’on a le sentiment que les partitions se répondent, se prolongent, se contredisent même, comme dans une dramaturgie théâtrale ou un collage d’arts plastiques. Chacune des œuvres semble alors enrichie par le contact des autres.
Le concert donné par le Quatuor Diotima au Théâtre des Champs-Élysées appartenait clairement à cette seconde catégorie : trois quatuors qui, sur le papier, n’ont rien en commun et qui, sur scène, ont formé un ensemble d’une cohérence étonnante.
Szymanowski, Saariaho, Ravel : trois univers, trois sensibilités, trois façons de rêver la musique.
Mais une même exigence d’interprétation : un son précis, une écoute presque télépathique entre les musiciens, et une capacité rare à raconter sans appuyer.
Szymanowski – quatuor n°2 : un paysage qui se reconstruit
Le Deuxième Quatuor de Karol Szymanowski n’est pas l’œuvre la plus jouée du répertoire. Elle demande une attention particulière : motifs courts, parfois fragmentés, couleurs changeantes, accents imprévisibles. Le public peut s’y perdre. Pour que tout cela prenne sens, il faut un quatuor qui sache tenir la ligne sans perdre la finesse.
C’est exactement ce que Diotima a offert.
Les quatre interprètes — Yun-Peng Zhao et Léo Marillier aux violons, Franck Chevalier à l’alto et Alexandre Descharmes au violoncelle — semblent nous prendre par la main pour nous faire entrer dans cette œuvre exigeante. Dès les premières mesures, on entend quelque chose de rare : une forme d’évidence, une clarté qui permet de suivre les mouvements internes de la musique, comme si l’on voyait les couches d’un paysage se mettre en place. Les musiciens articulent chaque idée avec une rigueur sculptée, mais jamais rigide.
Le premier mouvement, tout en éclats et en élans, avance comme un vent hésitant entre brise et bourrasque. On pense fugacement à l’ouverture de La Walkyrie.
Le mouvement lent est un cœur fragile : Diotima le joue avec une douceur sans mollesse. Les sons semblent venir de loin, comme des souvenirs effleurés. La précision n’est pas ici un exercice brillant ; elle permet simplement à chaque voix de trouver sa place.
Le dernier mouvement, rythmé, presque dansant, est abordé avec une vitalité parfaitement contrôlée. Déplacements subtils, accents irréguliers, montées soudaines : tout est tenu avec une exactitude remarquable. On sent le quatuor heureux de défendre cette musique et de la rendre vivante.
On quitte Szymanowski avec l’impression que la lumière s’est doucement recomposée. Et cette lumière prépare naturellement la place pour Saariaho.
Saariaho, voyage sensible et nostalgique en terra memoria
Kaija Saariaho, disparue en 2023, laisse une œuvre qui touche souvent au cœur. On se souvient du succès critique et public d’Innocence au Festival d’Aix-en-Provence. Terra Memoria, écrit en 2007, est dédié «
à ceux qui nous sont chers et qui ne sont plus ». Mais la pièce évite toute mélancolie facile : elle avance doucement, comme une pensée qui revient, s’efface, revient encore. Comme le deuil, ce chemin sinueux où il faut parfois reculer pour pouvoir avancer. Diotima connaît intimement cette musique : Saariaho a travaillé avec eux, les a écoutés, leur a confié plusieurs créations. Cela s’entend !
Dès les premières secondes, les musiciens installent un espace sonore suspendu, où les sons semblent perdre leurs contours. Glissés, harmoniques, respirations : tout est réglé au millimètre. Les regards échangés en disent long : tous tournés vers Yun-Peng Zhao, ils sont concentrés, mais d’une présence joyeuse.
La matière sonore paraît se transformer sous nos yeux. Les timbres se croisent, se fondent, se séparent comme des strates de mémoire. Les gestes sont retenus, jamais appuyés : cette sobriété va droit au cœur.
Dans la section centrale, plus dense, le quatuor retrouve l’intensité du Szymanowski, mais voilée, comme filtrée par une brume lumineuse. Les quatre musiciens respirent ensemble : tout semble se faire d’un seul souffle.
Ravel et son quatuor en fa : le geste qui renaît
Jouer Ravel après Saariaho pourrait sembler audacieux tant les œuvres paraissent éloignées. Pourtant, ce soir, le passage a été d’une évidence surprenante.
Dès les premières mesures, Diotima adopte une approche franche : un son net, mais jamais dur, des lignes claires, mais jamais décoratives. Le quatuor évite les excès : ce qui compte, c’est le geste musical, sa fluidité, sa cohérence.
Le premier mouvement, parfois trop « parfait » dans certaines interprétations, retrouve ici quelque chose d’humain. Les phrases respirent, se tendent, se relâchent naturellement. On a l’impression que la musique avance avec un sourire discret.
Le célèbre pizzicato du deuxième mouvement est une réussite : vif, précis, mais jamais mécanique. Une danse fine, pleine de rebonds, où le silence compte autant que les notes.
L’Adagio, moment suspendu, est l’un des sommets du concert. Le son se pose, se déploie, se retient. Pas de pathos : un paysage calme traversé de quelques ombres, comme des nuages.
Enfin, le Final surgit comme un souffle large. L’énergie est franche, joyeuse, parfois presque sauvage, mais toujours parfaitement tenue. On entend des échos de Szymanowski dans la tension, et des traces de Saariaho dans les couleurs.
Pour qui connaît l’œuvre, on souhaiterait que le temps s’arrête pour savourer encore ce moment. Cela n’arrive pas, bien sûr, mais on quitte la belle salle du Théâtre des Champs-Élysées rasséréné par tant de beauté.
Un quatuor qui relie
Une fois encore, le Quatuor Diotima — fondé en 1996 par quatre amis à leur sortie du Conservatoire — montre la richesse de la musique de chambre moderne et contemporaine, la simplicité qu’elle peut avoir lorsqu’elle est bien jouée, et la force émotionnelle qu’elle transmet. Trois œuvres très différentes, mais un fil clair :
la précision, l’écoute, et cette manière rare de faire dialoguer les musiques entre elles.
Crédit© Michel Nguyen

La Discult ép. 40 : Joshua Weilerstein nous parle des 50 ans de l’Orchestre national de Lille
par Yaël Hirsch13.03.2026
→ Lire l’article

La Discult ép.37 : entretien avec Marina Rebeka et Edgardo Vertanessian
par Paul Fourier04.03.2026
→ Lire l’article