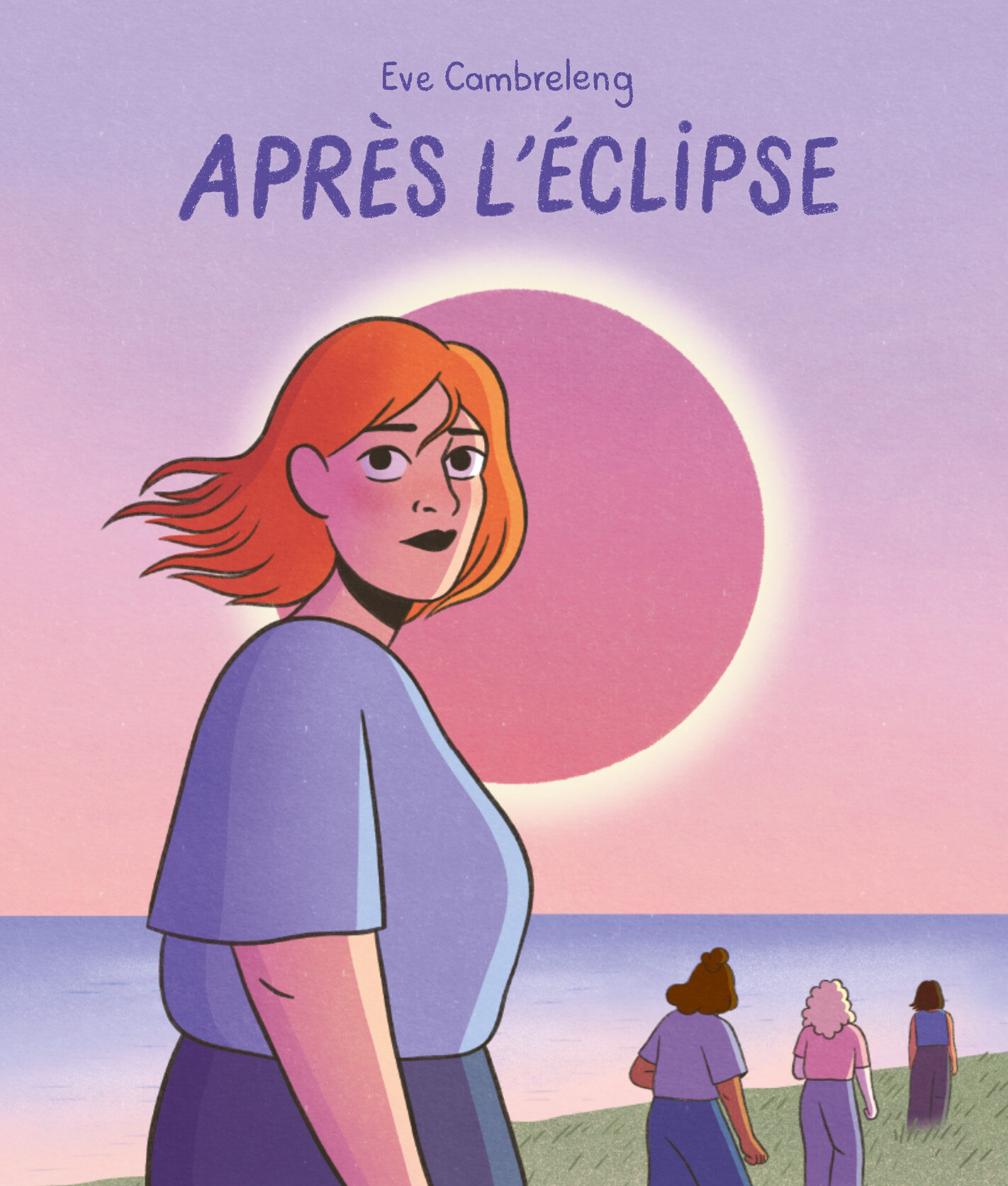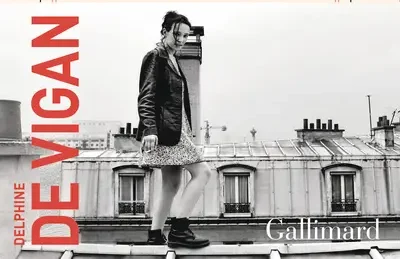« Un Divan à Deli » : Suivez Anne Gagnant sur la piste de la Psychanalyse en Inde
par Emmanuel Niddam20.02.2025

Peut-on parler de Freud en Hindi ? Le sujet de L’inconscient peut-il se manifester entre les castes et les contraintes sociales indiennes ? Peut-on faire du Lacan à Calcutta ? Après une profonde enquête de terrain, Anne Gagnant de Weck répond, et ouvre pour nous la route vers les mondes riches et passionnants des réalités subjectives des femmes et des homes qui vivent l’Inde d’aujourd’hui
Sur sa route, la chercheuse en sociologie nous confronte à des réalités inouïes depuis notre Europe malmenée. La psychanalyse circule en effet dans les esprits et dans les pratiques, avec la conscience que chaque membre de la société dispose de sa propre individualité. Donc, la psychanalyse va avec la conviction de disposer d’une subjectivité propre, à soi. Cette subjectivité vient frotter, jusqu’à l’explosion, contre les usages et les codes des différentes sociétés qui composent l’Inde.
Faux mariage arrangé : un exemple renversant
Une invention culturelle contemporaine en donne une juste illustration : le faux mariage arrangé. Le système de valeur étant un peu inversé, dans une grande part de la société indienne, c’est le mariage arrangé, et non pas le mariage d’amour, qui est la valeur suprême. Le bon mariage, qui correspond à une composition juste des castes, des milieux sociaux, des origines géographiques des deux époux, est un achèvement majeur pour une famille, qui lui confère une certaine noblesse. Aussi, lorsque deux jeunes gens, vivant dans une grande ville, et ayant une grande part de leur vie marquée par des usages occidentaux, se rencontrent et tombent amoureux, leur amour n’est pas une bonne nouvelle pour les familles. Les cas extrêmes sont les amours entre deux personnes de castes très éloignées hiérarchiquement. Dans ces cas extrêmes, ce sont les femmes qui paient le prix le plus élevé de cette répression familiale, qui peut aller jusqu’au « crime d’honneur », c’est-à-dire au féminicide. Dans des cas moins extrêmes, les jeunes amoureux devront mener une lutte politique fine et prolongée pour convaincre que leur choix de conjoint est maquillable en mariage arrangé. D’une certaine manière, la réalité subjective sentimentale qui lie les deux amoureux n’est pas contredite : ce n’est seulement pas le sujet. L’enjeu, c’est sauver la face sociale de la famille. La question subjective est juste niée dans son intérêt pratique et culturel. Dans ce cas-là, les futurs époux se plient à de nombreuses acrobaties pour prouver que leur amour peut être déguisé en un arrangement.
Des langues et du langage
Cet exemple, parmi de nombreuses autres circonstances de vies portées par des témoignages et des références statistiques, mettent en lumière l’espace naissant et peu sûr laissé aux subjectivités. L’engagement d’Anne Gagnant De Weck est total : elle s’est inscrite à l’université à Deli pour y poursuivre des études de psychologie et psychanalyse, et ainsi pouvoir interviewer des étudiants en psychologie, et des psychanalystes. Chacune et chacun témoigne de ces aménagements dans leurs propres vies, et de la place qu’a pu prendre l’invention freudienne dans leur actualité.
Une part étourdissante de ce travail remarquable se porte sur les langues. L’Inde est un pays traversé par de très nombreuses cultures, qui se déploient dans plus de deux cents langues maternelles. Aussi, la relation psychothérapeutique s’établit le plus souvent dans des langues étrangères à la fois au patient et au soignant. En Inde, plus que partout ailleurs, la psychanalyse est donc confrontée à la différence entre une langue, et le phénomène humain et universel du langage qui reste fondamental dans l’âme humaine, par-delà les langues.
Au total, l’ouvrage Un Divan à Deli est un jalon majeur dans l’évolution de la psychanalyse, parce qu’il rend compte des défis actuels que doivent relever les subjectivités dans la confrontation permanente et généralisée entre la subjectivité individuelle et les cultures collectives. Un livre essentiel.
Anne Gagnant de Weck, Un divan à Delhi. Psychothérapie et individualisme dans l’Inde contemporaine. Préface de Alain Ehrenberg
Collection De l’Orient à l’Occident, ENS Éditions, 2023
Visuel : couverture
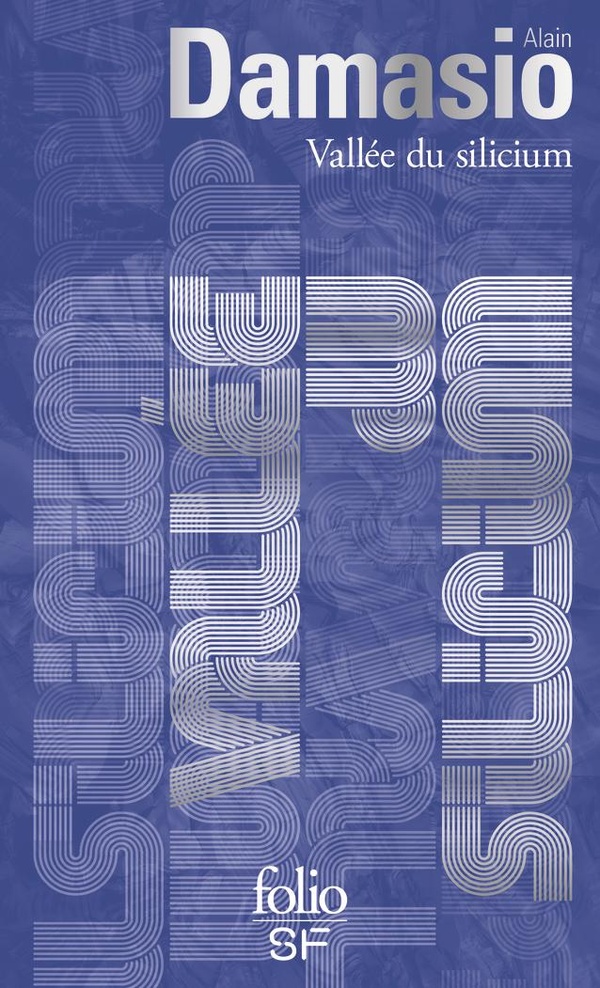
« Vallée du silicium » d’Alain Damasio : Pensée technocritique
par Julien Coquet25.01.2026
→ Lire l’article

Adolescence : quand la fiction remet en lumière un tabou
par Nathan SCANDELLA25.01.2026
→ Lire l’article