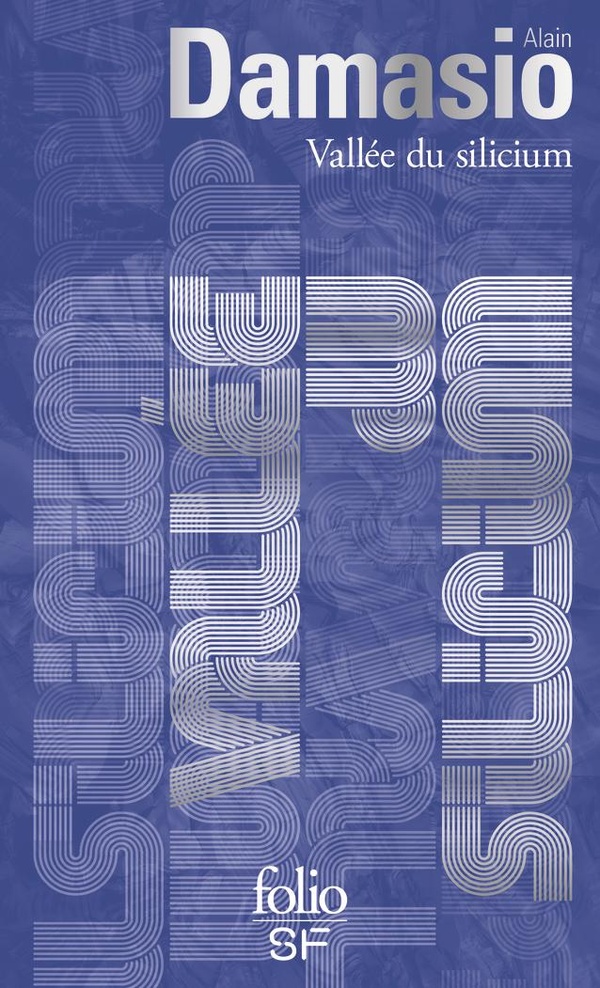« Pannonica de Koenigswarter ne voulait pas que les projecteurs soient braqués sur elle »
par Hannah Starman10.10.2023

À l’occasion de la parution de deux livres de Pannonica de Koenigswarter, Les musiciens de jazz et leurs trois vœux (nouvelle édition augmentée) et L’Œil de Nica, chez Buchet Chastel, nous nous sommes entretenus avec Nadine de Koenigswarter, qui a coréalisé les deux ouvrages. Une sélection de Polaroid originaux de Pannonica de Koenigswarter sera exposée à librairie Delpire & Co du 12 au 28 octobre.
Depuis une quinzaine d’années, des livres, des bandes dessinées et des pièces de théâtre célèbrent le destin singulier de Pannonica de Koenigswarter. Comment expliquez-vous l’intérêt que suscite aujourd’hui cette discrète amie et bienfaitrice du jazz des années 1950-1960 ?
Le nom Koenigswarter a toujours été connu dans le monde du jazz. Une vingtaine de musiciens lui ont dédié leurs compositions, réunies sur l’album Pannonica de 2018. Son personnage est apparu dans le film de Clint Eastwood Bird et on la voit dans le documentaire de Charlotte Zwerin, Thelonious Monk : Straight, No Chaser. Le livre Les musiciens de jazz et leurs trois vœux, édité pour la première fois en 2006 et traduit en plusieurs langues, a sans doute contribué à la faire connaître au public en dehors de l’univers du jazz. Ce livre a aussi inspiré les premières pièces de théâtre, Nica’s Dream de Louis Caratini et Pannonica, racontée par Natalie Dessay, où les acteurs citent des vœux des musiciens.
Pannonica fascine parce que c’est une pionnière, une figure féminine exceptionnelle, dans laquelle se rejoignent un destin personnel et un destin historique. C’est ce qui fait son personnage. Sa liberté aussi, mais surtout son audace et son courage. Cela n’a pas dû être évident de vivre ce qu’elle a vécu en se confrontant, comme elle l’a fait, à ce monde des musiciens noirs américains. Elle a été extrêmement portée par cette musique et par les gens qui l’ont fait, mais elle a certainement aussi encaissé des coups durs et subi des revers. Ce n’était pas simple, pour une femme blanche, de partager sa vie avec des musiciens noirs dans les années 1950 et 1960. Je me pose même la question de comment ça a pu se faire du tout ?
Son nom et son argent la protégeaient probablement…
C’est vrai qu’avec son nom, son argent et le fait qu’elle était aristocrate, cela aidait. Les hôtels de luxe où elle logeait à New York montraient ponctuellement une certaine tolérance pour ses invités noirs et le « bruit » qu’ils y faisaient, mais elle s’est fait jeter de plusieurs hôtels et a fini par acheter une maison où ils pouvaient se retrouver en toute tranquillité. On était encore en pleine ségrégation aux États-Unis. Le Civil Rights Acts n’est adopté qu’en 1964. Nica m’a raconté que, quand elle marchait avec Monk, les gens changeaient de trottoir. Elle se faisait cracher dessus ! Vous connaissez probablement cette fameuse histoire qui se déroule dans le Delaware en 1958. Monk a voulu boire un verre d’eau dans un café et il s’est fait agresser par les flics. Nica les a suppliés : « Ne lui tapez pas sur les mains ! » Et c’est là qu’ils ont trouvé un peu de marijuana dans sa voiture. Elle en a pris la responsabilité parce qu’elle savait qu’elle risquait moins qu’eux, mais même elle a été condamnée à trois ans de prison ! Le scandale a fait la une des tabloïds. Ce n’est qu’après deux ans de procès que l’affaire a finalement été classée.
Qu’est-ce qui l’animait, à votre avis ? Est-ce qu’elle s’est sentie investie d’une mission auprès de ces musiciens ? Est-ce qu’elle cherchait à changer le cours des choses pour eux ?
Oui ! Je sais, par exemple, que les musiciens devaient avoir la « cabaret card », la licence pour pouvoir se produire dans les clubs de jazz new-yorkais. La perte de cette licence avait des conséquences désastreuses pour eux. Sans cette carte, ils ne pouvaient plus travailler à New York et parfois la levée de cette interdiction prenait des années. La police utilisait la loi sur les cabarets pour discriminer les musiciens noirs, parmi lesquels Billie Holiday, Charlie Parker et Thelonious Monk. Nica s’est battue sans relâche pour qu’ils puissent garder leur « cabaret card » ou la récupérer, en faisant du forcing, s’il le fallait. Elle a été la road manager d’Art Blakey & The Jazz Messengers et elle a cherché à promouvoir les musiciens par tous les moyens. Mais elle s’est aussi engagée pour leur faciliter la vie au quotidien. Elle allait à leur chevet quand ils étaient malades, remplissait leurs frigos vides, payait leurs loyers, récupérait les instruments qu’ils avaient mis en gage et bien plus encore.
Incontestablement, Nica était portée par la musique, mais aussi par cette ambiance unique que j’ai connue avec Charles Gayle et les musiciens de free-jazz autour de lui, plus jeunes que ceux que Nica avait fréquentés. Ce cercle chaleureux, marqué par l’humour, les échanges, une créativité foisonnante, était pour elle comme une grande famille dans laquelle elle s’est retrouvée. Son contact avec les musiciens était quotidien. Elle les aimait et ils l’ont senti. Ils se retrouvaient chez elle pour jouer et elle en a hébergé certains. Monk et sa famille se sont installés dans sa maison du New Jersey après l’incendie qui avait ravagé leur appartement. Monk, déjà très malade, a passé les dix dernières années de sa vie chez elle où il est mort. Barry Harris a vécu dans sa maison pendant plus de 30 ans.

Avant de se faire une place dans cet univers du jazz new-yorkais, elle était certainement confrontée au préjugé de n’être qu’une riche aristocrate blanche en quête d’aventures. Comment a-t-elle fait pour désamorcer la méfiance de ces musiciens noirs ?
Avec humour ! Elle avait beaucoup d’humour, elle avait de la tchatche, elle avait de la personnalité et elle était au diapason. Dans les clubs, il y avait un échange, ils se renvoyaient des bons mots, comme un tac au tac. Cela n’a pas dû être évident au début, mais très rapidement après son arrivée à New York en 1955, elle a accueilli et soigné Charlie Parker, à qui plus personne n’ouvrait la porte. Il est mort quelques jours plus tard dans sa suite à l’hôtel Stanhope. Je pense qu’elle a gagné leur confiance parce qu’elle était authentique dans la foi qu’elle avait en eux et en leur musique. Ils ont dû sentir la sincérité de son écoute et le respect et l’attention qu’elle portait à leur musique. Pour eux, c’était fondamental ! C’étaient des grands musiciens. A l’époque, ce n’était pas courant que les blancs comprennent la musique bebop, qui n’était pas une musique pour divertir, mais une musique plus habitée, plus inspirée et plus personnelle : une musique pour les musiciens.
Pannonica était la deuxième épouse de votre grand-père, Jules de Koenigswarter, et vous l’avez rencontrée quand elle était déjà plus âgée. Quelle était votre impression sur elle ?
J’entendais parler d’elle par mes oncles et mes tantes et j’échangeais aussi des lettres avec elle. Nica savait que je faisais de la peinture et s’y intéressait. Ses lettres étaient de vrais petits bijoux : elle faisait des collages, utilisait des feutres et des autocollants. Elle était très drôle. Mon oncle Shaun m’a raconté que – sachant qu’il n’aimait pas écrire – sa mère lui envoyait une série de questions où il devait juste répondre « No » ou « Yes ». J’étais contente de la rencontrer à New York quand j’avais 24 ou 25 ans, mais sans pour autant fantasmer sur elle – j’étais plus dans le rock et le punk que le jazz à l’époque. Nica était un des personnages dans la famille qui m’inspirait, mais moins que l’oncle Raphael qui avait claqué la porte de la banque familiale pour ouvrir un cirque juste en face !
Nica était chaleureuse, imaginative, féminine. Elle avait une voix traînante, rauque, plutôt grave et un accent anglais, assez sophistiqué. Il y avait chez elle une forme de grâce nonchalante. Une tristesse aussi. Ce n’est pas facile d’être confronté aux gens blessés par la vie, par le racisme et par la difficulté à surmonter le quotidien. On le voit bien dans les souhaits qu’ils expriment. Ils devaient tous avoir conscience de ce qui les séparait, ce qui, chez certains, pouvait être accompagné d’une rancœur.
J’ai vu Nica plusieurs fois dans les clubs new-yorkais. Elle arrivait assez tard et elle se mettait en retrait, au fond de la salle où elle écoutait religieusement, toujours avec son porte-cigarettes pendu aux lèvres. Les musiciens la respectaient. Quand ils savaient qu’elle était là, ils criaient « Nica, my Lady! » depuis la scène et venaient pour lui faire un baisemain ou la prendre dans leurs bras. Elle était incontournable, comme un élément du décor, mais un décor actif, qui les accompagnait. Déjà un peu fatiguée, elle était encore très engagée dans la promotion du jazz. Plusieurs fois, je l’ai accompagnée au Jazz Cultural Theatre. Barry Harris avait créé ce club, qui était aussi une école de musique, en 1982 dans un petit local déglingué à Manhattan pour y faire de la promotion de jeunes talents. Avec Nica, on allait écouter les « battles » entre les joueurs. Je pense qu’elle devait les aider aussi.
On a beaucoup spéculé sur la nature de sa relation avec Thelonious Monk et certains partis pris peuvent surprendre. Pannonica, la baronne du jazz d’Olivia Elkaim, présentée à Avignon en juin, va jusqu’à faire dire à Pannonica : « Oui, j’ai couché avec Monk. »
Ce sont des suppositions parfaitement douteuses par rapport à la relation qu’ils partageaient et qui allait bien au-delà de ce type de considération. Elle était amie, non seulement avec Thelonious Monk, mais aussi avec sa femme Nelly et ses enfants, qu’elle a hébergés pendant près d’un an. C’était une immense histoire d’amitié, d’affection, de tendresse, de confiance et d’admiration et pas une histoire de cul ! Juste avant l’opération du cœur à laquelle elle n’a pas survécu, elle aurait encore dit : « Je vais retrouver Monk. » A son enterrement, Pannonica et Nelly étaient assises côte à côte. Sa mort a été une déchirure et leur deuil était total et partagé.

Les aspects romanesques de la vie de Pannonica, son nom, sa fortune, son rang, et le milieu du jazz auquel elle a consacré sa vie – noir, pauvre, marginalisé – a nourri de nombreux récits plus ou moins en adéquation avec la réalité. Y a-t-il d’autres vérités que vous aimeriez rétablir ?
Les journalistes ont souvent brossé un portrait d’une famille psychorigide et coincée, qui l’aurait déshéritée et l’aurait privée d’accès à ses enfants. C’est faux ! La famille ne l’a jamais désavouée. Elle a divorcé de mon grand-père, mais ses enfants vivaient avec elle quand ils le souhaitaient, même si grand-père les a fait scolariser en France. Ce n’est pas non plus vrai que Pannonica était un oiseau rare qui sortait du lot. Au contraire. Il y avait, dans la branche anglaise des Rothschild de nombreux originaux qui ont ouvert la voie, qui ont été des pionniers.
Le père de Pannonica, Charles Rothschild, était fou d’entomologie et il a d’ailleurs nommé Pannonica d’après un papillon de nuit. Il était banquier par devoir filial, mais c’est le vivant qui le passionnait. Il a répertorié 500 nouvelles sortes de puces, dont celle qui transmet la peste bubonique, et il a réuni une collection de 260 000 spécimens qui sont au Musée d’histoire naturelle à Londres. Charles était aussi un pionnier dans le domaine de la conservation de la nature et il a fondé la Société pour la promotion des réserves naturelles qui réunit aujourd’hui plus de 2 000 sites protégés.
L’oncle de Pannonica, Lionel Walter, le deuxième baron de Rothschild, était un naturaliste extraordinaire. Il avait réuni la plus grande collection zoologique privée au monde, dont plus de 2 millions de papillons ! Son musée d’histoire naturelle – qu’il a légué au British Museum – existe toujours à Tring, le domaine familial où Pannonica a grandi. Des centaines d’insectes, oiseaux, mammifères, reptiles et araignées portent son nom, parmi lesquels la « girafe Rothschild », une des espèces les plus menacées de la planète.
La sœur de Nica, Miriam Rothschild, était un personnage original et une brillante scientifique : botaniste, zoologiste et l’autorité mondiale sur les puces ! Elle a publié des centaines d’articles sur des sujets variés et financé toutes ses recherches. Ses découvertes lui ont valu les doctorats honorifiques d’Oxford et de Cambridge, ce qui est d’autant plus remarquable vu qu’elle était autodidacte. Pendant la guerre, Miriam travaillait au service de déchiffrement auprès d’Alan Turing et après la guerre, elle a contribué au rapport Wolfenden qui a permis la dépénalisation de l’homosexualité en Angleterre. Miriam était végétarienne, ne portait pas de cuir et rendait visite à la reine Élisabeth II chaussée de bottes en caoutchouc.
Chaque fois que je suis passée à Ashton, un des lieux de la famille, ça grouillait de chercheurs venant du monde entier pour étudier et protéger ce micromonde de flore et de faune que Miriam y avait créé. Elle a réintroduit une centaine d’espèces sauvages sur ses terres et créé un sanctuaire de libellules. Aujourd’hui, c’est la fille de Pannonica, Kari de Koenigswarter, qui poursuit ce travail.
Pannonica a grandi dans un environnement qui se passionnait pour le vivant, qui œuvrait pour la conservation des espèces et des habitats et qui s’engageait : pour la nature, pour les animaux, pour les gens et pour la justice.

Il n’y a aucune biographie autorisée de Pannonica de Koenigswarter. Pourquoi ?
Parce que la famille voulait respecter ce qu’elle souhaitait. Si elle était auprès des musiciens, c’était pour les promouvoir, eux. Elle ne voulait pas du tout que les projecteurs soient braqués sur elle. C’est la raison pour laquelle la famille refuse toute coopération avec des biographes et n’approuve pas les biographies existantes. Ses enfants ont donné leur accord pour que l’on édite Les musiciens de jazz et leurs trois vœux parce qu’elle souhaitait les publier, mais elle n’a pas réussi à le faire de son vivant.
Buchet Chastel vient de sortir la nouvelle édition augmentée du livre Les musiciens de jazz et leurs trois vœux, qui se sont vendus à 35 000 exemplaires. Comment est né le projet de la première édition, parue en 2006 ?
Je vivais à New York dans les années 1990, après le décès de Nica en 1988. J’habitais dans sa maison à Weehawken et je dormais et travaillais dans sa chambre. Un jour, je suis tombée sur une grande malle pleine de Polaroids qui étaient en train de disparaître, le Polaroid étant un procédé fragile s’il n’est pas fixé. Il y avait des photos de Thelonious Monk, de John Coltrane, de Miles Davis et de gens moins connus. Je me suis dit que la seule façon de sauver ces photos était de les scanner et de les publier.
J’en ai parlé à ma tante Berit [de Koenigswarter] qui m’a montré des carnets Hermès en cuir que sa mère avait réalisés à partir des photos qu’elle avait sélectionnées et des souhaits des musiciens qu’elle avait réunis pendant des années. Nica avait tapé ces vœux à la machine et collé les photos des musiciens dans ses carnets. Le projet était frais, ingénu. C’était comme la bonne fée qui pose des questions, mais c’était profond aussi. Ce qui m’a séduit en priorité, c’était ce côté « livre d’artiste ». Elle voulait le publier et elle avait entrepris les démarches auprès des éditeurs, mais ses efforts n’ont pas abouti. Nous avons reproduit cette correspondance dans la nouvelle édition.
A l’époque, Richard Wilkinson, le mari de June Tyson, qui était la chanteuse fétiche de Sun Ra, habitait encore à la maison. Il connaissait tous les gens de cette génération. Nous avons passé une dizaine de jours ensemble à identifier les musiciens sur les photos et un mois plus tard, il est décédé. Ce livre est particulier parce que c’est une sociologie du jazz de l’époque. Même si parfois les vœux ne sont pas très originaux, cela reflète les espérances des musiciens, dont on connaissait surtout la musique. Pannonica leur a donné la parole. Sa maison est restée à disposition des musiciens jusqu’à la mort du dernier d’entre eux, en décembre 2021, le pianiste Barry Harris.
Et c’est après le décès de ce dernier résident de Cathouse que les enfants de Nica ont vendu la maison. C’est à cette occasion que nous y avons retrouvé d’autres photos que Nica avaient prises. Elles sont publiées dans le livre L’Œil de Nica qui vient de paraître chez Buchet Chastel.
Contrairement au livre Les musiciens de jazz et leurs trois vœux, les photos que l’on trouve dans L’Œil de Nica n’ont pas été destinée à être publiées. Il s’agit là de sa collection personnelle.
Oui, elle fait tout ça comme si elle tenait un journal. Il y a chez elle un côté archiviste. Elle enregistrait tout, les conversations, la musique, l’improvisation, l’entraînement, tout le travail. Elle photographiait non-stop et elle faisait de très belles photos, mais je ne sais pas si elle les faisait pour des raisons esthétiques. Je pense qu’elle voulait avant tout documenter, capter, témoigner de ce monde dont elle sentait l’importance. Elle avait peur que cela disparaisse.
Les visuels sont reproduits avec l’aimable autorisation de la famille Koenigswarter. © Pannonica de Koenigswarter / Buchet Chastel

Décès de la poétesse Vénus Khoury-Ghata : la poésie en deuil
par Agnès Lemoine30.01.2026
→ Lire l’article

Laurent Epstein : « Are you jazzing to me ? » ou quand le jazz rencontre le cinéma
par Hanna Kay27.01.2026
→ Lire l’article