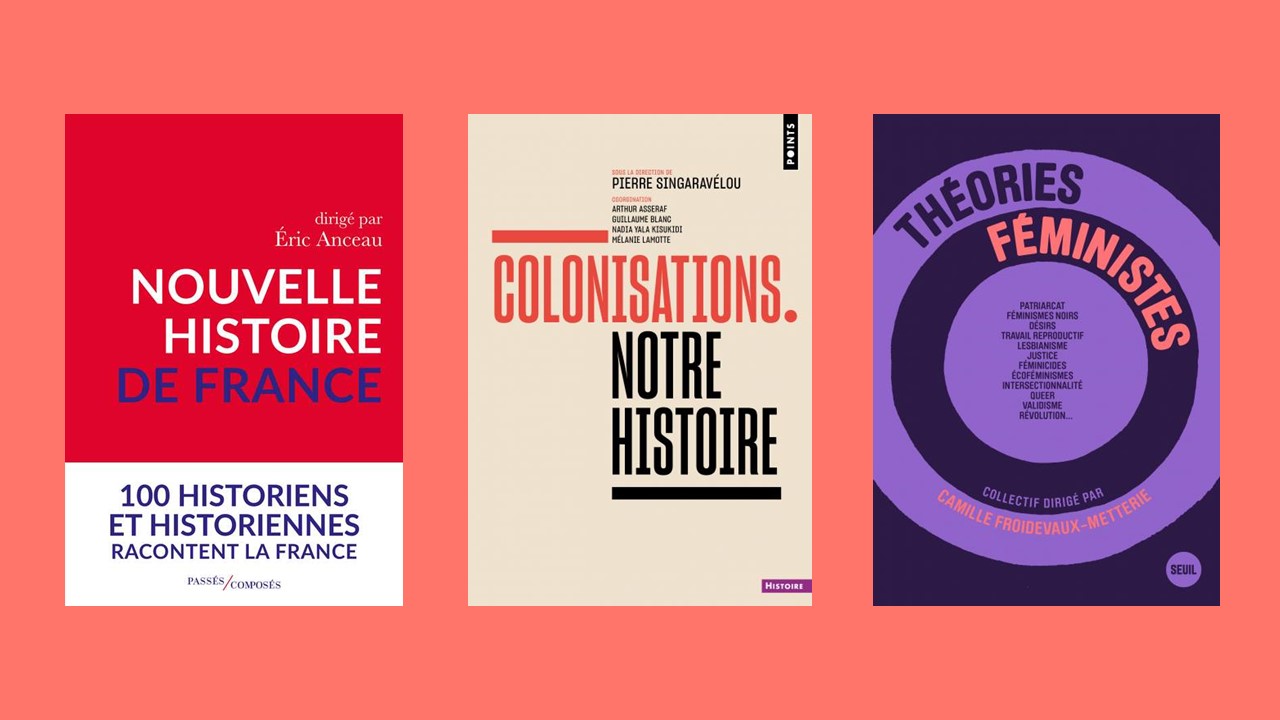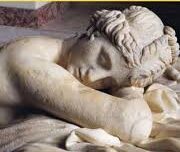«La Figure», un conte aux confins de l’enfance par Bertrand Belin
par Anne Verdaguer01.03.2025

Il tourne autour et dit tout, sans rien dire. Dans son cinquième roman La Figure, l’auteur, compositeur et interprète Bertrand Belin parle de son enfance mais reste à distance de la violence dont il est assez peu question. En prenant le parti pris d’un très jeune garçon qui décide un jour de ne pas déménager avec sa famille et de rester en bas de l’immeuble, il ouvre la possibilité d’un ailleurs, d’un autre possible, et d’une relecture de la tragédie familiale, comme pour ne pas sombrer. Et c’est bouleversant.
Il parle d’un « froid aqueux » qui lui colle à la peau. Mais en même temps, il prend des précautions, pour ne pas accabler son lecteur. Il pourrait même s’il le pouvait, aller faire « du cerf volant dans le ciel noir », car c’est son humeur du moment. En attendant, le voici revenu au moment de l’enfance pour raconter comment ce garçon, lui peut être, décide de ne pas déménager avec le reste de la famille dans le nouvel appartement. Avant cela, il y a eu un incendie qui a détruit la cabane au milieu d’un champ où ils habitaient. Cette famille, parlons-en est constitué d’un « César d’appartement », terme qu’emploiera l’auteur lors d’une lecture pour désigner le père maltraitant, d’une mère qui n’est plus que l’ombre d’elle même et des frères et soeurs, prisonniers de ce schéma.
Et puis surtout il y a la Figure. Ce double de lui même qui lui sert de compagnon et à qui il va se confier.
Bribes de souvenirs
Comme toujours chez Bertrand Belin, les mots sont choisis avec une grande minutie. Il dit ne pas vouloir faire «de faux procès verbal de l’enfance». «La vérité historique n’est pas l’objet de mon travail» ajoute-t-il. Le texte est donc fait de bribes de souvenirs, d’approximations. Mais étrangement, le tout compose une partition extrêmement fluide.
Quand le lecteur prend le parti d’embarquer avec lui, de se laisser porter, rien ne parait impossible. Cet enfant de 3 ans qui décide de s’extraire de la tragédie familiale, c’est au fond comme un postulat auquel on décide d’adhérer, un « pacte avec le lecteur », une porte ouverte, un possible vers un ailleurs.
Une tragédie légère
Et puis il y a cette tonalité si reconnaissable qu’instaure l’auteur, qui s’empare d’un langage oral, saccadé, précis, et, osons le dire, souvent drôle et joyeux, qui ne s’apitoie jamais. Bien au contraire, il offre des respirations bienvenues, dans le marasme ambiant de l’histoire et semble se réjouir de l’absurdité des situations. Car la tragédie elle, reste toujours à distance, au propre comme au figuré. Grâce à ce processus narratif d’une mise à distance du sujet, tout peut être pris à la légère comme la pire des tragédies.
Lors d’une lecture à la maison de la poésie, l’auteur expliquera qu’il voulait «mener une enquête sur son enfance». «C’est un livre sur la mémoire», ajoute-t-il, «la négociation que l’on entretien tous avec sa mémoire.» Il donne au fond sa version des faits, avec en fond, une figure obsessionnelle, qui l’aidera à tenir le coup.
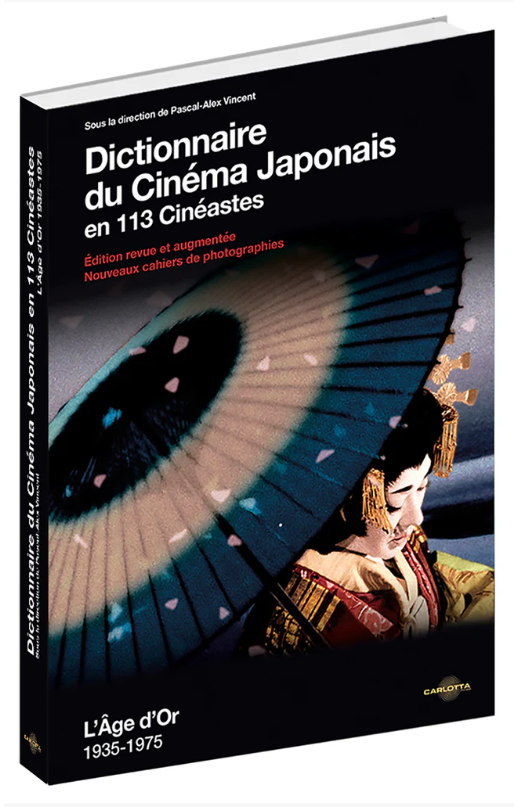
« Dictionnaire du cinéma japonais en 113 cinéastes » sous la direction de Pascal-Alex Vincent : une somme passionnante
par Julien Coquet20.12.2025
→ Lire l’article
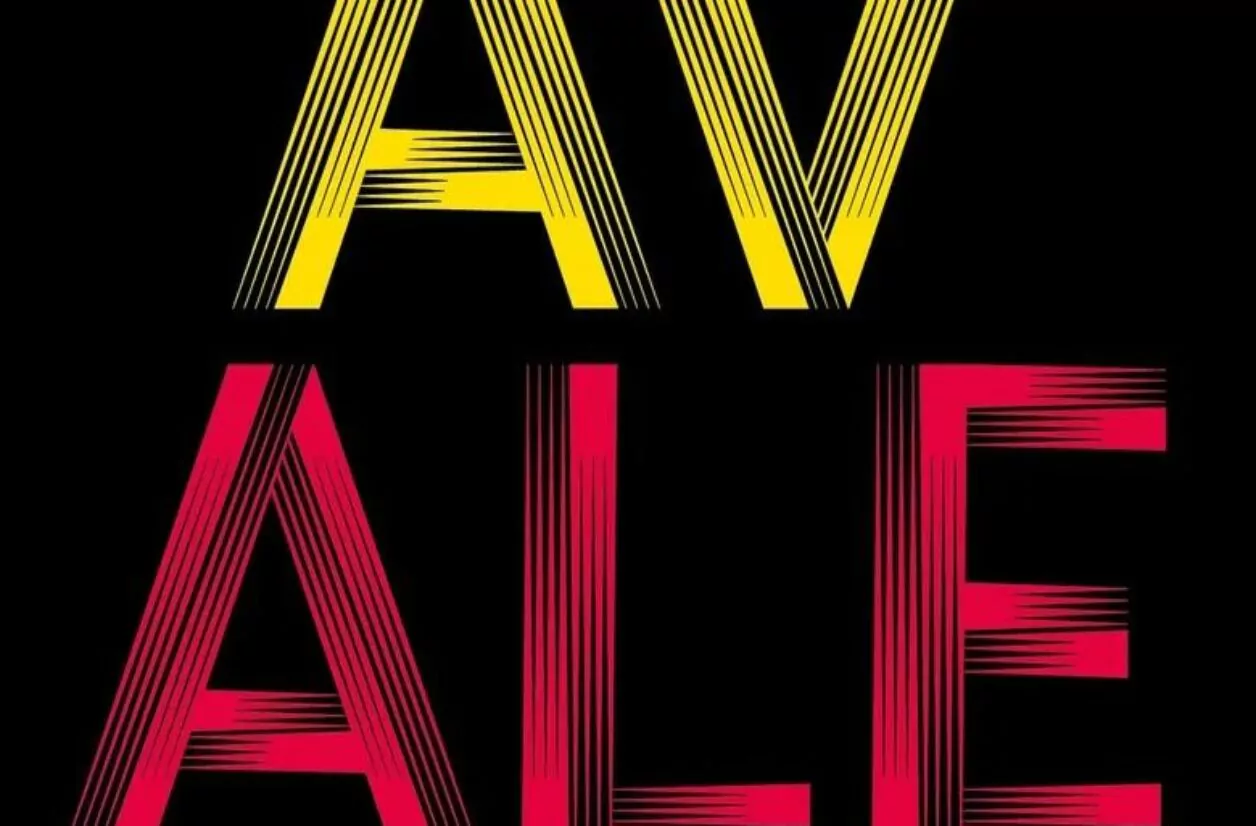
« Avale » de Séphora Pondi remporte le prix Roman des étudiants de France Culture
par Marina De Azevedo19.12.2025
→ Lire l’article