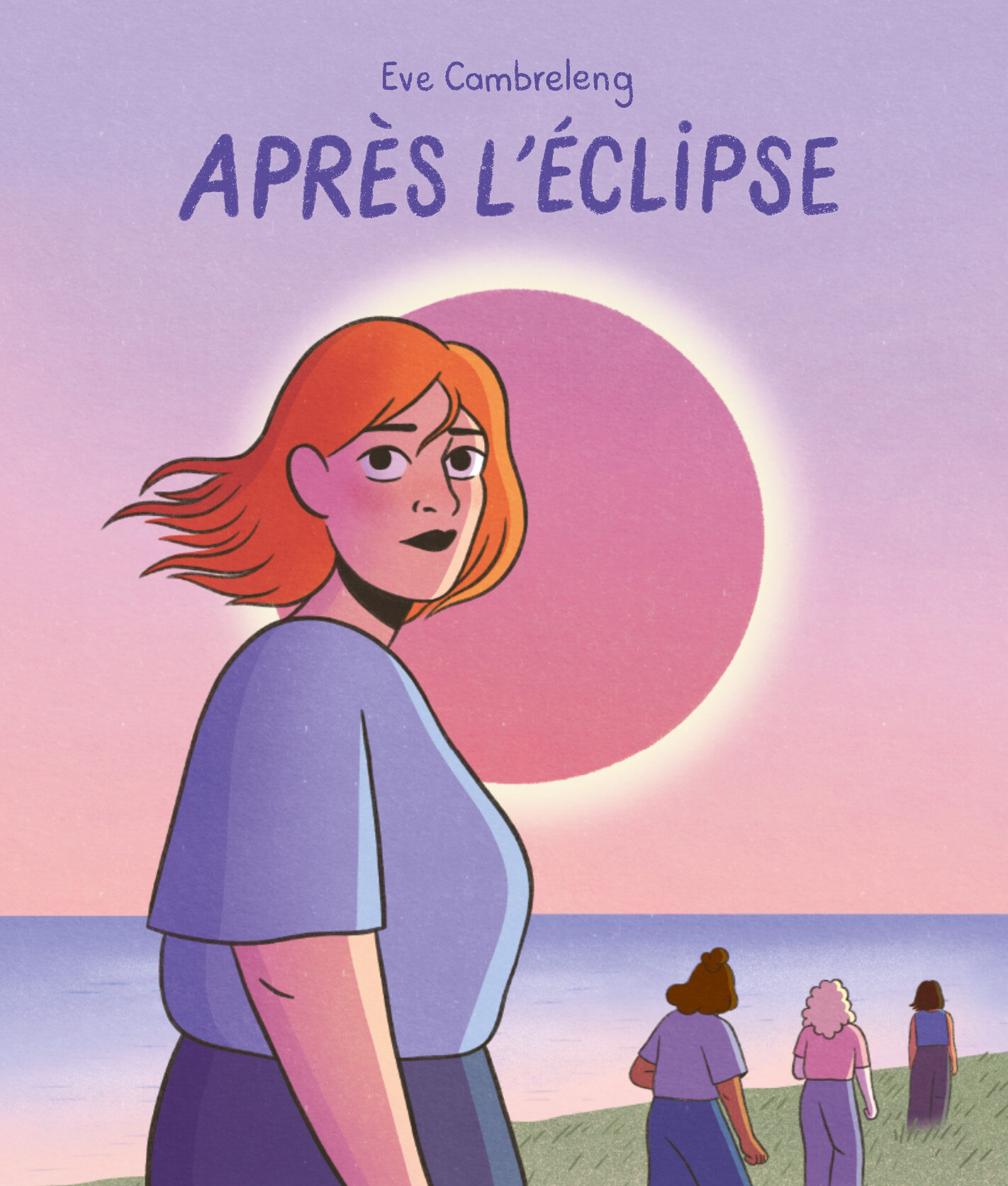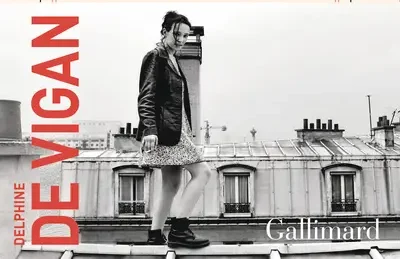« Les héroïnes de la modernité » : Laurie Laufer et Les mauvaises filles bousculent la psychanalyse
par Emmanuel Niddam15.07.2025
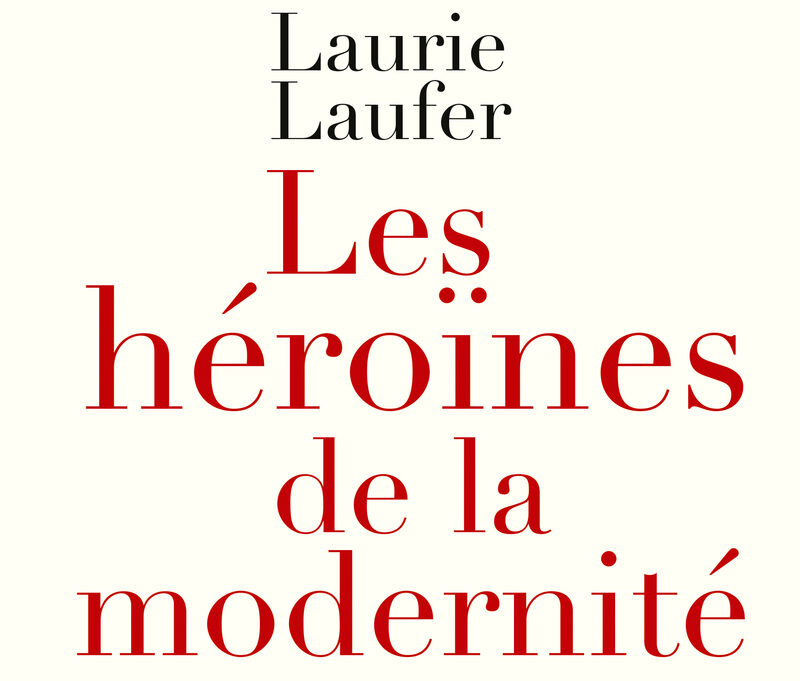
Dans un essai riche et fluide, Laurie Laufer convoque les vies et les écrits d’héroïnes de la modernité dont les destins et les mots ont combattu les pouvoirs des hommes. Un ouvrage poétique et politique, qui poursuit l’œuvre d’émanciper la psychanalyse.
Tout commence en 2015, lorsque la professeure de l’Université Paris Cité prend part à une rencontre scientifique en Tunisie. À la tribune comme dans l’assistance, des femmes tunisiennes témoignent de leur mobilisation dans la lutte en faveur du printemps tunisien. L’élan de liberté et d’espoir prend la forme d’un hymne chanté en chœur, celui du MLF de 1971. Dans l’après coup de cette joie collective, la remarque inutile d’un psychanalyste accroché à ses vieux réflexes éclate aux oreilles de Laurie Laufer comme le signal d’une urgence : celle d’évider la psychanalyse d’un réflexe explicatif construit sur les représentations hétéro-patriarcales.
Des héroïnes : combatives et savantes
De là, un préambule ramène à la lumière l’immense travail de pionnières, telle Madeleine Pelletier, qui ont ouvert la voie d’un féminisme féroce. On y rencontre les destins brisés de femmes, qui ont dû affronter une médecine et une psychopathologie incapables d’admettre une existence entre-deux. Parmi elles, Camille Claudel bien sûr, mais aussi de brillantes intellectuelles comme Renée Vivien et Natalie Clifford Barney.
Puis, la deuxième partie révèle les constructions dissimulées derrière les idées de « femmes » et de « jeunes filles », et comment ces deux idées fabriquent l’exclusion d’une position tierce : la femme qui n’est ni mère, ni putain, est exclue. La troisième partie frappe les idées hétérosexuelles préconçues d’un grand coup de poésie et d’idées : l’éros lesbien y éclate dans toutes les facettes de sa réalité.
Victimisation et agentivité ne s’excluent pas
Laurie Laufer parsème son texte de poésies et de chansons d’où émergent une réalité des cœurs et des corps. L’enseignante chercheuse met le doigt sur une difficulté théorique. Se référant à de nombreuses autrices, dont Gail Pheterson, elle affronte une complexité théorique que la réalité nous impose : « Victimisation et agentivité ne s’excluent pas mutuellement » (Laurie Laufer cite Gail Pheterson, Le prisme de la prostitution, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 27). Ici, la sexualité marchande, la jouissance du corps vendue dans la prostitution, en un mot, la passe, démontre l’impasse d’une théorie du sujet uniforme.
Une résistance créatrice
Puis, Laurie Laufer nous emmène dans le tourbillon d’une culture lesbienne de l’entre deux guerres. En compagnie de Liane de Pougy, Colette, et Mireille Havet, nous voilà courant du cabaret Le Divan Japonais à la librairie Shakespeare and Company. « Considéré comme une « chimère », l’éros lesbien est l’émergence d’une liberté subjective. Malgré les diktats et les opprobres, il est un soulèvement, une émancipation, au sens où il se défait de la tutelle sous laquelle il est emprisonné. » (Laurie Laufer, Les héroïnes de la modernité, La Découverte, Paris, 2025, p. 192)
Suivant Freud, Lacan, puis Foucault, la psychanalyste va prendre les psychanalystes conservateurs à leur propre jeu. Dans une fidélité sincère à l’impulsion de la psychanalyse, parfois en en égratignant les idoles, elle rappelle que : « La résistance est d’abord formulée sous le signe d’une négation, or cette résistance passe aussi par de la création » (P. 196) L’éros lesbien résiste, en s’opposant, et aussi en créant, tout comme la psychanalyse crée du possible au-delà des signifiants.
Marthe Hannau : une génie qui bouscule
L’autrice rappelle également l’histoire méconnue de Marthe Hannau, la « banquière des années folles ». Femme, juive, lesbienne, banquière d’affaires, multipliant les conquêtes, fumeuse, portant fausse barbe pour se glisser au palais Brogniart : tout dans le destin de cette héroïne inclassable faisait exploser les catégories préétablies des esprits de l’époque… et sans doute de certains d’aujourd’hui.
Rappeler la psychanalyse à son ambition
La directrice de l’Institut Humanités Sciences et Sociétés n’oublie pas d’appuyer sa démonstration sur les fondations de la psychanalyse : « En dépit de l’insistance de Freud puis de Lacan à démontrer la débiologisation sexuelle et la dépsychologisation des corps, de théoriser le fait que l’anatomie relève aussi d’un signifiant, il n’empêche, il y a une résistance certaine du côté d’une écoute, qui est fixée sur la binarité des genres; dans ce jeu binaire, la femme relève d’une logique de la négativité, autre différente, indéfinissable et manquante. » (p. 266) La parole des grands ouvreurs de la psychanalyse semble toujours difficile à entendre, pour beaucoup, dont certains psychanalystes.
Cet ouvrage, à la fois historique, poétique, intime, scientifique et politique, par les forces cumulées des héroïnes de la modernité que l’on y rencontre, permettra sans doute de repousser plus loin les bornes de la bêtise binarisante.
Laurie Laufer, Les héroïnes de la modernité – Mauvaises filles et psychanalyse matérialiste, La Découverte, Paris, 2025, 271 pages, 20 EUR
Visuel (c) La Découverte
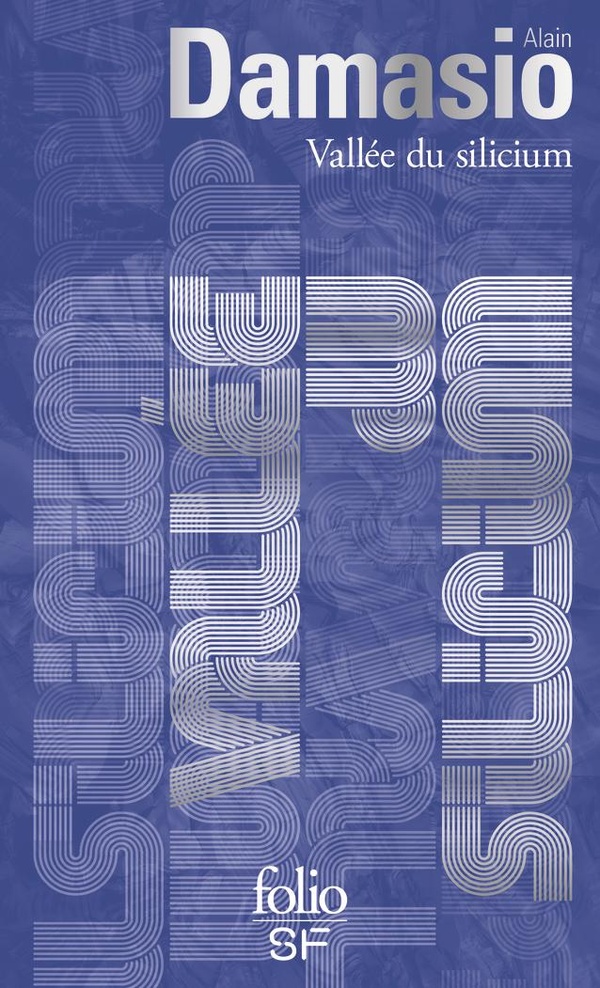
« Vallée du silicium » d’Alain Damasio : Pensée technocritique
par Julien Coquet25.01.2026
→ Lire l’article

Adolescence : quand la fiction remet en lumière un tabou
par Nathan SCANDELLA25.01.2026
→ Lire l’article