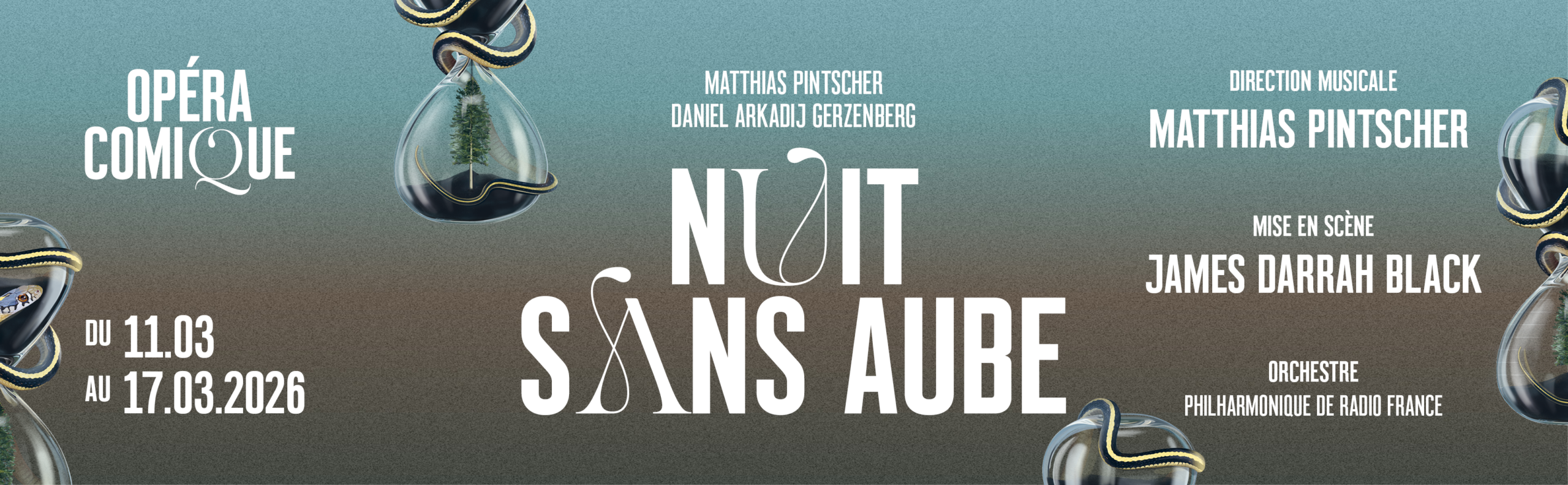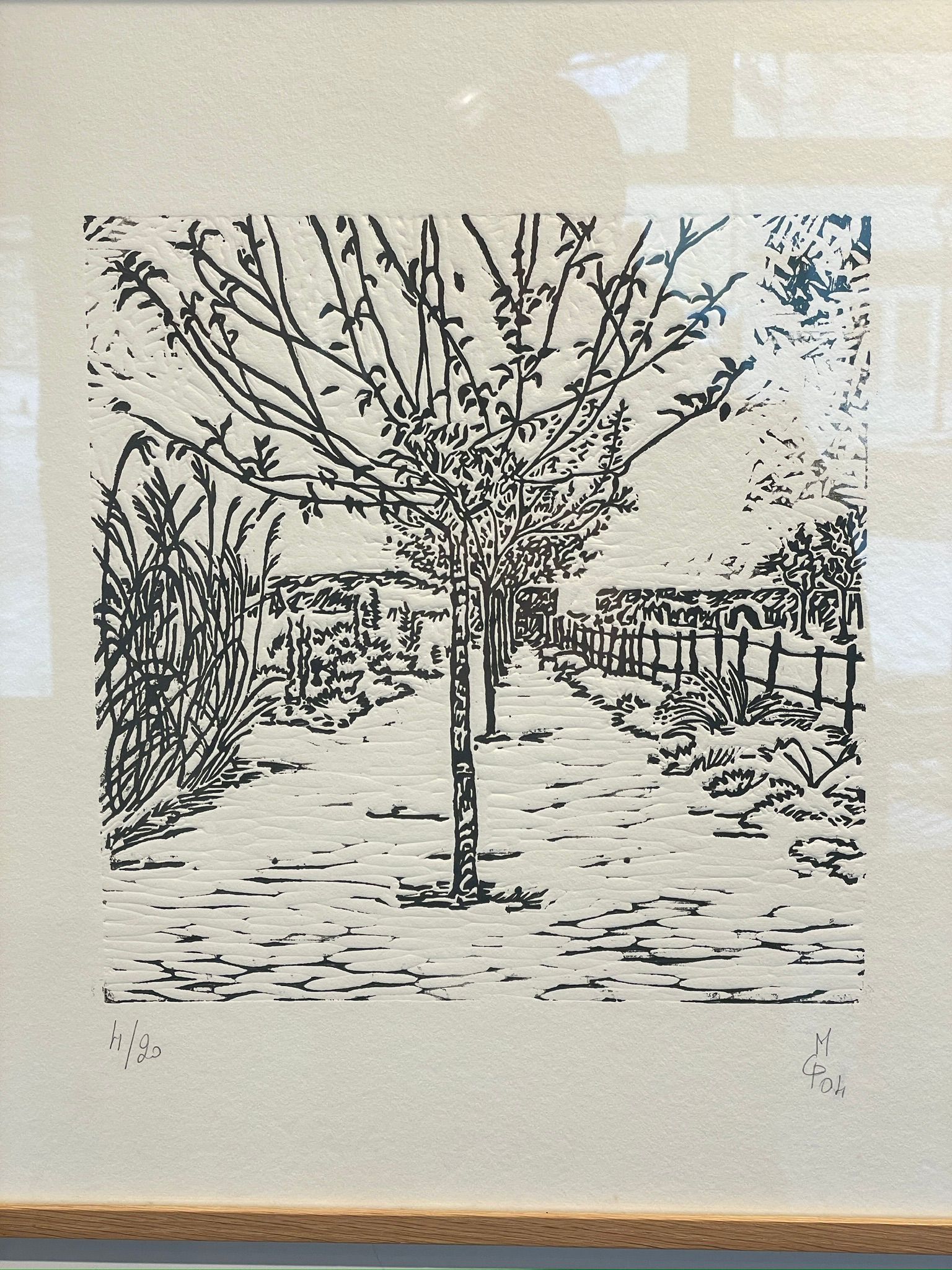L’« Apocalypse » de A à Z à la Bibliothèque Nationale : l’expo et le catalogue
par Paul Fourier25.02.2025

La très importante exposition de la Bibliothèque François Mitterrand est captivante. Et le catalogue est une source riche d’exploration sur les origines du texte de Jean de Patmos et sur ses déclinaisons.
De nos jours, l’« Apocalypse » est synonyme de catastrophes, voire de fin du monde. Si l’on revient au texte original de Jean de Patmos et que l’on suit les analyses qui en sont faites, cela s’avère bien plus compliqué et passionnant que cela. En grec, apokálupsis désigne le fait de dévoiler, de révéler. Mais, dans la mesure où, une grande partie du « récit johannique » est occupée par la description des catastrophes (les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes…), nous avons fini par assimiler l’Apocalypse à ce qui, dans le livre, précède la Révélation du royaume de Dieu.
En se centrant sur les représentations, notamment celles du manuscrit du Beatus de Saint-Sever – un document incomparable figurant dans les collections de la BNF – , sur des aperçus de la tenture de l’Apocalypse d’Angers (qui s’étendait à l’origine sur 140 m de long), sur les gravures sur bois d’Albrecht Dürer, ou les Désastres de la guerre de Goya, l’exposition nous restitue les images qui ont ponctué le parcours du texte de Jean de Patmos. Odilon Redon, Vassily Kandinsky, Natalia Gontcharova, Otto Dix, Unica Zürn, William Blake, Kiki Smith qui ont replacé l’Apocalypse dans leur temps, y sont également présents.
L’Apocalypse, déclinaisons littéraires et cinématographiques
Des fragments de textes d’écrivains comme Emily Dickinson, Friedrich Hölderlin, Victor Hugo, Mary Shelley, Antonin Artaud, Marguerite Duras, ou encore Svetlana Alexievitch ou Audre Lorde parsèment l’exposition. Des échos sont mis en évidence avec la littérature (du Richard III de Shakespeare, de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, du Dernier Homme de Mary Shelley (1826) à La Route (2006) de Cormac McCarthy), la science-fiction, le cinéma, les BD (avec Hergé et Edgar P. Jacobs), ou les mangas.
L’exposition rappelle, bien évidemment, que le Septième art s’est emparé du thème de l’Apocalypse avec Melancholia de Lars Von Trier (qui ouvre le parcours), La Jetée de Chris Marker (1962) et les films catastrophes, de Déluge (de Felix E. Feist, 1933) à l’emblématique Tour infernale (de John Guillermin, 1974).
L’exposition montre aussi que, au cours de l’Histoire de l’Occident chrétien, le texte de l’Apocalypse a régulièrement resurgi dans les moments de tension vécus comme hors d’échelle et incommensurables, tels que la guerre de Trente Ans ou les génocides et qu’on s’y référait pour donner un sens au déferlement de violence. Enfin, elle permet de s’interroger sur ce que signifie l’Apocalypse dans un monde laïcisé.
L’Apocalypse et ses analyses
Le texte de Jean, pas son mystère même, interroge au-delà de sa littéralité et supporte les analyses qui replacent le texte dans l’histoire, montre l’utilisation qui a pu en être faite. Le catalogue de l’exposition est donc un complément indispensable pour qui veut explorer ces aspects et ne pas avoir une approche trop superficielle de ce texte fondateur et traumatisant. Les analyses qui y sont développées sont parfois ardues, mais ô combien passionnantes.
On ne peut donc que conseiller d’aller visiter l’exposition (en notant qu’elle est très riche et exige du temps), mais aussi de s’armer du catalogue qui permet de s’interroger à la lumière de l’« Apocalypse » en ces périodes ou la disparition de l’humanité fait de plus en plus partie des hypothèses. C’est passionnant et c’est, finalement, une manière éclairée d’exorciser sans se déprimer.