Andres Serrano expose 30 années de regard sur l’Amérique au Musée Maillol
par Yaël Hirsch29.04.2024
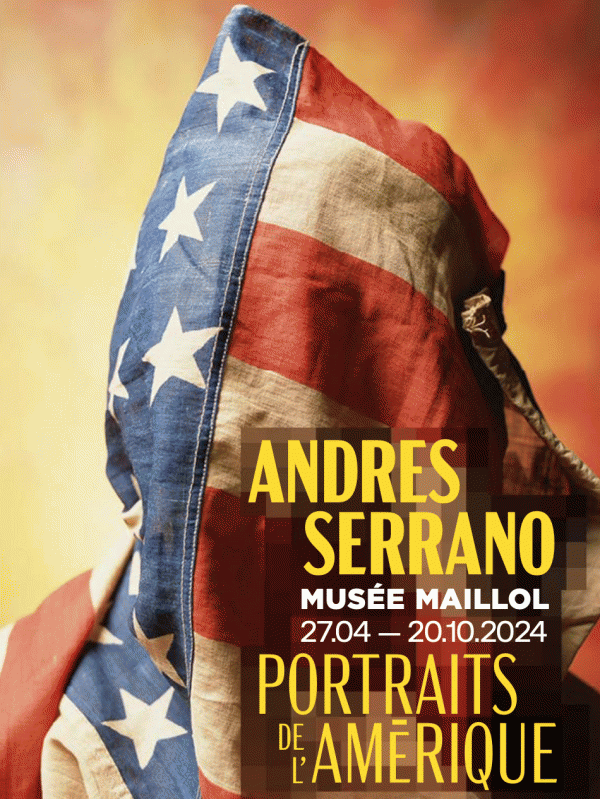
Quelques mois avant l’élection du 47ᵉ Président des États-Unis, Tempora et le Musée Maillol proposent une plongée grandiose dans l’univers d’Andres Serrano. Avec un angle évident, mais peut-être finalement moins familier que celui de la censure et du choc de l’artiste du Piss Christ (1987), l’Amérique ! Du milieu des années 1990 aux robots d’aujourd’hui, l’on traverse et retraverse ses portraits des États-Unis, à travers des visages et des objets, à la fois complétement, neutres et mythiques.
Trente ans de portrait américains
C’est le drapeau américain qui est sur l’affiche de l’exposition, c’est lui qui l’ouvre et Andres Serrano a beau de déchirer comme un chiffon ou le maculer de sang, c’est aussi avec amour que le photographe regarde sa patrie. Fier d’être catholique, fier d’être américain, il n’en sillonne pas moins le pays, avec zones sombres et ses extrémistes, y compris religieux. Au premier étage, sur un fond noir qui met sobrement en avant le caractère spectaculaire et caravaggien des tirages, c’est avec des visages que nous entrons dans l’Amérique de Serrano. Un pays-continent qu’il est allé sillonner, dans un geste proche évidemment de celui de Robert Frank après le 11 septembre. L’exposition nous permet de réaliser combien cet évènement désormais historique est marquant, et à quel point il est un déclencheur pour Serrano. Les personnages se succèdent, connus ou pas (Il y a Chloë Sevigny comme d’illustres inconnus). Avec évidement, dès 2004, Donald Trump dont Serrano a tout collectionné (et exposé en 2019 dans un parking du Meatpacking, The Game : All Things Trump, aujourd’hui à Groningue aux Pays-Bas), mais aussi des « hobos »à la Nels Anderson et Nomads. Ces portraits sont d’autant plus saisissants que c’est comme si toute expression leur avait été enlevée, pour mieux à accorder à des individus devenus « symboles » selon le mot du photographe, une grandeur digne des grands commanditaires de portraits de la Renaissance.
La grande peste des Américains
On ne verra que deux photos de la fameuse série « morgue » qu’en bas, car la grande peste qui décime les États-Unis est, selon Serrano, le racisme. Le vis-à-vis entre les grands habits blancs de carnaval menaçants de The Klan (1990) et les collections hétéroclites de poupées et objets racistes de Nomads (2019) est génial : Serrano collectionne, avec obsession, et il observe, avec obsession toujours, et ne juge pas. Mais on l’entend : l’Amérique est bien malade de la race. La suite met en avant la série sur la torture qui se fond naturellement dans celles sur les armes, si chères au deuxième amendement, qui sont à la fois de simples objets immortalisés en gros plans, mais dont les culasses scintillantes et les bouches grandes ouvertes sont autant de membres qui mêlent éros et thanatos. Retour à la religion et la résurrection ensuite, à grands renforts d’images saintes, avec et sans fluides. Et le Piss christ est là avec un cartel qui rappelle le vandalisme de la Collection Lambert (2011). Le rez-de-chaussée est moins centré sur les États-Unis et plus disparate, mais on y voit une série queer et un petit extrait de la fameuse installation The Game, ainsi que la série de 2021, rétro, mais pas trop des Robots.
L’ensemble est tout à fait fascinant, cela dresse le portrait à la fois macabre et très vivant, monumental et intime, d’un pays à la fois rongé et habité par son passé, mais aussi par ses diversités. E plurbus unum. Pour le meilleur, comme pour le pire. Et alors que nous avons eu la chance d’interviewer le photographe, il nous a expliqué qu’il se remettait à collectionner Trump. Des baskets dorées signées par l’ancien Président et hors de pris à simplement… assurer. Drôle d’augures à lacets pour les mois à venir…
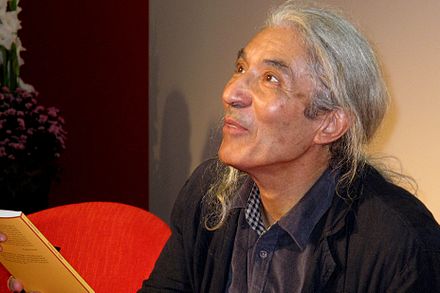
Boualem Sansal : une peine de 5 ans de prison ferme confirmée par la cour d’appel d’Alger
par Rose McCloud-Lieber01.07.2025

Robert Couturier au Donjon Vez, « La poésie des corps au corps » quand la sculpture investit les remparts
par Fiona Fondelot01.07.2025







