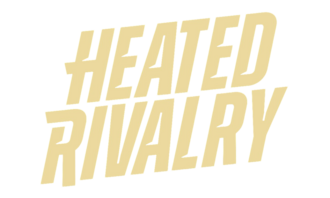« Alger » : un thriller entre identité et mémoire au pari risqué
par Sarah Lakhal08.10.2025

Représentant de l’Algérie à la 97ᵉ cérémonie des Oscars, Alger de Chakib Taleb-Bendiab mêle enquête policière, mémoire collective et drame social. Entre ombres et lumières, le film explore une capitale en tension et un peuple encore hanté par son passé.
Chakib Taleb-Bendiab signe avec Alger son premier long-métrage, représentant officiel de l’Algérie à la 97ᵉ cérémonie des Oscars. Le film sort en salles le 8 octobre. À travers ce thriller dense et nerveux, le réalisateur affirme sa volonté de ramener le cinéma algérien sur la scène mondiale. Pour lui, « tous les cinémas sont importants et doivent trouver leur public ».
Dans cet esprit, le cinéaste franco-algérien livre un récit qui fait d’Alger à la fois un décor, un personnage et une mémoire vivante. Inspiré de faits réels, le film s’enracine dans un drame familier à la capitale : la disparition d’une petite fille, qui fait resurgir tension et suspicion dans les rues d’Alger.
La peur comme moteur du récit
Alger se déploie comme un récit glaçant, solidement ancré dans la réalité algérienne. Lorsqu’une fillette est kidnappée sous les yeux de son frère impuissant, tout un quartier s’embrase dans un élan de solidarité qui tourne vite à la colère. La volonté de faire justice soi-même vient entraver l’enquête officielle, révélant les fractures d’une société en quête de repères.
Le film s’enracine dans la peur : la peur de ne pas retrouver l’enfant, ou de la retrouver trop tard, la peur d’une instabilité politique renaissante, alors que le souvenir de la décennie noire reste vif. Ce passé plane sur les personnages comme un fantôme prêt à ressurgir, nourrissant la tension du récit et les doutes de ceux qui le traversent.
Au cœur de cette atmosphère suffocante, deux figures s’imposent : Dounia (Meriem Medjkane), psychiatre déterminée et insaisissable, et Sami (Nabil Asli), inspecteur idéaliste déchiré entre intégrité et compromission. Leur affrontement incarne cette tension morale constante entre désir de justice et complexités d’un système policier face à ses défis.
La ville blanche brille dans l’obscurité
Plus qu’un simple décor, la capitale devient un personnage central. À travers la caméra de Taleb-Bendiab, la « ville blanche » se révèle multiple : éclatante le jour, magnifiquement inquiétante la nuit. Le réalisateur filme Alger dans ses ruelles, ses hauteurs, ses recoins sombres, où chaque lumière artificielle semble lutter contre l’ombre.
La mise en scène, sobre mais précise, capte la respiration d’Alger. Les sons urbains, les moteurs, les cris, les silences, se mêlent à une musique qui agit comme un battement de cœur collectif. Elle traduit les émotions diffuses d’une ville encore hantée, et relie la tension du récit à une forme d’énergie vitale, celle d’un peuple qui continue d’avancer dans la nuit.
Des acteurs habités et une mémoire incarnée
Le film doit beaucoup à son interprétation collective.
Meriem Medjkane campe une psychiatre au calme presque glaçant : son jeu tout en retenue lui confère une aura mystérieuse, parfois dérangeante. Face à elle, Nabil Asli livre un Sami nuancé, coincé entre sa conscience et les failles du système policier.
Mais c’est Hichem Mesbah, dans le rôle du vieux policier Khaled, qui incarne le plus profondément la mémoire de la décennie noire. Fatigué, désabusé mais digne, il symbolise une génération marquée par la violence passée.
Son interprétation, d’une grande justesse, rend son personnage à la fois borné et bouleversant. Tiraillé entre ambition personnelle et devoir moral, Khaled cherche avant tout à préserver sa place, quitte à fermer les yeux sur certaines zones d’ombre. Derrière ses ambitions se devine pourtant une forme de peur, celle de replonger dans le chaos d’hier.
À leurs côtés, Ali Namous s’impose dans un rôle d’apparence discrète mais central. Son jeu, d’une grande maîtrise, repose sur le non-verbal : un regard ou un silence suffisent à exprimer les tourments de son personnage. Même sans parler, il continue de jouer, et c’est là qu’il est le plus juste.
Un pari risqué, entre justesse et facilités
Si le film séduit par sa tension et sa sincérité, il souffre aussi de quelques vides scénaristiques comme certaines ellipses trop rapides, des oppositions morales appuyées, ou des raccourcis dans la résolution de l’enquête. Ces facilités n’enlèvent toutefois rien à l’ambition d’un projet tourné avec peu de moyens, mais beaucoup de conviction.
Chakib Taleb-Bendiab ose confronter le polar au passé collectif, entre peur, mémoire et identité. Malgré ses maladresses, Alger s’impose comme une œuvre nécessaire : celle d’un cinéma algérien qui, sans renier ses blessures, cherche à retrouver sa voix sur la scène mondiale.
Alger de Chakib Taleb-Bendiab au cinéma le 8 octobre.
Durée : 1h33.
Couverture : © Temple Production