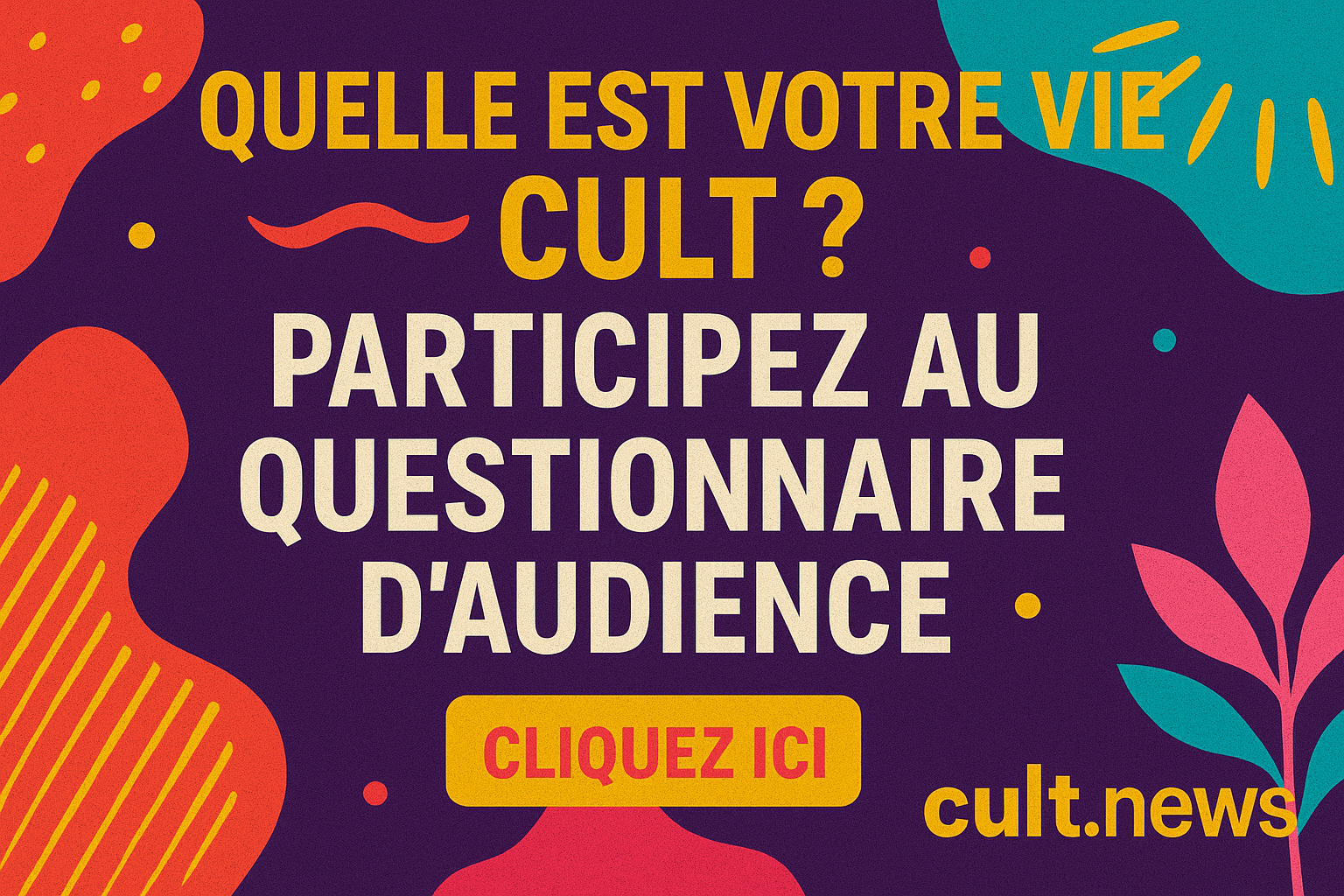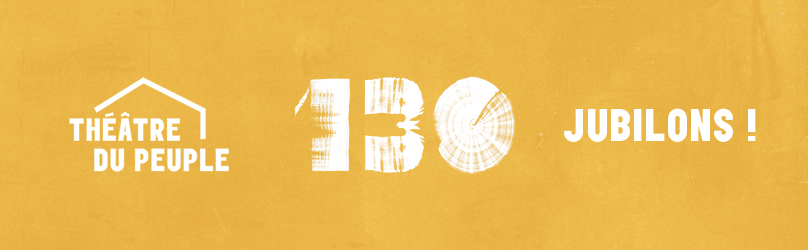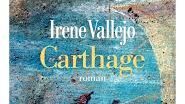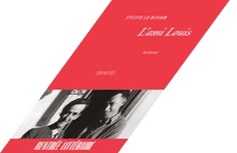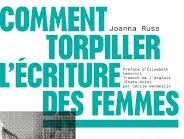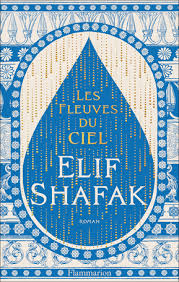« Mettre au monde » de Cloé Korman : donner corps aux histoires des femmes
par Marianne Fougère24.08.2025
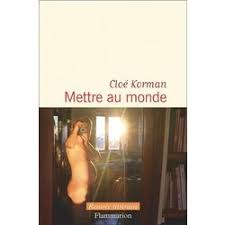
Dans une langue charnelle et implacable, Cloé Korman rappelle combien la conquête de la liberté n’est jamais acquise.
Deux vies, un même combat
Jill est sage-femme dans un hôpital de banlieue parisienne. Ses nuits de garde sont une danse tendue, où la vie se joue à chaque instant dans un ballet de gestes, de mots, d’urgence et d’équipe. Marguerite, elle, est chercheuse : elle scrute l’histoire des avortements clandestins et prépare un colloque autour de la loi Veil. Deux femmes, deux trajectoires, que l’on croit d’abord parallèles, mais qui peu à peu se croisent, s’imbriquent, se répondent. Quand Marguerite tombe enceinte à plus de quarante ans, sans savoir de quel amant, ses questionnements résonnent avec ceux de toutes les femmes qui, hier comme aujourd’hui, affrontent les diktats posés sur leurs corps.
Lire à rebours de ses a priori
Le titre, Mettre au monde, m’avait intriguée sans que je fasse immédiatement le lien avec la maternité, le métier de sage-femme. Quand ce lien s’est imposé, je l’avoue, j’ai ressenti une légère réticence : le risque d’un récit trop attendu, trop collé à un sujet que l’on croit balisé. Mais il aurait été dommage de s’arrêter à cette impression. Car très vite, la richesse du roman balaie ce soupçon. Cloé Korman ne se contente pas de raconter des naissances. Elle entrelace le quotidien des gardes de nuit et des gestes de sage-femme avec la mémoire longue des luttes pour disposer de son corps. Sa langue, sensuelle et précise, fait sentir la fatigue, la beauté des naissances comme la brutalité des batailles juridiques. Fluide, implacable, le texte se lit d’un souffle, mais il dit une violence sourde : celle de l’histoire des femmes. Korman met au monde bien plus que des vies : elle fait surgir des mémoires oubliées, des combats arrachés, des existences fragiles mais tenaces. Sa force est là, dans une écriture où la douceur n’annule jamais la douleur, où l’intime devient politique. Ce qu’elle raconte, c’est la vérité nue de ce que signifie « mettre au monde » : naître, lutter, transmettre.
Cloé Korman, Mettre au monde, sortie le 20 août 2025, Flammarion, 288 p., 21 euros.
Visuel : @ Couverture du livre