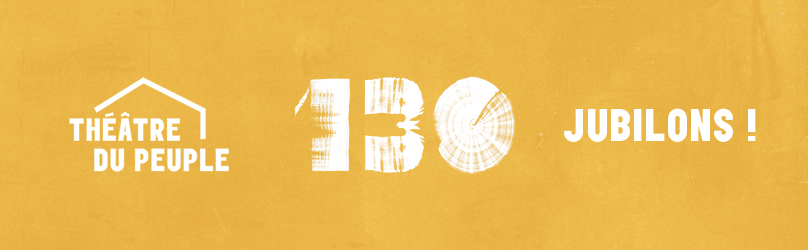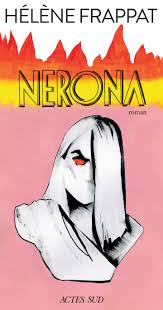« Les fleuves du ciel » d’Elif Shafak : la mémoire liquide
par Marianne Fougère24.08.2025
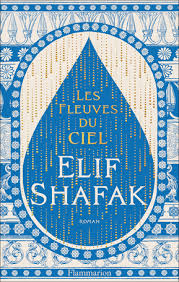
Un roman-fleuve qui coule à travers les siècles et irrigue nos mémoires.
Trois vies au fil de l’eau
Un enfant sur les rives de la Tamise en 1840, mémoire prodigieuse et mains tachées d’encre, qui découvre dans une imprimerie que les mots peuvent transporter plus loin que les bateaux. Une fillette yézidie et sa grand-mère, en 2014, forcées de quitter leur village de Turquie, marchant au milieu de terres ravagées par la guerre pour rejoindre une vallée sacrée en Irak, ultime refuge de leur peuple. Une hydrologue londonienne en 2018, cœur fissuré, installée sur une péniche pour échapper à la ruine de son mariage, et à qui un livre mystérieux rend soudain ses racines visibles. Trois destins séparés par les siècles et les continents, mais liés par un même courant, celui de l’eau, qui traverse le temps, porte les mémoires, relie les disparus aux vivants.
Magie sans artifice
Lire Les fleuves du ciel, c’est se laisser happer par un sortilège. Cinq cents pages qui se boivent comme cent, une prose qui coule avec l’évidence des fleuves qu’elle invoque : fluide, limpide, parfois souterraine, parfois torrentielle. Elif Shafak ne raconte pas seulement une histoire, elle redonne cette sensation perdue de l’enfance, quand un livre ouvrait un passage secret vers d’autres mondes. Elle écrit à la manière des magiciennes, des devineresses qui hantent ses pages : en redonnant souffle à ce qui paraissait enfoui, en rendant palpables les échos entre mythes antiques et brûlures du présent.
On sort de cette traversée avec une envie folle de tatouer sur sa peau quelques signes en écriture cunéiforme, comme si la littérature laissait en nous une cicatrice volontaire. Mais il reste aussi un regret, intime et doux-amer : ne pas pouvoir tendre ce livre à ma Grandma à moi. Elle aurait souri de voir que j’avais trouvé encore plus forte que Christian Jacq… !
Elif Shafak, Les fleuves du ciel, sortie le 20 août 2025, Flammarion, 512 p., 24 euros.
Visuel : © Couverture du visuel

Dans L’ami Louis, Sylvie Le Bihan raconte la vie de Louis Guilloux
par Jean-Marie Chamouard24.08.2025

« Comment torpiller l’écriture des femmes » de Joanna Russ : anatomie d’une invisibilisation
par Marianne Fougère24.08.2025