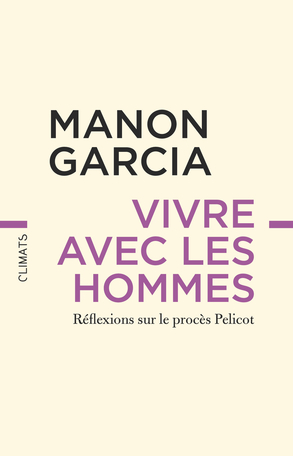Au Festival du film de Berlin, Tilda Swinton reçoit l’Ours d’or d’honneur et livre un discours très politique
par Hannah Starman15.02.2025

Lors de l’ouverture de la Berlinale ce 13 février, Tilda Swinton a été honorée d’un Ours d’or pour l’ensemble de sa carrière. Une veillée pour David Cunio, un otage israélien retenu dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre et le film de Tom Tykwer, The Light (La lumière), lancent la 75ème édition sous le signe de la résistance.
Tilda Swinton célèbre le cinéma et dénonce « les massacres perpétrés par l’état »
La 75ème édition de la Berlinale se déroule sous la neige et dans un contexte politique anxiogène. À la veille de la conférence sur la sécurité de Munich qui se prépare sous une tension sans précédent et à dix jours des législatives allemandes qui annoncent un score historique pour l’extrême droite (AfD), une voiture-bélier fauche 37 personnes à Munich. L’actrice et présentatrice luxembourgeoise Désirée Nosbusch, maîtresse de cérémonie, leur rend hommage.
Sur le tapis rouge du Berlinale Palast, la nouvelle directrice artistique de la Berlinale, Tricia Tuttle, se joint à un groupe d’artistes et réalisateurs qui appellent à la libération de David Cunio, l’acteur israélien kidnappé par le Hamas le 7 octobre 2023 du kibboutz Nir Or. David Cunio avait joué dans le film The Youth (La jeunesse), récompensé par le prix spécial à la Berlinale en 2012. La première du documentaire sur Cunio, Michtav Le’David (Lettre à David) du réalisateur Tom Shoval est programmé pour le 14 février.
Tilda Swinton, habillée en Chanel, a recueilli l’Ours d’or d’honneur avec un discours puissant, appelant à l’empathie et fustigeant l’avidité des classes politiques, « l’occupation, la colonisation […] ou de développement de la Riviera. » Son allusion au projet de Trump de transformer Gaza en station balnéaire a provoqué une salve d’applaudissements.
L’actrice iconique, récemment apparue dans La Chambre d’à côté de Pedro Almodovar, a ensuite évoqué la magie du cinéma et la richesse des amitiés indéfectibles. « C’est tellement, tellement bon pour nous de nous émerveiller du monde et d’être surpris par l’admiration que nous éprouvons les uns pour les autres, plutôt que d’être abasourdis par notre méchanceté gratuite et notre cruauté, » dit-elle.
Avec fermeté, Tilda Swinton condamne, sans les citer « les massacres perpétrés par l’état et facilités par la communauté internationale » avant de déclarer : « L’inhumain est perpétré sous nos yeux. Je suis ici pour le nommer sans hésitation et pour exprimer mon indéfectible solidarité à tous ceux qui reconnaissent la complaisance inacceptable de nos gouvernements cupides qui font ami-ami avec les destructeurs de la planète et les criminels de guerre d’où qu’ils viennent. »
The Light de Tom Tykwer : un interminable récit confus et suffisant
Le film d’ouverture du réalisateur allemand Tom Tykwer (Run, Lola, run, Babylon Berlin), The Light est une diatribe sans fin (182 min), virtuose, confuse et complaisante, sur un couple en crise et leur famille dysfonctionnelle, transformée par l’arrivée d’une femme de ménage syrienne. La pluie torrentielle qui s’abat sur Berlin du début à la fin du film, indiquant une violente catharsis.
Habitant un appartement berlinois bobo, la famille Engels est éclatée. Tim Engels (Lars Eidinger), intellectuel de gauche milite pour le changement sociétal, mais vend ses services de conception promotionnelle aux corporations. Sa femme, Milena (Nicolette Krebitz) travaille inlassablement sur un centre de théâtre communautaire dans un bidonville au Kenya, un projet dont le financement allemand est menacé.

Leurs jumeaux de 17 ans, Frieda (Elke Bisendorfer) et Jon (Julius Gause) vivent chacun dans leur monde. Frieda passe ses nuits dans les clubs à sniffer de la coke et ses journées à manifester pour l’avenir de la planète et Jon perfectionne inlassablement ses compétences de joueur de réalité virtuelle de compétition. A cet ensemble s’ajoute, une semaine sur deux, Dio (Elyas Eldridge), enfant né d’une liaison entre Milena et Gordon (Toby Onwemere).
Pendant des séquences interminables, nous suivons leurs vies décousues et leurs vaines tentatives de rapprochement. L’histoire démarre enfin lorsqu’ils embauchent Farrah (Tala Al-Deen), belle et mystérieuse syrienne surqualifiée pour le poste : il s’agit de remplacer leur femme, de ménage, Maya trouvée morte un jour sur le sol de leur cuisine. Le spectateur rencontre Farrah devant une lampe stroboscopique qu’elle utilise à des fins thérapeutiques pour stimuler l’activité cérébrale et les réponses neuronales. On soupçonne un traumatisme et ses réponses évasives au sujet de son mari et ses enfants confirment cette intuition.

Farrah s’engage dans les vies des membres de la famille Engels, s’intéresse à la sexualité confuse de Frieda, aux problèmes de financement de Milena (qui ne trouve rien de mieux à faire que d’embrasser sa femme de ménage) et à la réalité virtuelle de Jon. Inévitablement, elle finit par installer, l’un après l’autre et tous ensemble, les membres de la famille Engels devant sa lampe. La fin, poétique quoique trop littéraire, révèle finalement la quête de Farrah et nous libère tous de ce storytelling tarabiscoté et pyrotechnique, qui nous apprend qu’il faut s’intéresser à l’autre pour mieux s’entendre. Qui l’eût cru ?
Visuels : © Richard Hübner/Berlinale © Frederic Batier/X Verleih AG