Quand la liberté d’écrire devient un crime : le cas Boualem Sansal
par Camille Zingraff20.03.2025
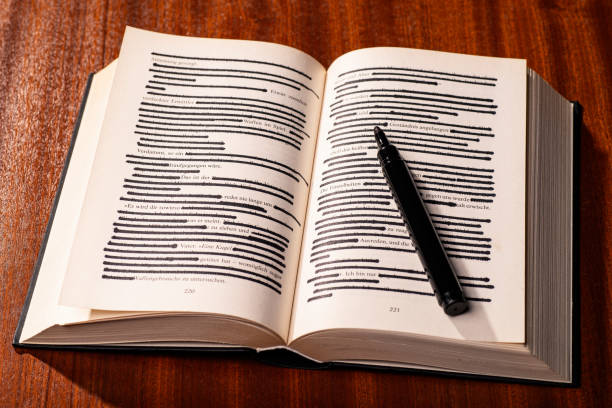
L’incarcération de Boualem Sansal à dix ans de prison questionne la liberté d’expression littéraire de plus en plus réprimée. Alors que les voix dissidentes sont muselées, la littérature reste-t-elle un espace de liberté, ou devient-elle un terrain de lutte où chaque mot coûte cher ?
Une condamnation inquiétante
Boualem Sansal, écrivain franco-algérien reconnu, est depuis toujours un auteur engagé. À travers ses romans et essais, il aborde des thèmes sensibles : les dérives autoritaires, la montée de l’islamisme radical, la critique des régimes autoritaires et la dénonciation du colonialisme. Son regard acéré sur les enjeux politiques et sociaux lui a valu autant de reconnaissance internationale que de vives critiques.
Emprisonné depuis la mi-novembre, l’écrivain a récemment quitté l’hôpital, mais demeure incarcéré en Algérie, dans un état de santé particulièrement fragile. La lourdeur de cette condamnation et le fait que celle-ci cible un intellectuel dans un tel état physique suscitent une inquiétude grandissante. En 2025, la littérature est-elle encore un espace de liberté ou est-elle désormais un terrain de répression ?
L’art et la littérature sous surveillance
La situation de Boualem Sansal incarne une étape inquiétante dans la répression des idées. Si l’histoire regorge d’exemples d’écrivains censurés, emprisonnés ou persécutés pour leurs idées, il semble que nous assistions à un phénomène plus insidieux. Ce n’est plus seulement une interdiction de leurs écrits, mais une volonté de punir les individus et de les empêcher de prendre position.
Alors que la répression idéologique s’intensifie à travers le monde et que les libertés semblent être peu à peu mises en marge, la question qui se pose n’est plus simplement théorique : peut-on encore écrire librement, sans craindre les conséquences ? Peut-on dénoncer, alerter, sans risquer l’emprisonnement, la violence, ou l’invisibilisation ?
Il y a quelques semaines, un autre exemple de censure littéraire a secoué les États-Unis. L’interdiction de Maus, le roman graphique d’Art Spiegelman retraçant l’histoire de la Shoah, a suscité un débat majeur. Cette décision, prise par certaines autorités scolaires, s’inscrit dans un contexte de contrôle idéologique grandissant et d’instrumentalisation de l’histoire, témoignant d’une volonté de contrôler les idées et d’effacer certaines mémoires.
Invisibilisation des voie.x.s marginales
Si Boualem Sansal, un écrivain mondialement reconnu, peut être ainsi emprisonné, quelle est la situation des voix moins visibles, moins médiatisées ? Quelle est la place laissée aux jeunes écrivains, journalistes ou militants dont les voix sont souvent étouffées avant même de pouvoir s’exprimer librement ? La répression idéologique, artistique et politique ne s’arrête pas aux figures célèbres ; elle frappe également ceux et celles qui, à moindre échelle, tentent de s’opposer à l’ordre établi.
En France, une autre forme de pression se fait sentir, cette fois-ci à travers le secteur éditorial. L’influence grandissante de Vincent Bolloré, un éditeur et homme d’affaires aux convictions revendiquées d’extrême droite, sur le paysage littéraire français, alerte sur les dérives de la concentration des médias et de la culture. Son empire médiatique et éditorial exerce une pression subtile, mais omniprésente sur la diffusion des idées, au point de nuire à la diversité de la pensée dans le monde du livre.
En réponse, des éditeur.ices et des acteur.ices du monde littéraire se mobilisent pour dénoncer cette situation. Depuis les législatives de juillet 2024, la campagne Désarmons Bolloré a pris de l’ampleur. Un recueil intitulé Déborder Bolloré, Faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre, soutenu par une cinquantaine d’éditeurs indépendants, paraîtra en juin 2025. Ce projet collectif est une forme de résistance face à un contrôle croissant sur la production et la diffusion des idées.
La littérature : espace de lutte et de résistance
La répression croissante de la pensée critique à travers le monde, qu’il s’agisse de Boualem Sansal, de l’interdiction de Maus ou de la concentration des pouvoirs éditoriaux en France, pose un défi majeur à la liberté d’expression. Aujourd’hui, plus que jamais, il est crucial de soutenir celles et ceux qui se battent pour maintenir la littérature et l’art comme des espaces de résistance, d’expression et de liberté.
La question n’est plus seulement de savoir si l’on peut encore écrire, mais de savoir jusqu’où ira cette répression et quel prix les écrivains devront payer pour leur liberté de parole.
visuel : ©pixels
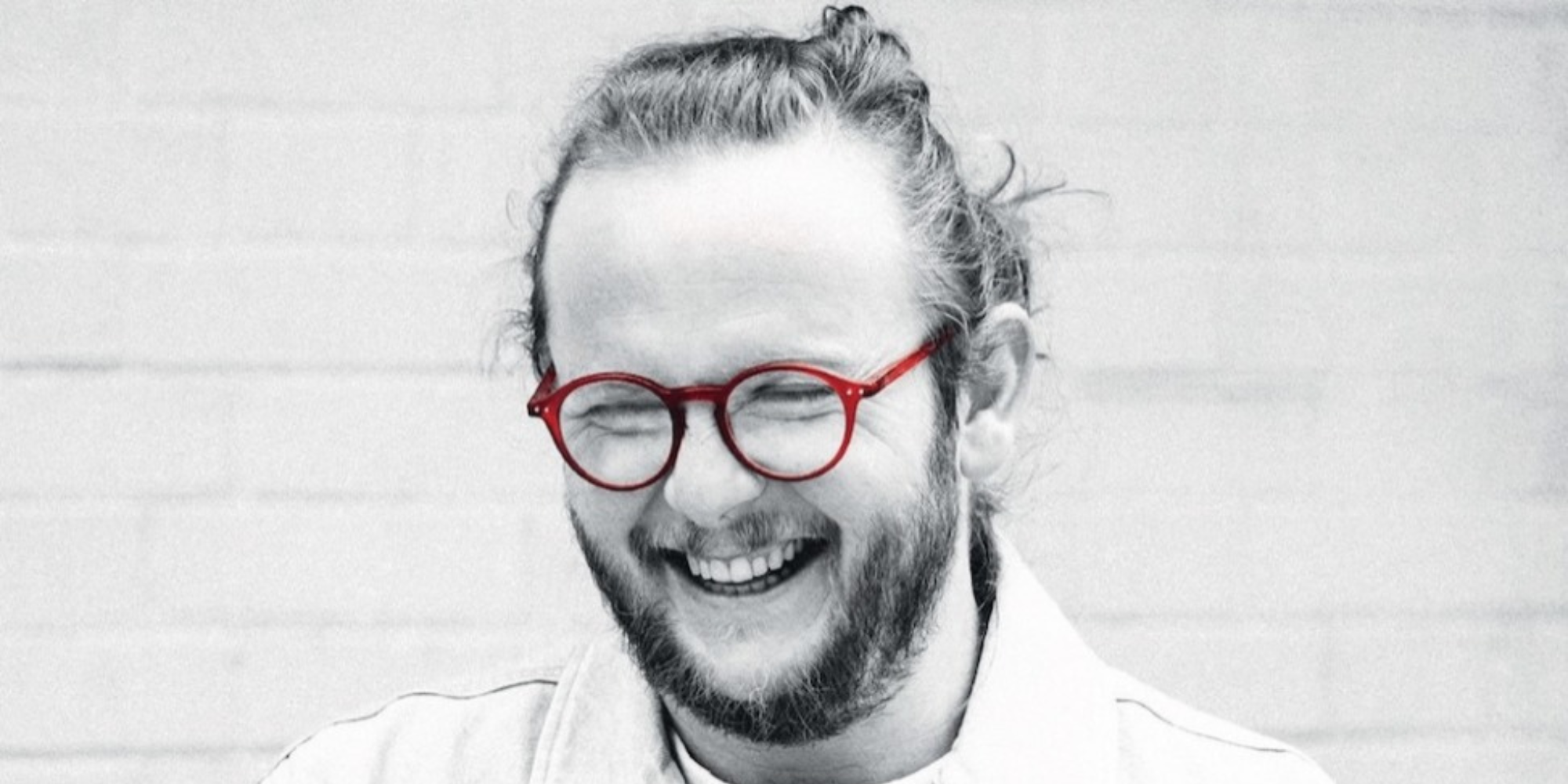
De Comedy Class à la scène : Antek entre maîtrise et retenue
par Melodie Braka30.01.2026
→ Lire l’article

Décès de la poétesse Vénus Khoury-Ghata : la poésie en deuil
par Agnès Lemoine30.01.2026
→ Lire l’article





