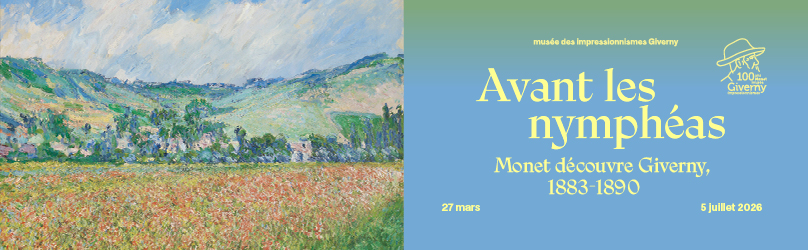Philippe Portier : « La loi de 1905 permet de rompre avec la surveillance excessive exercée par l’État sur les cultes »
par Yaël Hirsch09.12.2025

Philippe Portier, directeur d’études à l’EPHE, auteur de L’État et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité (2016) et de Les jeunes et leur laïcité (Presse de Sciences po- nous replonge dans l’esprit de la loi de 1905 pour mieux en comprendre les principes. Il évoque le caractère « extrêmement libéral » de la loi de 1905, dont l’article 4 permet aux religions de s’organiser en associations : « on arrête de surveiller de manière outrancière les cultes ». Dans cette interview donnée à Cult.news pour les 120 ans de la loi de séparation, il nous fait réfléchir en parallèle aux questions de la liberté, de la surveillance et de la coexistence.
Pourquoi cet anniversaire des 120 ans de la loi de 1905 est-il important ?
La question de l’anniversaire est intéressante parce qu’elle ne va pas de soi. Il y a vingt ans, on avait déjà organisé une commémoration de la loi de 1905, portée par l’Académie des sciences morales et politiques. Mais auparavant, il était très difficile d’entrer dans une logique de célébration pour deux raisons.
La première tient au fait que la loi de 1905 n’a pas été, à l’origine, une loi de consensus. C’était une loi de déchirement, qui opposait deux parties de notre nation. Il faut attendre 1945, et même 1965, pour que s’apaise cette fracture. Jusqu’à cette date, les « deux France » ne sont pas d’accord sur la manière d’accommoder le religieux.
Bien sûr, il existait des célébrations et des appels à la mémoire dans le camp laïque, mais pas dans le camp catholique, qui voyait encore dans la loi une entreprise non seulement anticléricale, mais antireligieuse, à l’exception de ce qu’on appelait la France séculière et laïque.
Il y at-il eu des évolutions notables au XXe siècle ?
À partir des années 1960-70, puis dans les années 1980-90, la laïcité devient une évidence plus qu’un sujet de conflit. Les deux France se réconcilient. Rosanvallon comme François Furet parlent à ce moment-là d’une « République du centre », où les souvenirs de 1789 ne déchirent plus la nation. La laïcité entre alors dans le registre des institutions invisibles de la République.
Il faut attendre les années 1990-2000 pour que la question laïque revienne, mais sur un mode très différent. Elle ne revient plus comme objet de lutte entre catholiques et laïcs, mais comme un socle nécessaire à réaffirmer dans une France qui ressent un nouveau type de déchirement : non plus entre religion et République, mais entre deux Frances, dont l’une se vit comme « communautariste », selon un concept apparu au début des années 1990.
Dans ces décennies 1990-2000, on assiste donc à une demande de remémoration liée à ce que la société perçoit comme un risque pesant sur sa cohésion. Il y a une nécessité ressentie de réaffirmer la laïcité contre les risques communautaristes et séparatistes. Mais un phénomène plus profond est également à l’œuvre : une transformation de la figure de la mémoire.
Nous ne vivons plus dans un monde « culturaliste » ; nous vivons dans un monde patrimonialiste. Dans tous les domaines, le culte de la mémoire revient dans une société qui a du mal à se projeter dans l’avenir. La laïcité devient, elle aussi, objet de commémoration, d’autant que la question occupe le devant de la scène.
Depuis 2004, on observe une multiplication de lois sur la laïcité et la séparation. Pourquoi cette inflation législative ?
Plusieurs éléments l’expliquent. Le premier tient à la hiérarchie des normes. À partir des années 2000, tous les pays européens connaissent une inflation législative concernant les questions religieuses. Partout, en droit comparé, on voit des réformes de concordats, des révisions de lois, des ajouts réglementaires : il s’agit de repenser, sous des formes nouvelles, les anciens systèmes de régulation du religieux.
La France s’inscrit dans ce mouvement général, mais avec une intensité plus forte. Nous avons vu se succéder une série de lois 2004, puis 2010, 2016, 2018, 2021, qui modifient progressivement le cadre. C’est un paradoxe intéressant : nous sommes en train de transformer la loi de 1905 au moment même où nous la sacralisons. Il y a une sacralisation du contenu, une sacralisation de la forme, mais aussi une évolution du fond.
Autrement dit, on célèbre ce grand moment qu’a été 1905 tout en admettant, sans toujours le dire publiquement, qu’il doit pouvoir faire l’objet de transformations substantielles. C’est ce double mouvement qui produit l’inflation législative.
Il faut également comprendre le contexte : la montée en puissance des religions dans l’espace public, l’interrogation sur le sens de l’avenir, le souci de cohésion sociale et politique. Tout cela nourrit un appel à la loi de 1905, dont on valorise les règles et les valeurs, mais que l’on juge, en pratique, insuffisante pour répondre aux problèmes contemporains.
C’est pourquoi on lui adjoint d’autres textes, qui viennent alourdir et compléter son architecture initiale.
Qu’apporte la constitutionnalisation de la loi de 1905 ?
Depuis une quinzaine d’années, plusieurs propositions plutôt situées à gauche cherchent à sacraliser la loi de 1905 au niveau constitutionnel, ou à ajouter à la Constitution des éléments liés aux questions religieuses, ce qui n’existait pas dans la Constitution de 1958. En 2012, dans son Discours du Bourget, le Président François Hollande proposait de constitutionnaliser l’article 2 de la loi de 1905. Il envisageait d’inscrire, dans le titre Ier de la Constitution, d’abord l’article 1, déjà constitutionnalisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, garantissant la liberté de conscience et de culte, puis l’article 2 affirmant la séparation : « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. » Autrement dit : aucune subvention, aucun soutien de l’État, ni symbolique ni financier. Mais, le jour même, il a reçu des appels de sénateurs socialistes d’Alsace-Moselle rappelant que leur région est encore placée sous Concordat. Les statuts d’Alsace-Moselle et des territoires ultramarins ne relèvent pas de la loi de 1905. Leurs positions restent minoritaires et largement inaudibles dans l’opinion publique. À l’autre bout du spectre politique, on trouve une autre forme de revendication : celle de constitutionnaliser non pas la séparation, mais les « racines chrétiennes » de la France, une idée défendue par une partie de la droite et de l’extrême droite. Ces propositions sont complexes, souvent contradictoires, et n’ont pas été retenues jusqu’ici. Mais, avec les évolutions politiques contemporaines notamment l’arrivée du Rassemblement national au pouvoir, ces débats pourraient réapparaître.
Pouvez-vous nous replonger en 1905 et nous aider à comprendre l’esprit de la loi ?
En effet, pour comprendre ce qui s’est passé ensuite, il faut revenir à ce qu’est véritablement la loi de 1905. Elle rompt avec la surveillance très lourde que l’État exerçait sur les cultes sous le régime concordataire. Le législateur de l’époque considère que le Concordat n’était « pas si mal » pour contrôler l’Église catholique, mais que cette dernière en avait profité pour devenir un véritable instrument de gouvernement, un contre-pouvoir, hostile à l’émancipation de l’opinion. Le Concordat reposait sur une vision assez voltairienne selon laquelle l’État et l’Église pouvaient, ensemble, défendre l’ordre public. Or ce n’est pas ce qui s’est produit : face à la modernité, l’Église adopte une position de plus en plus intransigeante. Pour les républicains attachés à la modernité politique, la séparation devient alors nécessaire. Il s’agit de rompre avec deux éléments clés : 1/ La protection privilégiée accordée aux Églises, surtout à l’Église catholique, par l’État et 2/ La surveillance excessive exercée par l’État sur les cultes. La loi de 1905 n’accorde pas seulement aux croyants la liberté individuelle de pratiquer leur religion ; elle laisse aussi les Églises s’organiser selon leurs propres règles, dans un cadre maîtrisé. C’est, fondamentalement, une loi très libérale en matière religieuse. L’article 4, notamment, permet aux cultes de s’organiser en associations en fonction de leurs structures propres.
Comment la place de la loi de 1905 a-t-elle évolué dans le débat public en 120 ans ?
Longtemps, cet esprit de la loi est conservé. Dès 1911, on crée le Bureau central des cultes. C’est un point important : l’État ne cherche pas à ignorer les cultes, mais à les organiser, de manière à leur laisser une latitude sans leur permettre d’intervenir dans la fabrication de la loi. Après la Seconde Guerre mondiale, les politiques publiques évoluent en deux grandes phases. Puis, dès les années 1960-1970, la question de l’identité devient centrale. On voit se développer des politiques de reconnaissance : aide financière, droits subjectifs, soutien accru aux cultes. De Gaulle met en place la contractualisation avec les écoles privées catholiques et juives, qui sont désormais subventionnées. L’idée se répand que les religions doivent être davantage soutenues. Et l’exercice de la liberté de culte prend une dimension plus subjective. En parallèle, l’État continue progressivement de cesser de surveiller les cultes, notamment avec les déclaration des catholique de France, après 1945 et Vatican II, d’accepter pleinement la séparation. Alors qu’un pacte de confiance se noue entre l’État et les cultes historiques, un changement majeur intervient ensuite avec l’islam. Dans les années 1980 et 1990, cette religion devient un acteur plus visible dans l’espace public et porte une identité que les pouvoirs publics n’attendaient pas. Cela déclenche une série de projets de loi cherchant à placer l’Islam sous un contrôle plus étroit que celui exercé sur les deux autres monothéismes. Face à ce qui est perçu comme le caractère « incontrôlable » d’une partie de la communauté musulmane, dans un contexte national et international marqué par des violences extrêmes, se succèdent des lois de vigilance et de contrôle. Catholiques et protestants protestent régulièrement, rappelant le principe d’égalité de droit entre cultes et demandant un sursis dans cette surveillance asymétrique. Parallèlement, de nombreuses propositions, à l’Assemblée ou au Sénat, visent à limiter la visibilité religieuse dans l’espace public. La loi de 2021, notamment, réorganise en profondeur la structuration interne des communautés de croyance.
Quels sont les enjeux de cette loi de 1905 pour nous, 120 ans après ?
La loi de 1905 permet un régime de liberté qui organise la coexistence des convictions pour garantir l’unité civique. A la question de savoir si une société peut vivre dans l’éclatement des identités, elle est garante de la préservation de cette cohésion qui nous manque.
Visuel (c) DR

Fabio Sinacori nous parle du 23e Lille Piano(s) Festival
par Yaël Hirsch12.03.2026
→ Lire l’article

Dead South transforme l’Olympia en Grand Ole Opry House le temps d’une soirée
par Yves Braka12.03.2026
→ Lire l’article