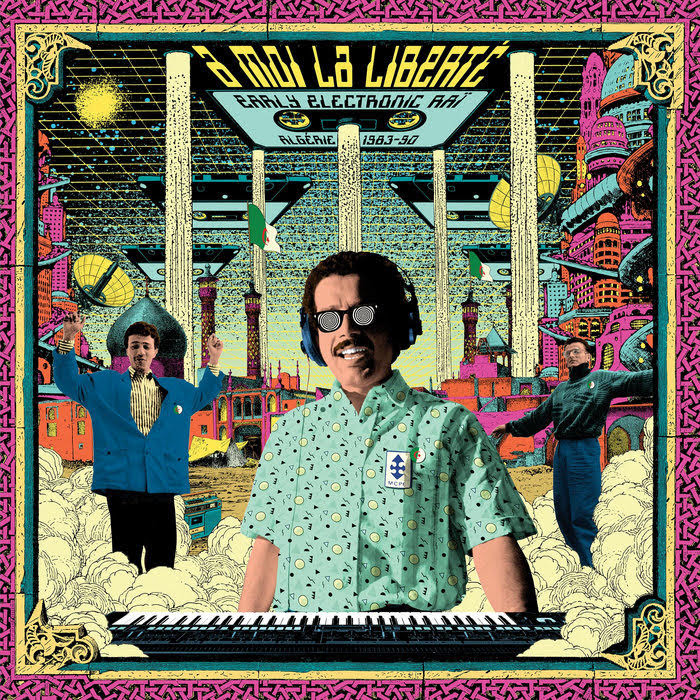Le Palais de Tokyo, retour sur un lieu unique
par Fiona Fondelot et Rose McCloud-Lieber02.09.2025

Le Palais de Tokyo nous a ouvert ses portes pour (re)découvrir ce lieu unique. Nous avons pu visiter en détail le Palais de Tokyo et interroger le directeur des lieux, Guillaume Désanges, sur ce musée de l’ouest parisien, son histoire, ses expositions passées et futures. L’occasion de replonger dans cette adresse parisienne qui nous réserve encore de belles découvertes.
Le palais de Tokyo, avec ses 22 000 m2 de surface d’exposition, est aujourd’hui le plus grand centre d’art contemporain d’Europe. Pourtant, il n’est dédié à cela que depuis 2002 ; revenons ensemble sur l’histoire mouvementée du Palais de Tokyo.
Un lieu à l’histoire palpitante
L’histoire du Palais de Tokyo remonte au début du XXe siècle. À cette époque, les œuvres d’artistes vivant•es étaient exposées majoritairement entre le Musée du Luxembourg, le pavillon de l’Orangerie et la galerie du Jeu de Paume, avec des spécificités pour chacun de ces lieux : le premier n’accueillait que les œuvres du Salon, relais de l’art officiel, le deuxième s’ouvrait à l’art des Impressionnistes et abritait notamment le legs du peintre et collectionneur Gustave Caillebotte, tandis que le troisième, lui, exposait surtout la collection des œuvres étrangères. Pourtant, chacun de ces trois lieux manquait de place par rapport à l’ampleur des collections.
C’est donc dans ce contexte, ainsi que dans celui de la création de grands musées d’art moderne à l’étranger tel que le Museum of Modern Art de New York en 1929, que Louis Hautecoeur, alors conservateur du musée du Luxembourg, envisagea la fondation d’un nouveau lieu d’exposition pour l’art moderne.
L’incubateur de cette volonté fut l’Exposition internationale des arts et techniques de la vie moderne de 1937. Elle permit aux architectes Jean-Claude Dondel, André Aubert, Paul Viard et Marcel Dastugue de gagner le concours d’architecture organisé pour l’occasion, et le président de la République Albert Lebrun inaugura donc le 24 mai 1937 le Palais des musées d’art moderne, bâtiment que nous connaissons encore de nos jours sur l’actuelle avenue du Président Wilson. Il était à l’époque destiné à accueillir dans son aile Est le Musée d’art moderne de la Ville de Paris, toujours en place aujourd’hui, et dans son aile Ouest le Musée national d’art moderne – l’actuel Palais de Tokyo. Ce Musée national d’art moderne était alors composé notamment des collections d’art contemporain français du Musée du Luxembourg et des collections d’art contemporain étranger de la galerie du Jeu de Paume.
Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale repoussa l’ouverture officielle des musées, notamment en raison du transfert des œuvres en province face à la menace de réquisition par le gouvernement allemand. Fin 1941, les sous-sols des deux musées ont d’ailleurs été réquisitionnés et transformés en magasins de séquestres de biens juifs spoliés. Du mobilier, notamment des centaines de pianos, fut entreposé dans l’aile Ouest, et des caisses de vêtements et des effets personnels dans l’aile Est.
Le nom de Palais de Tokyo que nous connaissons aujourd’hui n’apparut donc qu’avec l’inauguration officielle du centre d’art par Georges Salles le 9 juin 1947, soit dix ans après la construction de l’édifice. Étant situé sur ce qui s’appelait à l’époque « avenue de Tokio » – baptisée ainsi en 1918 lorsque le Japon était allié de la France, et rebaptisée « avenue de New-York », son nom actuel, en 1945 après la Libération de la France par les États-Unis – le nom « palais de Tokyo » fut trouvé assez naturellement.
Mais l’histoire du Palais de Tokyo ne s’arrête pas du tout là : ce qui était à l’époque le Musée national d’Art moderne voit son titre lui échapper en 1977 lors de l’inauguration du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou. Une large partie des collections y est transférée, et les œuvres restantes rejoignent à leur tour le musée d’Orsay à son inauguration en 1986. Le Palais de Tokyo connaît alors près de 25 ans d’errance, accueillant au fil des années le Musée d’Art et d’Essais aux collections hétéroclites, les réserves du Fonds national d’art contemporain (FNAC), l’Institut des hautes études en arts plastiques, le Centre national de la photographie, ou encore l’école de cinéma la Fémis. Il est même question en 1986 sous l’initiative du ministre de la culture Jack Lang et de son conseiller Marc Nicolas de transformer le lieu en un « Palais du cinéma » ou « Palais des arts de l’image » constitué de la Cinémathèque française, de l’Institut National de Formation aux Métiers de l’Image et du Son et le Centre national de la Photographie – on peut d’ailleurs encore voir quelques traces de ce projet sur les murs du bâtiment. Pourtant, notamment pour des questions d’évolution du contexte politique, le projet est définitivement abandonné en 1998.

En juillet 1999, la ministre de la Culture et de la Communication Catherine Trautmann lance un concours en vue d’affecter une partie de l’aile Ouest du bâtiment à la diffusion de l’art contemporain. Les premiers directeurs en sont Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans. Une partie des espaces intérieurs est réhabilitée par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, permettant l’inauguration officielle du Palais de Tokyo, tel que nous le connaissons aujourd’hui, le 22 janvier 2002.
Un centre d’art original
Le Palais de Tokyo mise depuis quelques années sur des médiations spécifiques et originales qui cherchent à se rapprocher d’un aspect plus sensible que purement pédagogique. Les idées phares sont de sensibiliser et de se rapprocher du public sur des sujets tels que l’art, mais pas toujours. Le lieu met par exemple en place plusieurs activités autour de la santé mentale, thème qui tient particulièrement à cœur au centre d’art depuis plus de vingt ans comme l’explique Guillaume Désanges, président du Palais de Tokyo :
« Le Palais de Tokyo a travaillé concrètement la question de la santé mentale dans des expositions comme Toucher l’insensé mais aussi avec l’artiste Mohamed Bourouissa, deux ans avant que celle-ci devienne une cause nationale et qu’on en parle dans les journaux. Le Palais de Tokyo a été à ce moment-là et est toujours précurseur d’un certain nombre de sujets. »
Le lieu met un point d’honneur depuis 2016 à favoriser l’accès de l’art et de la culture pour toustes avec des thématiques qui ciblent les plus jeunes, les personnes précaires ou encore les personnes en situation de handicap. Le Palais de Tokyo veut donc accueillir un public varié via ses médiations, et crée pour cela des activités variées pour des publics allant d’individuels à des groupes en passant par des structures médicales ou médico-sociales avec des possibilités de visites scolaires, LSF, sensorielles, etc… selon les besoins.
Les projets de médiation sont centrés en un lieu : le Hamo, un espace qui se trouve au milieu du Palais, entre la librairie et la grande salle d’exposition au premier étage. Pour la saison estivale, celui-ci se transforme en camp d’été avec des espaces ouverts de narration, de créations et d’expériences ludiques. Vous pouvez en trouver ici le programme.
Le palais de Tokyo marque donc son originalité et sa volonté d’innovation et d’inclusion à travers ces projets de médiations mouvantes et adaptées à une grande diversité de publics, mais également avec un modèle économique assez singulier, différent des autres musées parisiens : c’est un lieu qui repose sur 60% de recettes propres, contre 40% pour la plupart des musées nationaux. Pour cela, le Palais de Tokyo s’appuie notamment sur de nombreuses concessions – une librairie à la sélection fascinante que nous vous conseillons vivement, des restaurants, la boîte de nuit le Yoyo… – mais aussi sur des privatisations : de nombreuses salles, surtout au deuxième étage du centre d’art, sont réservables pour de grands événements comme des défilés ou des événements professionnels.

Projet de permaculture institutionnelle : pour un site de création contemporaine vivant et productif
Il y a dans le Palais de Tokyo, notamment avec l’arrivée du directeur Guillaume Désanges en 2022, une volonté de changements écologiques face à la crise climatique. Conscient du « art washing » et des enjeux écologico-politiques, Guillaume Désanges propose un projet de grande envergure pour le Palais de Tokyo : celui de permaculture institutionnelle.
C’est avec cette notion que le Palais de Tokyo essaie de penser des modes de programmation et de production vertueux et responsables. Que ce soit dans les thèmes d’expositions, dans des actions de recyclage ou encore dans la minimisation des empreintes carbones, la permaculture du Palais de Tokyo impose son esprit à l’ensemble de l’institution.
Techniques de zonage, alternance d’espaces d’expositions avec des friches (sortes de résidences d’artistes sans obligation de résultat), idée donc d’un partage raisonné de l’espace du Palais, notion de circuit court avec une attention particulière à la création et à la culture locale, mécénats durables, pas de climatisation dans la grande salle mais une ouverture régulière de la serre pour laisser passer la lumière naturelle et l’air frais… nombreuses sont les idées promues par le lieu.
Tout est envisagé pour un futur plus responsable et soucieux des enjeux écologiques.
Des expositions dans l’air du temps
« Il s’agit de s’inspirer de l’air du temps, des questionnements qui nous paraissent intéressants mais de ne pas non plus les suivre complètement et d’être toujours attentif à ce qui va éclore par la suite. Nous sommes des lieux qui à travers l’art permettent à notre public de s’ouvrir à des questionnements qu’ils n’avaient pas forcément avant, et c’est là toute la beauté et la dignité de nos missions. »
Voilà ce qu’exprime Guillaume Désanges lorsque l’on évoque les expositions du Palais de Tokyo et leur rapport aux tendances du monde artistique. Ces choix d’exposition, nous explique-t-il, sont le fruit d’un mélange de subjectivité – induisant nécessairement une part de risque et d’audace – et d’une forme d’objectivité répondant à différents critères. En effet, le centre d’art se fixe comme objectif de répondre à la diversité contemporaine, que se soit en termes de médium, de sujets ou d’artistes, en favorisant tout de même les artistes vivant•es et avec une attention particulière à la scène française. En lien avec son projet de permaculture, une attention importante est évidemment également portée à l’écologie.
Pour terminer la saison en beauté, le Palais de Tokyo nous propose donc une sélection d’artistes varié·es qui s’aligne avec ces volontés.
Ainsi, plusieurs artistes se déploient actuellement dans les somptueux lieux du Palais telle que l’artiste vietnamienne Thao Nguyen Phan avec son exposition Le soleil tombe sans un bruit, visible dans trois des salles. L’artiste nous invite dans sa représentation des paysages du Vietnam et de ses traditions à travers plusieurs dispositifs artistiques comme des vidéos, des aquarelles sur soie ou encore des manuscrits. Elle nous raconte sa vision de l’histoire du pays, entre passé et présent, entre histoire du colonialisme et tradition ancienne.
Dans cette même volonté, on retrouve l’artiste Chalisée Naamani, franco-iranienne qui nous partage dans son exposition Octogone un sublime mélange entre tissus traditionnels, art du combat et vie quotidienne.
On retrouve d’autres artistes comme Vivian Suter et ses centaines de peintures sur tissus déployées dans la verrière du Palais de Tokyo, ou encore le style alternatif des années 2000 de l’artiste Rammellzee avec Alphabeta Sigma (Face A).

Les expositions se tenaient jusqu’au 7 septembre 2025.
Le Palais de Tokyo tient sa promesse d’innovation et d’originalité artistique, renouvelée pour sa nouvelle saison.
Et la suite ?
Le palais de Tokyo nous réserve encore quelques belles surprises pour la rentrée avec ses expositions à venir, avec en direction artistique la commissaire états-unienne Naomi Beckwith, curatrice en cheffe du Musée et de la Fondation Solomon R. Guggenheim.
Pour cette nouvelle saison, elle nous invite à nous interroger sur les relations artistiques et intellectuelles entre la France et les États-Unis, notamment avec l’exposition monographique de Melvin Edwards et l’exposition Echo Delay Reverb qui rassemble 60 artistes étatsunien.n.es.
L’exposition permet d’exposer à travers le prisme étasunien comment la philosophie française et l’art français se sont imposés dans les mouvements des USA – des sujets d’exposition qui restent de belles coïncidences quand on connaît les relations délicates actuelles qu’entretiennent les États-Unis avec l’Europe. Le Palais de Tokyo témoigne de sa sensibilité pour l’art et les réflexions sociales et politiques qui l’entourent.
Ce lieu d’exposition nous réserve donc encore de nombreuses surprises et toujours plus de variété et d’expérimentation dans ses choix qui ne peuvent que nous réjouir. Une saison se ferme bientôt mais l’avenir reste prometteur au Palais de Tokyo.
Visuels : © Palais de Tokyo
Toutes les informations sur le Palais de Tokyo à retrouver sur leur site internet.

Catherine Pégard devient ministre de la Culture
par Amélie Blaustein-Niddam26.02.2026
→ Lire l’article

Willie Colón, figure emblématique de la Salsa, est décédé ce samedi 21 février 2026
par Agnès Lemoine26.02.2026
→ Lire l’article