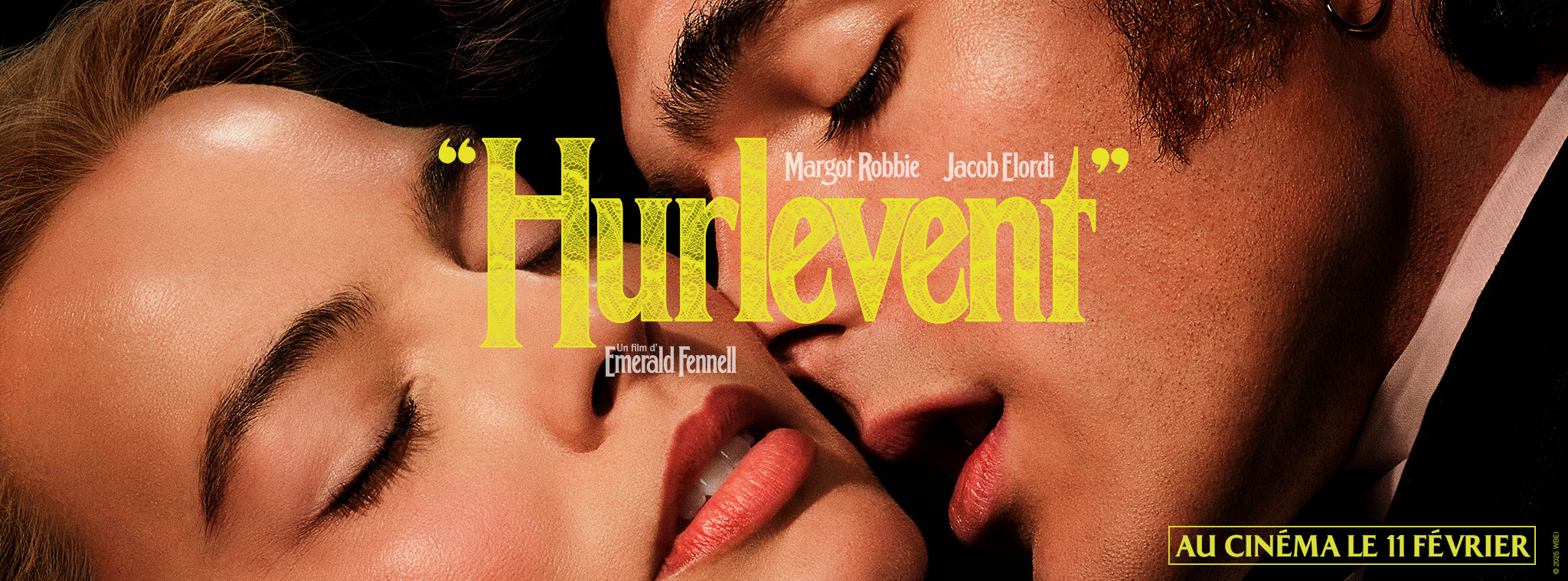« L’Injustice en héritage » : Mélanie Plouviez explore un siècle de réflexion sur l’héritage
par Julia Wahl30.03.2025
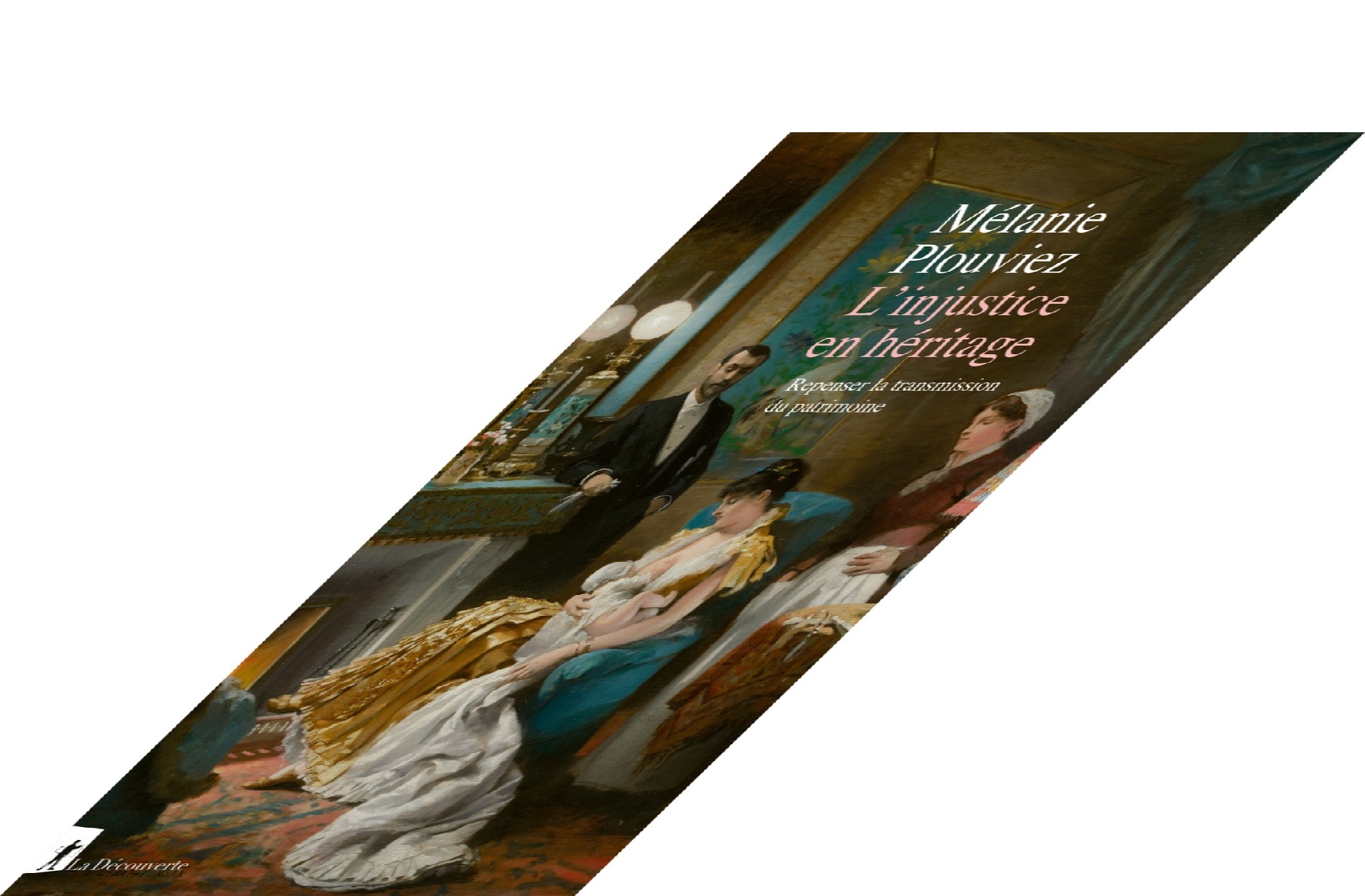
Philosophe, Mélanie Plouviez s’est spécialisée dans la philosophie sociale et politique et coordonne un projet consacré à l’étude des pensées de l’héritage, PHILHERIT. C’est une somme de ses lectures qu’elle nous livre dans L’Injustice en héritage.
Une histoire des pensées de l’héritage
Les travaux de Piketty ont rappelé voilà quelques années que le capital familial était, loin devant les écarts salariaux, la principale source d’inégalité. Dans son travail documenté, il mettait en évidence non pas la raréfaction de ces richesses héritées, mais au contraire leur sempiternel accroissement : aujourd’hui plus qu’hier – et peut-être moins que demain -, l’héritage a vocation à distinguer les riches des pauvres. Ce constat pose question dans une société qui prétend placer le mérite individuel en son cœur. Pourtant, constate Mélanie Plouviez, le rejet de la fiscalité successorale est massif en France, y compris chez les classes les plus populaires. Comment comprendre ce paradoxe ?
Disons-le d’emblée : elle n’y répondra pas. D’abord parce que, sans doute, nul·le n’a d’explication satisfaisante, mais aussi parce que, tout simplement, ce n’est pas son sujet. Elle va bien plutôt se livrer à une histoire des pensées de l’héritage, qui commence à la Révolution et s’achève sous sa plume à Durkheim. Spécialiste du XIXe siècle, Mélanie Plouviez traitera en effet peu des XXe et XXIe siècles, sinon en introduction et en conclusion.
Un panorama stimulant
Ce panorama des pensées de l’héritage est particulièrement stimulant en ce qu’il rappelle entre autres choses que l’égalité devant le capital hérité n’est pas seulement affaire de justice sociale, mais aussi de justice familiale. Alors que, sous l’Ancien Régime, les aînés (mâles) et les enfants légitimes héritaient de l’essentiel, la Révolution ouvre son égal accès aux filles, aux cadet·tes et puîné·es, ainsi qu’aux enfants né·es en-dehors de l’union officielle. Il s’agit là d’une nouveauté qui permettra de penser différemment le capital familial.
La philosophe se livre ensuite à un résumé des contributions des différents philosophes et sociologues à la réflexion. Nous y côtoyons notamment Mirabeau, Fichte, qui théorisent une forme de socialisation de l’héritage, les saint-simoniens et enfin Durkheim, dont Mélanie Plouviez est spécialiste. Si elle se concentre sur ces différentes figures, elle a à cœur d’en tirer des conclusions propres à éclairer et orienter le monde d’aujourd’hui. Ainsi du rapport entre héritage et État, le second étant volontiers accusé de capter le premier. Elle rappelle au contraire que c’est l’État qui crée les héritier·es, au sens où il assure la légalité de la transmission du capital au sein de la famille.
Toutefois, l’organisation du livre autour de la seule chronologie lui donne une orientation téléologique : la philosophe s’arrêtant à Durkheim, elle donne la fausse impression que toute pensée de l’héritage s’arrêterait à l’auteur des Formes élémentaires de la vie religieuse. Cela confère à celui-ci une place à part, en surplomb des autres penseurs dont il serait le maître. Cela n’empêche pas L’Injustice en héritage d’être précieux par l’érudition qu’il convoque, mais cela biaise la réflexion et laisse le lecteur et la lectrice quelque peu sur leur faim.
Mélanie Plouviez, L’Injustice en héritage, éditions La Découverte, 2025.
Visuel : couverture du livre (détail)
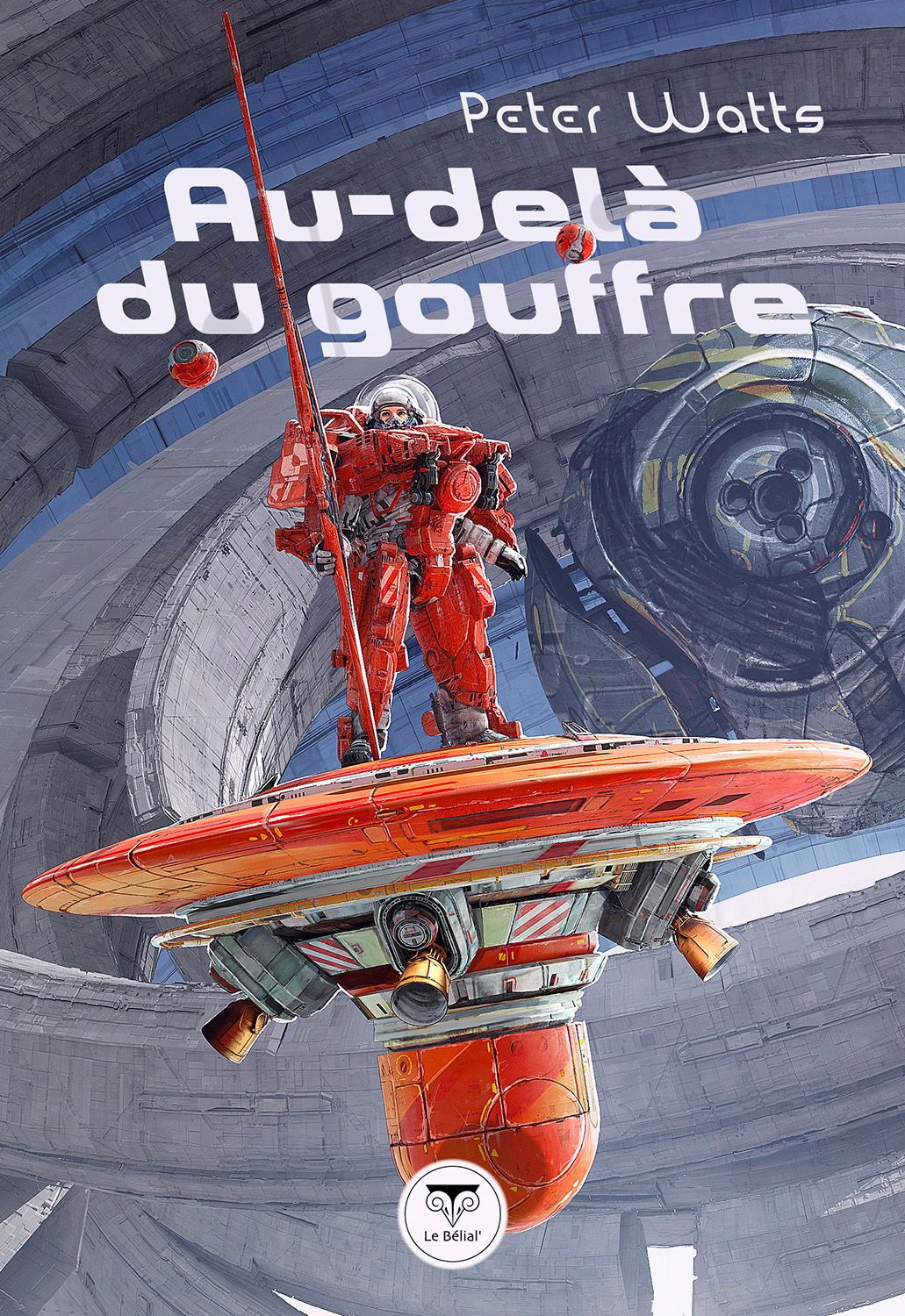
« Au-delà du gouffre » de Peter Watts : des nouvelles de hard SF
par Julien Coquet11.02.2026
→ Lire l’article
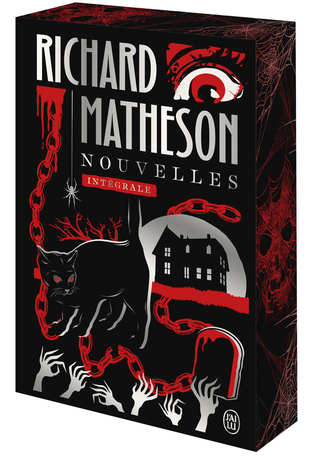
Intégrale des nouvelles de Richard Matheson : un maître de la littérature de genre
par Julien Coquet11.02.2026
→ Lire l’article