Le pianiste Ivo Pogorelich : « Je suis au service du compositeur, rien de plus. »
par Hannah Starman01.11.2025
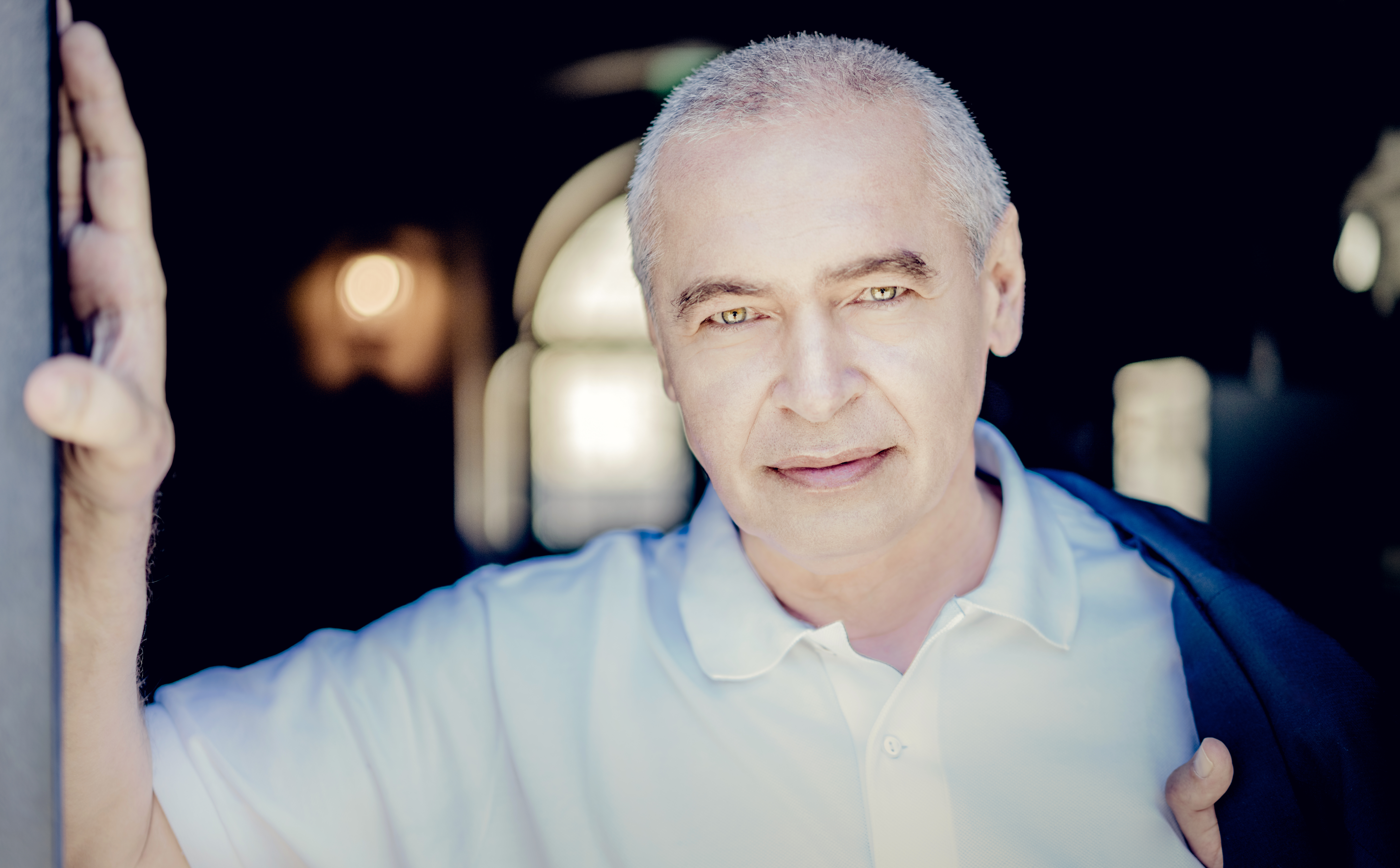
Nous avons échangé avec le célèbre pianiste croate quelques jours avant son concert très attendu à la Philharmonie de Paris. Après un récital de Chopin, Sibelius et Schubert en novembre 2024, Ivo Pogorelich revient à la Philharmonie avec trois sonates emblématiques de Beethoven – la « Pathétique », « La Tempête » et « Appassionata » – et partage avec nous ses réflexions sur la musique et son étonnante histoire.
Le 9 novembre, à la Philharmonie de Paris, vous allez jouer un programme 100 pourcent Beethoven. Comment avez-vous choisi les œuvres ?
Les trois sonates appartiennent à différentes périodes créatives de la vie de Beethoven. Je trouve que sa musique est sous-estimée et insuffisamment comprise. C’est un compositeur qui a fait progresser la musique pour piano et les possibilités de l’instrument sous les doigts d’un artiste. Le piano en tant qu’objet n’était pas aussi développé à son époque, mais la vision de Beethoven a ouvert les portes de la virtuosité des périodes ultérieures, en termes d’équipement technique et de capacité technique d’un instrumentiste. Ainsi, dans la « Pathétique » ce qui était révolutionnaire pour l’époque, c’était les intonations et les accords dissonants qui sont devenus un matériau dramatique pour la pièce. La dissonance n’était pas utilisée de cette manière avant lui. Dans « La Tempête », la deuxième sonate du programme, on peut dire qu’il s’agit d’un mouvement vers le romantisme où le piano joue un rôle très introspectif et intime.
Dans la troisième sonate du programme, « Appassionata », on aborde l’instrument comme s’il s’agissait d’un orchestre. Il y a donc une orchestration de la partie piano avec tout le matériel très étendu, très long et très élaboré, y compris le matériel monothématique avec le motif qui se développe tout au long de la pièce. Les deux miniatures du programme [Bagatelle op. 126 n° 3] sont issues d’une inspiration complètement différente. Mais ici, nous isolons également certaines nuances et ambiances avec des changements persistants de dynamique, mais le même matériau est utilisé encore et encore, ce qui conduit à des variations de ton et d’expression. Beethoven expérimentait inlassablement et sa musique était toujours riche en inventions.
Quelle est l’importance de cette musique pour vous ?
J’ai vécu une expérience traumatisante avec la première pièce du programme, à laquelle on attribue un titre qui n’aurait jamais dû être associé à cette œuvre. Le terme « Pathétique » est vraiment trompeur, car le pathos est complètement étranger à l’esprit de cette pièce dynamique, pleine de vie et de charme. Ce n’est pas parce que l’introduction en do mineur est incroyablement inspirante qu’il fallait la nommer ainsi.
Quoi qu’il en soit, mon professeur de l’époque m’avait plus ou moins imposé cette œuvre et j’étais trop jeune pour la jouer. Je n’avais pas plus de 10 ans et je me sentais complètement démuni. Frustré aussi car j’aimais cette pièce, mais je ne me sentais pas prêt, et je ne pensais pas non plus avoir étudié auparavant chez Beethoven quoi que ce soit qui aurait pu me préparer à cela ou qui aurait justifié un tel choix. Les professeurs sont toujours dans une position difficile. Ils doivent toujours demander à un élève ou à un étudiant de jouer quelque chose qui est à la limite de ses capacités afin de développer ces capacités. Mais parfois ils commettent aussi la grave erreur de pousser l’élève dans une impasse, et c’est ce que j’ai ressenti à l’époque. J’ai donc attendu de nombreuses années. Et puis, un jour, comme j’ai pu le faire avec d’autres œuvres de mon enfance, j’ai décidé de la relire et de la préparer. C’est une pièce que je joue aujourd’hui après une interruption d’un demi-siècle.
Comment préparez-vous une partition ?
Il suffit de travailler. Il n’y a rien d’autre. Il n’y a pas de secret. Il faut essayer de trouver la correspondance entre les instructions écrites et l’instrument, chercher des indices et s’appuyer sur son expérience, mais aussi parfois sur certains aspects plutôt cachés de ce qui est écrit. C’est donc un processus actif, qui ne s’achève jamais vraiment. Il ne peut s’achever, car la musique classique est une forme d’art très plastique, et chaque génération tente d’y apporter sa contribution. Certaines générations passent sans découverte notable ou significative, mais parfois, une génération fait ressortir certaines caractéristiques, certains aspects, certains traits de la musique qui n’avaient pas été relevés ou soulignés auparavant.
Lorsque vous abordez une partition, puisez-vous en vous-même, ou essayez-vous de vous mettre complètement en retrait ?
Vous ne pouvez jamais vous libérer complètement de vous-même, mais bien sûr, la priorité est de rendre l’œuvre au compositeur qui, très souvent, est mort depuis longtemps. Et la musique sans l’interprète resterait une lettre morte sur papier, des feuilles posées sur une étagère. Il y a donc certainement un élément des deux, mais plus l’interprète intervient tardivement, mieux c’est. Je suis au service du compositeur, rien de plus.
Est-ce qu’un compositeur comme Beethoven peut vous dévorer ?
Il y a une résistance naturelle, c’est pourquoi nous sommes des individus et non des clones. S’il était possible de transmettre à 100 pourcent le contenu d’une œuvre, ou de transmettre tout type de connaissance ou de sagesse, un simple élève de Léonard de Vinci deviendrait le prochain Léonard de Vinci. Mais la nature humaine interfère dans ce processus. Pour moi, c’est un mystère de savoir comment un individu réagit, ce que le travail d’un compositeur éveille réellement, ce qu’il induit réellement et comment la braise s’enflamme. Je pense que c’est un mystère.
Découvrez-vous encore de nouveaux répertoires, abordez-vous de nouvelles partitions ?
Oui, toujours, j’essaie toujours. Par exemple, l’année prochaine, au programme du récital, j’aurai deux pièces de compositeurs différents, l’une de Brahms et l’autre de Ravel, que je n’ai pas jouées depuis 30 ans. Et j’ai récemment relu le matériel, et c’est surprenant ce qui remonte à la surface, même au premier regard sur le matériel avec ce recul du temps.
Qu’est-ce qui vous anime ou vous inspire quand vous n’êtes pas derrière votre piano ?
Comme tout le monde, j’ai des sources d’inspiration variées. Le problème, c’est qu’en raison de l’aspect physique de ma profession, je suis très limité à certains égards. Je ne peux pas jouer au tennis et je ne peux pas faire de vélo, car c’est considéré trop dangereux. C’est la raison pour laquelle je ne peux pas et je n’ai jamais pu, même enfant, pratiquer des sports de compétition ou d’équipe comme le volley-ball ou le basket-ball, etc. J’ai eu beaucoup de chance, car de 15 à 22 ans, j’ai pratiqué le yoga quotidiennement. J’ai rencontré quelqu’un qui l’avait étudié au Vietnam. Mais à un moment donné, j’ai senti que j’avais atteint une limite et que cela devenait répétitif. Je ne pense pas que nous, ici en Europe, puissions adopter complètement et totalement quelque chose qui vient d’une culture complètement différente et lointaine. Et je ne pense pas que nous puissions adopter et comprendre pleinement la profondeur du yoga en tant que philosophie. Et puis, j’aime le bon cinéma, le théâtre, d’autres formes d’art.
D’autres formes de musique aussi ?
J’aime beaucoup écouter de la musique ethnique et je considère que les artistes de musique ethnique sont supérieurs en termes de qualité de ce qu’ils produisent et reproduisent. Compte tenu du fait qu’ils apprennent le répertoire, parfois des membres de leur famille, et qu’ils chantent des chansons traditionnelles connues depuis des siècles, leur capacité de transformer et de faire ressortir toutes les expressions sans tomber dans la vulgarité ou la caricature témoigne, à mon sens, d’un très haut niveau de qualité interprétative pour un artiste. Et je pense que nous, en tant qu’interprètes de musique classique, devrions être davantage exposés aux chefs-d’œuvre de la musique ethnique, quelles que soient leurs origines, et les étudier davantage que nous ne l’avons fait. J’aimerais que nous ayons plus de temps à consacrer à ce type de musique.
Bella Bartók a beaucoup utilisé la musique ethnique.
Oui, bien sûr. Il a fait des recherches, mais c’était un homme extraordinaire. Il parlait 42 langues et 70 dialectes. C’est ce que m’a raconté György Sándor, qui était son élève et très proche de lui. Bartók était un homme incroyablement doué, et il voyageait beaucoup. Il s’intéressait également au chant sur des quarts de ton, et il a visité les îles de l’Adriatique, où, enfant, j’ai eu l’occasion d’entendre un chant quart-tonal une fois. C’était sur l’île de Pag, d’où est originaire la famille de mon grand-père. C’est très intéressant. Mais je fais davantage référence aux chansons et aux danses qui ont inspiré des compositeurs tels qu’Enrique Granados, par exemple, qui a écrit ses Douze danses espagnoles [Doce danzas españolas, Op. 37], etc.
Il est incroyable que l’une des danses ait un contenu presque identique à une chanson urbaine de Sarajevo. Je pense donc qu’elle a été répandue par les Juifs qui ont quitté la péninsule ibérique après en avoir été expulsés [en 1492]. Certains d’entre eux se sont retrouvés à Sarajevo, qui jouissait à l’époque du statut de port franc. De nombreux érudits et intellectuels y sont restés, alors que les marchands se sont installés plutôt à Constantinople. Il existe même encore aujourd’hui une langue, le ladino, que parlent les Juifs de Constantinople, ou Istanbul actuelle. La façon dont la musique a voyagé est étonnante. Ce sont là des trésors musicaux, et j’espère que nous pourrons en apprendre davantage à l’avenir.
Vous retournerez à la Philharmonie avec Martha Argerich pour un programme consacré à Chopin en mai 2026.
Je préfère ne pas parler de mes projets futurs.
Visuels : © Andrej Grilc








