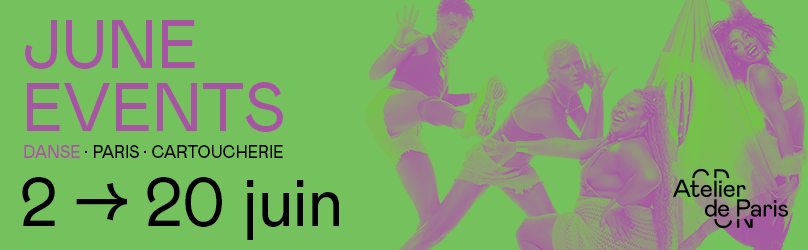Le jeu vidéo comme outil de médiation culturelle dans les musées
par Angélina Zarader27.02.2025

Loin d’être un simple divertissement, le jeu vidéo s’impose progressivement comme un outil de médiation culturelle puissant au sein des musées. En proposant une expérience immersive et interactive, il facilite l’accès aux collections, favorise l’engagement du public et renouvelle les modes de transmission du savoir.
Une immersion au service de la découverte des collections
Depuis la pandémie de Covid-19, de nombreux musées ont scanné en 3D et diffusé certains objets de leur collection sur des plateformes comme Sketchfab. En effet, pendant le confinement, les musées ont dû redoubler d’efforts pour maintenir le lien avec leur public. Le Louvre, par exemple, a attiré 10 millions de visiteurs virtuels en deux mois grâce à ses initiatives numériques. Cette transition forcée a permis de montrer à quel point ces outils pouvaient élargir l’audience des musées et attirer un public plus diversifié. La pandémie a donc marqué un tournant majeur dans l’adoption du numérique par les institutions culturelles, les poussant à innover pour continuer à exister dans un contexte de restrictions.
Les musées exploitent de plus en plus les capacités du jeu vidéo pour plonger les visiteurs dans des univers historiques, artistiques ou scientifiques. Les reconstructions virtuelles permettent d’explorer des lieux disparus, comme la Rome antique ou le Paris médiéval, en complétant les œuvres exposées.
Des institutions prestigieuses, comme le Musée du Louvre, ont développé des applications ludiques pour guider les visiteurs et enrichir leur compréhension des œuvres. De même, des jeux comme « Assassin’s Creed Discovery Tour » transforment les collections muséales en véritables terrains d’exploration historique puisque la série des Discovery Tours est composée de jeux spécifiques permettant aux visiteurs de parcourir la Grèce antique, l’Égypte ancienne et l’ère viking afin d’en apprendre davantage sur l’histoire et la vie quotidienne dans ces régions et à ces époques.
Avec Art Leap, le musée du Belvédère de Vienne franchit une nouvelle étape décisive dans l’apprentissage interactif de l’art en investissant l’univers numérique de Roblox. Le Belvédère est donc le 4ème musée international à être présent sur cette plateforme qui compte plus de 89 millions d’utilisateurs quotidiens. Ce jeu immersif permet aux joueurs d’explorer quatre chefs-d’œuvre emblématiques du musée, transformant la découverte artistique en une aventure ludique et captivante : les joueurs y apprennent des faits fascinants sur chaque œuvre d’art. En collaborant avec le studio Exclusible, le Belvédère mise sur une approche innovante pour toucher un public plus large, notamment les jeunes générations, en intégrant des éléments narratifs et interactifs à son expérience. Avec plus de 300 000 joueurs et un taux d’approbation de 97 %, sur la base d’environ 10 000 évaluations, Art Leap illustre la volonté croissante des institutions culturelles d’adopter les nouvelles technologies pour démocratiser l’accès à l’art et renouveler l’expérience muséale.
D’autres institutions, toutes aussi inspirantes, avaient déjà développé de tels systèmes : The Metropolitan Museum of Art avec Art Link, un jeu blockain pour connecter les oeuvres d’art, ou encore The British Museum, qui collabore avec The Sandbox pour vivre des expériences immersives et enfin le Musée des Tissus de Lyon, qui propose un espace virtuel autour de l’art de la soie.
Par ailleurs, le développement de solutions accessibles, comme celles proposées par des plateformes telles que PandaSuite, permet aux musées de toutes tailles d’adopter ces outils sans nécessiter de compétences techniques avancées. Cette démocratisation de la technologie favorise une adoption plus large et réduit les obstacles liés aux ressources limitées.
Un levier d’engagement pour les nouvelles générations
Le jeu vidéo constitue un formidable vecteur d’engagement, notamment pour les jeunes publics, en rendant la visite muséale plus dynamique et participative. Plutôt que de simples panneaux explicatifs, certains musées proposent des jeux de rôle ou des énigmes interactives intégrées aux expositions, transformant l’apprentissage en expérience ludique. Par exemple, Happy Unity propose des jeux de piste digital dans de nombreux musées : Musée du Louvre (Paris & Lens), Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Musée du Quai Branly, Opéra Garnier, Château de Versailles, Arts et Métiers, Musée Grévin, Musée Picasso, Musée des confluences, Palais des Beaux Arts de Lille, Palais des Beaux Arts de Lyon, Palais des Beaux Arts de Bordeaux, Musée royal d’Arts et d’Histoire de Bruxelles. Les équipes sont ainsi guidées à travers les œuvres, des défis et questions à résoudre sont proposés, permettant de visiter le musée de manière plus ludique et dynamique.
Victorian Reality illustre également cette démarche en permettant aux visiteurs d’explorer des artefacts du XIXe siècle à l’aide d’un casque Meta Quest 2, sans avoir besoin de manettes ou de contrôleurs. En manipulant virtuellement les objets, le visiteur peut découvrir leur fonction, leur mode de fabrication et leur contexte historique, favorisant ainsi une immersion sensorielle et intellectuelle.
Une nouvelle manière de raconter l’histoire
Au-delà de l’animation muséale, le jeu vidéo redéfinit la manière dont l’histoire et la culture sont racontées. Contrairement aux formats traditionnels, il permet au visiteur de devenir acteur de sa propre découverte.
Certains musées ont développé des jeux narratifs où les joueurs doivent résoudre des mystères historiques ou reconstituer des événements passés. Par exemple, le Musée de l’Homme à Paris a conçu une expérience interactive où le joueur incarne un archéologue à la recherche d’indices pour reconstituer le quotidien des civilisations anciennes.
Toutefois, l’intégration du numérique dans la médiation culturelle soulève aussi des défis. Certains professionnels craignent que l’utilisation excessive des écrans et des dispositifs numériques ne détourne l’attention des œuvres elles-mêmes. D’autres soulignent le risque d’inégalités d’accès, notamment pour les publics moins familiers avec ces technologies. De plus, la nécessité d’une mise à jour constante des supports numériques peut représenter une charge financière importante pour les musées, en particulier les plus petits.
Le jeu vidéo s’impose progressivement comme un outil essentiel de médiation culturelle dans les musées. Son potentiel immersif et interactif permet de renouveler l’expérience des visiteurs, de toucher un public plus large et de favoriser une approche plus vivante et engageante de l’art et de l’histoire. En intégrant les technologies ludiques à leurs dispositifs de transmission du savoir, les musées redéfinissent leur rôle et leur manière d’interagir avec le public.
L’expérience du Powerhouse Museum avec Victorian Reality démontre que même avec des moyens restreints, il est possible de développer des expériences immersives efficaces, accessibles et adaptées à une diversité de visiteurs. En exploitant les outils numériques de façon créative, les musées peuvent proposer des expériences interactives qui enrichissent la compréhension des collections et favorisent une immersion culturelle plus profonde.
Finalement, en adoptant une approche équilibrée et réfléchie, le numérique ne remplace pas l’expérience muséale traditionnelle, mais la complète et l’enrichit, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives passionnantes pour la médiation culturelle du futur.
Visuel : © Capture d’écran Art Leap
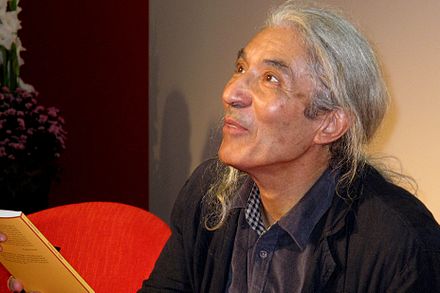
Boualem Sansal : une peine de 5 ans de prison ferme confirmée par la cour d’appel d’Alger
par Rose McCloud-Lieber01.07.2025

Robert Couturier au Donjon Vez, « La poésie des corps au corps » quand la sculpture investit les remparts
par Fiona Fondelot01.07.2025