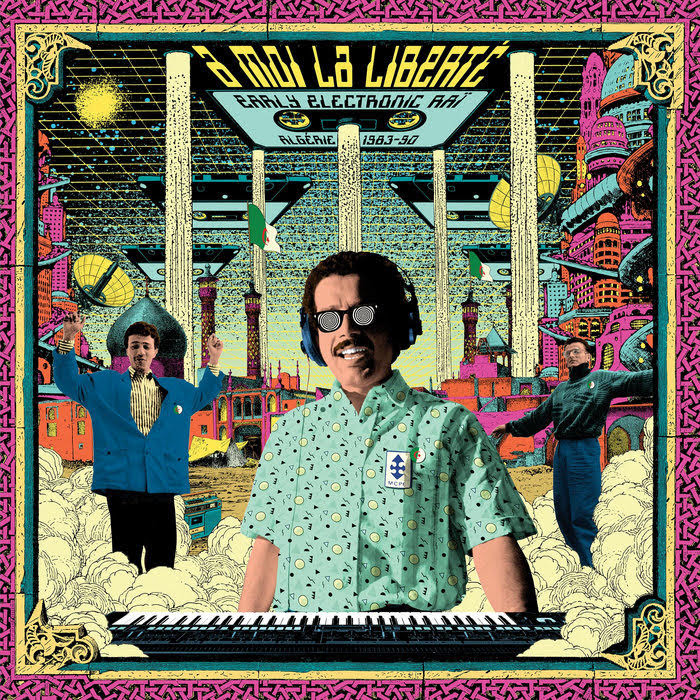Interview avec Latifa Laâbissi pour « Le même corps, jamais pareil »
par Marc Lawton24.11.2025

Le week-end des 14, 15 et 16 novembre, à Rennes au FRAC Bretagne dans le cadre du festival TNB, le public a pu apprécier la performance de Latifa Laâbissi à travers trois solos d’après Esther Ferrer. Nous avons déjà chroniqué ce moment dans nos colonnes. Pour en savoir plus, une rencontre avec l’artiste s’imposait.
Le même corps, jamais pareil. D’après Esther Ferrer: est-ce vous qui avez donné ce titre à votre proposition ?
Oui mais je crois avoir trouvé « Le même corps, jamais pareil » dans un article général sur la performance. Ce titre évoque la question du corps qui performe, mais un autre sujet me vient tout de suite à l’esprit car très présent dans mon travail, la question de la temporalité. Je parle du moment même de la performance mais aussi du temps long, celui qui fait qu’à mon âge, je continue à danser et à performer, tout comme le fait Esther Ferrer, qui a aujourd’hui 83 ans. Donc ce « jamais pareil » se rapporte à cet ensemble-là. Le fait que, sur le temps long, le corps s’altère.
Cela est flagrant dans la troisième performance, Las cosas (Les choses), dans laquelle il n’y a pas de personnage. Dans le travail d’Esther est donné à voir un régime d’actions qui ne comporte aucune translation vers l’interprétation, vers le personnage ou la figure. Mais la personne présente est altérée par le régime d’actions. C’est aussi le cas pour Intime et personnel, la deuxième performance avec un corps nu qui devient marqué par ses mesures. C’est le même corps, mais pas pareil. Donc ce titre, pour quelqu’un qui ne connaît pas le travail, est polysémique et en même temps, s’accroche à sa matérialité.
Était-ce la première fois qu’Esther Ferrer transmettait ces solos ?
En fait, elle ne me les a pas transmis. Esther est une figure majeure de la performance. Je connaissais moins son travail plastique, découvert il y a une quinzaine d’années, mais je connais ses performances depuis plus longtemps, depuis au moins 20 ans. Pour Intime et personnel, je crois que c’était au MAC-VAL (musée d’art contemporain à Vitry s/Seine, ndlr), elle en donnait déjà une version avec du monde, c’est-à-dire qu’elle était présente, mais avec d’autres personnes qui se mesuraient les unes les autres, avec des reports des mesures sur le mur, là où chacun.e avait dessiné le contour de son propre corps. Il existe plein de versions, avec de nombreuses variantes.
À un moment qui a compté pour moi, j’ai eu envie de faire ce travail de reprise, car je trouve ces performances d’une actualité forte et puissante. Du côté des régimes de l’art, on serait plutôt du côté du minimalisme. Ma formation de base, c’est Cunningham, mais mon travail est très figuré et expressif. J’ai fait des reprises d’Yvonne Rainer, donc n’ai pas de point de vue dogmatique sur ce qu’est un corps. Le travail autour de l’esthétique minimaliste m’a toujours intéressée. Je ne crains pas les écarts même s’ils sont très radicaux.
Dans le complément des Inrockuptibles sur le festival TNB 2025, l’article de Jérôme Provençal dit que ces performances sont à l’opposé de votre travail habituel. Vous êtes d’accord ?
Non, je dirais plutôt que c’est une activation différente du corps. Dans mon travail, je tords les figures et elles ne sont jamais alignées. Je fais en sorte qu’elles ne tombent pas dans des pièges de sens, d’où une polysémie. Là, je ne pouvais pas me substituer à ce que dirait Esther Ferrer elle-même de son travail. En reprenant ses performances, on est un peu « à l’os » : les actions valent pour ce qu’elles sont et la surface de projection est vraiment l’imaginaire du public. Chacun peut faire le chemin qu’il/elle veut, et il n’y a aucune dramaturgie, aucun mouvement qui emmènerait le solo vers un climax et qui redescendrait après, pas d’interprétation théâtralisée non plus. Je dirais plutôt que ce sont des surfaces, un « blanc » théorique. C’est vraiment l’imaginaire du public qui va être au travail. Faire l’expérience de l’acte et se raconter quelque chose avec ça.
Je ne vois pas cela comme un opposé. Cela le serait si je n’en faisais pas l’expérience et que j’étais spectatrice de cette autre façon de travailler par rapport à cette généalogie d’artistes. Mais j’ai déjà incorporé d’autres travaux, d’autres œuvres dans ma démarche. Je ne suis pas à distance, c’est juste une autre façon de performer.

C’est un peu ce que vous aviez fait quand vous aviez repris en 2009 la Danse de la sorcière de Mary Wigman dans L’écran somnambule ?
Oui mais la Sorcière était dans mon registre d’expressivité propre, dans lequel est présente la grimace. Je pense plutôt à Yvonne Rainer quand, au sein du Quatuor Knust, on avait repris d’elle CPAD (Continuous Project Altered Daily 1970, remontage en 1996) ou au SACRE de Dominique Brun (2013). C’est un tout autre travail, où la performativité s’effectue à un autre endroit.
Peut-on parler de reenactment ?
Oui mais j’emploie moins ce terme, car il renvoie à des reconstructions par tableaux vivants, à des reconstitutions historiques. Mais je sais que le régime de l’art se l’est réapproprié avec des termes comme replaying, redoing. Nous les danseurs sommes tous accompagnés par des généalogies d’artistes et de penseurs, certains venant de la société civile, qui nous influencent. Je sens que j’ai envie d’aller un peu plus loin. Regarder Esther Ferrer et son travail fort m’a vraiment marquée et a influencé mon travail en creux. J’ai eu envie d’instaurer un dialogue par le travail.
J’ai retraversé des catalogues, des interviews d’Esther. Tout en répétant ma création prévue pour 2026, j’ai eu envie d’avoir avec elle cette conversation. Dans cette période assez chargée, cela m’a fait un bien immense de me plonger dans cette implication forte dans le monde de l’art, dans ce silence. Même si son travail est politique, ce n’est jamais manifeste. Elle n’a jamais clamé quelque chose, elle laisse vraiment l’agissement du travail avoir lieu. Mais à un moment, il s’est agi de la rencontrer pour lui demander si elle était d’accord. Pour ce dialogue ait vraiment lieu, il fallait que j’aille jusqu’au bout, jusqu’à la présentation publique. Je l’ai rencontrée à Paris par l’intermédiaire d’une commissaire d’exposition, Béatrice Josse.
Esther Ferrer a été très étonnée, car si elle faisait des reprises, c’était toujours avec elle présente. Je lui ai assuré avoir fait beaucoup de performances, avec des rendez-vous avec des personnes comptant pour moi. Je l’ai laissée aller voir des vidéos de mon travail, qu’elle ne connaissait pas, et lui ai parlé de mes recherches autour de Mary Wigman, de Valeska Gert, d’Yvonne Rainer, de Tatsumi Hijikata… Je lui ai parlé du corpus de mon travail et de mon désir de traverser ses trois performances.
Elle pensait que j’allais intégrer ces pièces dans un de mes spectacles ! Même si je ne fais pas tout comme elle, je souhaitais reprendre ces solos. Ils comportent des protocoles, mais laissent une place importante à la façon dont on les refait. Elle n’avait jamais performé ces solos à la suite et cela m’intéressait de les mettre en dialogue les uns avec les autres. Elle est venue à une répétition de Las cosas à Paris, à la Ménagerie de Verre. Le FRAC Bretagne dispose d’une importante documentation sur elle, mais les solos n’étaient illustrés que par deux ou trois photos. Donc il était important de converser avec elle. Je l’ai notamment interrogée sur Las cosas, car il en existe plusieurs versions, plusieurs occurrences : avec ou sans nudité, avec une ou plusieurs tables… et j’avais besoin de comprendre ces paramètres avant de choisir les miens. Ce fut vraiment intéressant.
Elle n’a jamais été prescriptrice, ce serait à l’opposé de son travail. Le geste de la performance est extrêmement vivant, ce n’est jamais deux fois la même chose. Même si le protocole agit comme une sorte de guide, ce qui va se passer à l’instant t est plus important que tout.
Peut-on évoquer les objets qui sortent des deux grands cabas dans Las cosas ?
Les objets proviennent de chez elle et n’ont pas été achetés dans un magasin. Certains, qui figurent dans sa performance, se trouvaient aussi chez moi comme un marteau, un mètre ou un niveau. Tous les autres sont à moi et n’ont rien à voir avec ses choix à elle. Mais certains sont récurrents dans ses performances comme le chou. Je tiens à ce chou, car là où je vis a été créé un potager partagé et nous sommes dans la bonne saison, d’où la présence d’un chou dans ce solo.
Dans l’article des Inrocks, vous soulignez un point commun entre Esther Ferrer et vous : l’humour. Votre performance est très matter of fact, minimaliste…
Oui, elle prône l’humour et la puissance de l’absurde. Dans une de ses interviews, elle affirme : « Je vois le monde et je n’y comprends rien. »
C’est un peu comme dans le cinéma burlesque l’opposition entre Charlie Chaplin et Buster Keaton. Elle serait du côté de Keaton ?
Absolument. Chez Keaton, on voit la répercussion, parfois démesurée, d’un geste ou comment un geste contient la puissance de l’absurde. Mais ici, ce geste n’est pas du tout construit.
Comment voyez-vous l’actualité de ces solos ?
Dans Intime et personnel sont questionnées les normes du corps, avec l’idée fréquente qu’il faut arrêter son vieillissement et prendre des décisions chirurgicales pour le changer, pour l’« arrêter ». Ce que j’ai trouvé très beau dans le travail d’Esther est la question du temps. Je me souviens, au moment de la création de Self Portrait Camouflage (2006), avoir pensé que j’aimerais pouvoir danser ce solo à 80 ans. Ce n’est pas une défiance face à la physicalité, je n’ai pas peur de vieillir, au contraire. Un travail qui s’altère par le temps long m’intéresse énormément.
Un peu comme Kazuo Ohno dansant à un âge avancé son solo La Argentina ?
Exactement. Esther Ferrer est d’une vitalité hallucinante à plus de 80 ans et ce fut vivifiant de la rencontrer. Le corps d’un danseur – et en l’occurrence d’une danseuse – est tourné vers la norme. À l’époque de Self Portrait, je n’étais pas bien comprise par mes congénères. La musculature, les tissus du corps évoluent et se montrer nue ne va pas de soi. Une spectatrice d’Intime et personnel, passant devant Esther Ferrer nue, s’exclama : « Quelle honte de se montrer nue à cet âge-là ! ». Mais le sujet n’est pas là : ni Esther Ferrer ni moi ne disons : « Regardez mon corps à tel âge, puis à tel autre ». Nous travaillons dans le temps long.
Vous sentez-vous féministe dans votre démarche ?
Politiquement, je suis féministe, mais tout en étant là, je n’en fais pas un sujet. Pareil pour Ferrer : c’est tellement incorporé et en action dans ses gestes qu’il n’est pas nécessaire d’en faire un thème.
Il y a quelques années, le Musée de la danse/CCN de Rennes avait présenté Ruth Childs performant des pièces de sa célèbre tante Lucinda Childs, notamment Carnation, un solo utilisant des ustensiles de cuisine (panier à salade, éponges…). Vous sentez-vous proche de cette génération postmoderne américaine des années 1970 ?
Oui, c’est assez proche, j’avais assisté à cette performance. Beaucoup d’artistes aujourd’hui ne font pas référence à cette période fertile pour l’art, mais en font un régime d’actions, comme le fait Esther Ferrer. Je n’oppose pas cet ancrage minimaliste et mon travail plus figuré. Dans mon parcours, dans les années 1987-90, quand je dansais chez Gallotta et travaillais avec Cunningham, j’étais en même temps intéressée par des personnalités comme Mary Wigman. Je me souviens qu’à ce moment-là, il fallait choisir son camp. Cela a heureusement beaucoup changé depuis. J’allais suivre des stages avec Ariane Mnouchkine – comme celui de quatre semaines autour du masque balinais – parce que le travail des masques m’intéressait énormément, mais je ne le disais pas aux chorégraphes avec qui je travaillais. On parlait de neutralité tout à l’heure et j’adoptais ce « corps neutre », par exemple chez Cunningham.
Cela a changé dans les années 1995-2000 et aujourd’hui dans les écoles, cette opposition n’est plus de mise. Je pense à Fabian Barba, danseur équatorien passé par l’école PARTS (Bruxelles), qui a repris en 2010 neuf solos de Wigman dans un récital intitulé A Mary Wigman Dance Evening. Il signalait que ce type de danse n’était pas dans les canons de l’époque, notamment à PARTS.
Quand ces solos seront à nouveau donnés à la Ménagerie de Verre, seront-ils performés dans des espaces différents comme au FRAC ?
Oui, dans la mesure du possible. Je pense qu’il est important d’emmener le public dans ce type de déplacements. Au FRAC Bretagne, le directeur Étienne Bernard a tenu à ce que ces solos d’Esther Ferrer, avec ma réécriture, soient montrés dans trois salles différentes de l’exposition « Invisibles », trouvant pertinent la rencontre entre les œuvres exposées et ma performance, dont beaucoup de sources se trouvent dans le fonds du FRAC. Je figure donc parmi les artistes de cette exposition.
Êtes-vous contente de ces trois premières dates ?
Oui, très contente. Cela a du sens et les quelques échanges que j’ai eus avec le public ont été positifs. Pour les reprises, il faudra que je fasse le point avec Esther Ferrer, car elle les danse encore et je ne souhaite pas la gêner.
Ces solos ont-ils une résonnance sur la pièce que vous préparez pour l‘automne 2026 ?
Oui, on métabolise, forcément. Ce sera un duo avec le musicien Walid Ben Selim qui s’appellera Flaming Creatures.
Un dernier mot ?
Oui, signaler aussi que ces « reprises » se font sur mon corps à moi avec son histoire et son identité nord-africaine. Donc plein de paramètres s’infiltrent à l’intérieur.
Visuel principal : © Richard Louvet
Interview réalisée par téléphone le 18 novembre 2025.

Catherine Pégard devient ministre de la Culture
par Amélie Blaustein-Niddam26.02.2026
→ Lire l’article

Willie Colón, figure emblématique de la Salsa, est décédé ce samedi 21 février 2026
par Agnès Lemoine26.02.2026
→ Lire l’article