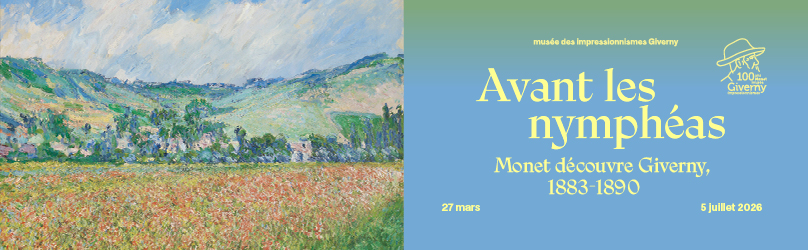Il était une fois Sammy Davis Jr., noir, juif et borgne, une mémoire vivante d’une légende
par Melodie Braka27.01.2026

À l’heure que nous traversons, ce titre n’a rien d’anodin. Il était une fois Sammy Davis Jr. Noir, juif et borgne claque comme une déclaration. Il expose frontalement ce que l’histoire américaine a longtemps tenté de lisser, voire d’effacer, et pose d’emblée une intention forte. C’est ce qui m’a menée, lundi soir, au Café de la Danse.
Sammy Davis Jr. (1925,1990) fut l’un des plus grands entertainers américains du XXe siècle : crooner noir à la voix immédiatement identifiable, danseur virtuose, acteur et membre du Rat Pack aux côtés de Frank Sinatra et Dean Martin, artiste multitalent engagé contre la ségrégation, dont la carrière s’est construite à la fois dans la lumière du show business et contre les violences raciales de son époque.
Un plateau déjà habité
En entrant dans la salle, le plateau est déjà offert au regard. L’affiche du spectacle est visible, le décor installé. Une chaise face à un miroir de loge, un tapis qui délimite un espace plus intime, une batterie placée à vue. Sans rideau et sans effet d’attente, le spectateur est directement plongé dans une atmosphère, un univers.
Car le spectacle raconte l’histoire d’un homme. Mais pas seulement. Sammy Davis Jr., figure tutélaire du divertissement américain, est ici abordé par le prisme de son parcours intime, cabossé, balafré, traversé de fractures identitaires. On connaît l’icône, le chanteur, le danseur, l’acteur. On connaît moins l’homme aux prises avec le racisme systémique, l’antisémitisme, la solitude, la nécessité permanente de prouver sa légitimité. C’est cette trajectoire là que le texte explore, dans une structure classique, ponctuée de dates clés, presque comme des balises biographiques. Une chronologie qui, loin d’enfermer le récit, lui permet au contraire de dialoguer frontalement avec notre présent.
Incarner Sammy Davis Jr.
Le choix de Larry Benzaken pour incarner Sammy Davis Jr. est, de ce point de vue, particulièrement juste. Il fallait une personnalité capable de tenir un seul en scène d’1h15, d’embrasser à la fois le charisme, la vulnérabilité, la colère rentrée et l’ironie salvatrice. Benzaken ne cherche jamais l’imitation. Il compose une présence. Une gouaille. Un corps en mouvement, parfois dansé, parfois slamé, toujours engagé. Sa performance rend Sammy Davis Jr. profondément attachant, sans jamais le figer dans une figure héroïque ou victimaire.
Le texte, exigeant par nature, épouse un rythme très marqué, presque mélodique. Ce choix crée une continuité, une forme de lancinance assumée, qui peut parfois solliciter l’attention du spectateur sur la durée. Mais cette partition verbale trouve progressivement ses ruptures, ses respirations, notamment lorsque la musique vient reprendre la main.

Musique et cassure de rythme
Un moment marque une véritable cassure. Jusqu’alors multi instrumentiste discret, Robin Lebon laisse soudain sa place derrière la batterie à Larry Benzaken. La surprise est immédiate. Voir l’interprète quitter le récit pour s’installer derrière l’instrument crée un déplacement inattendu, à la fois visuel et dramaturgique. Les effets stroboscopiques accompagnent cette séquence sans l’alourdir, et cette parenthèse rythmique fonctionne comme une relance bienvenue.
La musique composée par Franck Lebon joue ici un rôle central. Elle ne se contente pas d’accompagner le texte : elle en est le moteur. Interprétée par Robin Lebon, passant du piano à la batterie avec beaucoup de maîtrise, elle apporte une modernité évidente au spectacle sans jamais trahir l’époque qu’il convoque.
Images fortes, mémoire vive
La mise en scène de Hugues Duquesne trouve précisément sa force dans cet équilibre. Les jeux de lumière, de néons, de stroboscope, loin de l’effet gratuit, créent un pont entre mémoire et contemporanéité. Le spectacle refuse le musée. Il préfère la friction.
Certaines images s’imposent durablement. Celle de Larry Benzaken assis face à un miroir, dans une posture presque intime, tandis que résonne le discours de Martin Luther King, porté par un arrangement musical d’une grande élégance. Celle, saisissante, où il enfile les téfilines, coiffe une kippa, et entonne une prière en hébreu a cappella. Sans pathos. Sans explication superflue. Juste un corps, une voix, une identité assumée dans toute sa complexité.
Ces moments là marquent. Ils s’impriment. On sort du spectacle avec des images qui persistent, qui interpellent, qui résonnent avec l’actualité sans jamais la convoquer explicitement. Il était une fois Sammy Davis Jr. ne cherche pas à faire la leçon. Il raconte. Il expose. Il laisse le spectateur face à ce que l’histoire américaine a produit de plus violent, mais aussi de plus lumineux : la capacité de renaître sans jamais se renier.

Un crescendo maîtrisé
La montée en intensité est progressive. Le spectacle prend son temps, installe son langage, avant de s’achever sur un crescendo maîtrisé, puissant, presque libératoire. On en sort remué, stimulé, avec le sentiment d’avoir assisté à une proposition sincère, engagée, portée par des artistes qui prennent le risque de la complexité.
Joué encore les 17 et 18 février, Il était une fois Sammy Davis Jr. mérite d’être vu, soutenu, accompagné. Parce qu’il parle d’hier avec les mots d’aujourd’hui. Parce qu’il rappelle que certaines histoires, lorsqu’elles sont racontées avec justesse, n’appartiennent jamais vraiment au passé.
Sammy Davis Jr. en quelques dates clés
1925 : naissance à Harlem, New York.
1953 : accident de voiture, perte de l’œil gauche et conversion au judaïsme.
Années 1950 : percée comme chanteur et entertainer.
Années 1960 : membre emblématique du Rat Pack avec Frank Sinatra et Dean Martin.
1965 : premières apparitions notables dans plusieurs séries américaines à la télévision, ouvrant la voie à son propre show The Sammy Davis Jr. Show.
1972 : sa chanson The Candy Man atteint la première place du Billboard Hot 100, son plus grand succès commercial.
1990 : décès à Beverly Hills à l’âge de 64 ans.
Visuels © Camilles Deslandes

Le retour controversé de la Russie à la Biennale de Venise
par Kenza Boumahdi13.03.2026
→ Lire l’article

« On a 80, 90 ans, mais en fait on vit » : cabaret et haute couture dans une maison de retraite parisienne
par Melodie Braka13.03.2026
→ Lire l’article