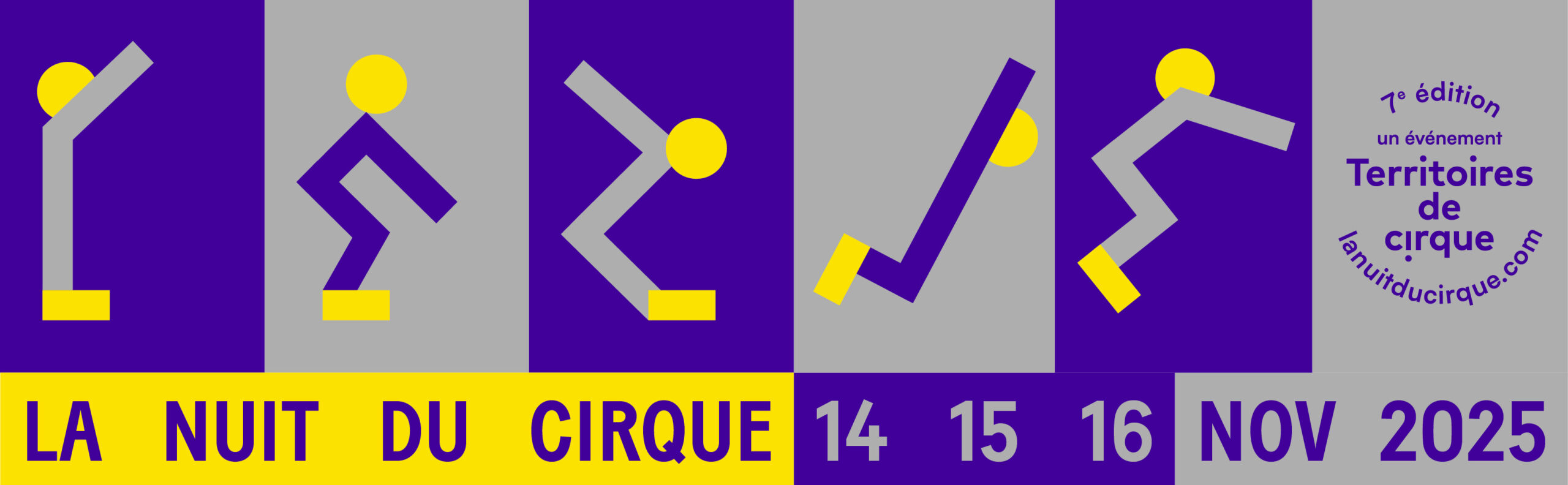Hind Meddeb : « Le Festival du film franco-arabe, c’est moi, c’est nous, enfants d’exilés ! »
par Yaël Hirsch07.11.2025

Cinéaste du réel et témoin des révolutions arabes, Hind Meddeb a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie. De cette circulation entre cultures et langues est née une œuvre singulière, traversée par la musique, la jeunesse et la liberté. Marraine de la 14ᵉ édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, elle y présente ses films documentaires, Tunisia Clash, Electro Chaabi et Soudan, souviens-toi. Elle nous parle de ce festival qu’elle connaît depuis longtemps et qui lui ressemble…
Vous êtes la marraine de la 14e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, dont Costa-Gavras est le parrain d’honneur. Que ressentez-vous, en tant que réalisatrice, d’être au côté de ce grand réalisateur ?
Je me dis qu’on est alignés ! Costa-Gavras a été forcé à l’exil, il est venu étudier en France comme mon père, qui avait quitté sa Tunisie natale pour Paris en 1967. J’ai grandi avec ses films. Adolescente, j’ai vu Z, qui dissèque les mécanismes d’une dictature fasciste à travers l’itinéraire d’un opposant qui paiera de sa vie son engagement.
Je pense que c’est en voyant des films comme celui-là que j’ai eu envie de faire du cinéma. Mes films sont aussi des récits de révolution et de résistance à l’oppression. Donc je vois dans son parcours et son cinéma bien des choses qui résonnent avec l’histoire de ma propre famille et avec mon désir de faire entendre la voix de ceux qui se soulèvent contre l’injustice.
Vous suivez le festival depuis ses débuts. Qu’est-ce qui fait qu’il « tend un miroir » aux « enfants entre deux continents » parmi lesquels vous vous reconnaissez ?
La réponse est dans le titre : festival du film franco-arabe, c’est moi, c’est nous, enfants d’exilés ! Je suis née en France, de culture française, je parle arabe, mes racines sont au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et j’arrive à faire marcher tout ça ensemble.
Mes films, je les ai tournés à Paris, Casablanca, Tunis, Le Caire, Khartoum… J’essaye de faire le lien entre les deux rives. Tout comme les autres films programmés depuis des années par le festival.
Dernier en date que j’ai adoré : Bye bye Tiberias de Lina Soualem, où elle revient sur sa double, voire triple, généalogie – française, algérienne, palestinienne. Un film comme celui-là nous raconte la Palestine autrement, du côté de l’intime, en montrant comment l’occupation israélienne a abîmé la vie de toute une famille.
On a besoin de ces regards de l’intérieur qui disent les conditions de l’exil, les sensibilités, l’amour aussi. Ce sont des approches personnelles qui racontent la grande histoire à travers la singularité de nos itinéraires. Et c’est là que le spectateur peut s’identifier, rêver avec nous. Au lieu de le mettre à distance, on l’invite chez nous.
Trois de vos films vont être projetés en votre présence. Qu’est-ce que cela représente pour vous de montrer vos films dans ce festival ?
C’est la joie ! Et surtout je réalise que je tisse depuis des années le même fil. Montrés ensemble, ces films prennent sens. On traverse dix ans de révolution et de lutte pour la liberté en Afrique : les rappeurs qui défendent la liberté d’expression dans la Tunisie post-révolutionnaire avec Tunisia Clash, la jeunesse des bidonvilles du Caire qui dénonce les travers de la dictature et défie les puissants avec une musique contestataire, l’Electro Chaabi, et enfin la poésie comme mémoire de la révolution là où une armée génocidaire sème la mort dans Soudan, souviens-toi.
Trois films qui mettent en lumière une jeunesse africaine éprise de liberté. C’est un autre regard sur l’Afrique et le monde arabe, loin des représentations habituelles, que je partage ainsi avec vous.
Dans vos films, la musique tient toujours une place importante…
La révolution, c’est l’articulation entre rêve, solidarité, fête et courage. Et c’est la musique qui réunit les gens, tisse les liens et écrit l’histoire en train de se faire. Les chansons sont le récit populaire de la révolution.
Raconter ces soulèvements par le prisme de la musique nous rappelle qu’ils se sont faits dans la joie que procure la fête et le partage.
Et ici j’aimerais rappeler que la tentation fasciste implique de sombrer dans la haine de l’autre, le repli sur soi et la violence. Je me demande toujours : qu’est-ce qui conduit parfois des millions de gens à se laisser séduire par la propagande fasciste alors que c’est une voie sinistre, triste, ennuyeuse et douloureuse ?
C’est une vraie question. Et justement, dans mes films, on voit la joie et la beauté de ceux qui se soulèvent contre l’injustice et les semeurs de mort.
Cette année, le cinéma tunisien est à l’honneur du FFFA. Quels films avez-vous hâte de découvrir au Trianon ?
D’abord je vais aller voir Promis le ciel ! d’Erige Sehiri (lire notre article), parce que j’avais adoré son précédent film Sous les figues et qu’elle aborde un sujet qui m’est cher : celui du racisme envers les Subsahariens en Tunisie, thème que j’aborde moi-même dans mon film Paris Stalingrad, qui raconte l’itinéraire d’un jeune poète soudanais arrivé à Paris.
J’apprécie particulièrement la délicatesse d’Erige Sehiri : c’est une réalisatrice à part, qui regarde le monde avec attention, et c’est devenu assez rare pour le souligner. Elle apporte de la douceur là où règne l’hostilité.
J’invite aussi le public à aller voir La voix de Hind Rajab, que je viens de découvrir au cinéma à Tunis. Ce film nous fait revivre le calvaire d’une enfant palestinienne assassinée par l’armée israélienne. La puissance de ce film vient du fait qu’il ressuscite la petite Hind : elle est là avec nous, c’est comme si nous faisions connaissance avec elle. Et pourtant, on ne la voit pas, on n’entend que sa voix – la vraie.
Le film est à la frontière du documentaire et de la fiction. C’est un tournant dans l’histoire, car pour la première fois, un récit palestinien est porté par un film de facture hollywoodienne. Ce que je veux dire, c’est qu’il nous tient en haleine comme un polar. Et de ce fait, c’est un film commercial qui pourra toucher un public mondial – et je m’en réjouis.

Mathieu Potte-Bonneville nous parle de « l’Inventaire Deleuze » au Centre Pompidou
par Yaël Hirsch07.11.2025

La Discult, 32 : Kate Stables & The Songs of Joni Mitchell
par Yves Braka07.11.2025