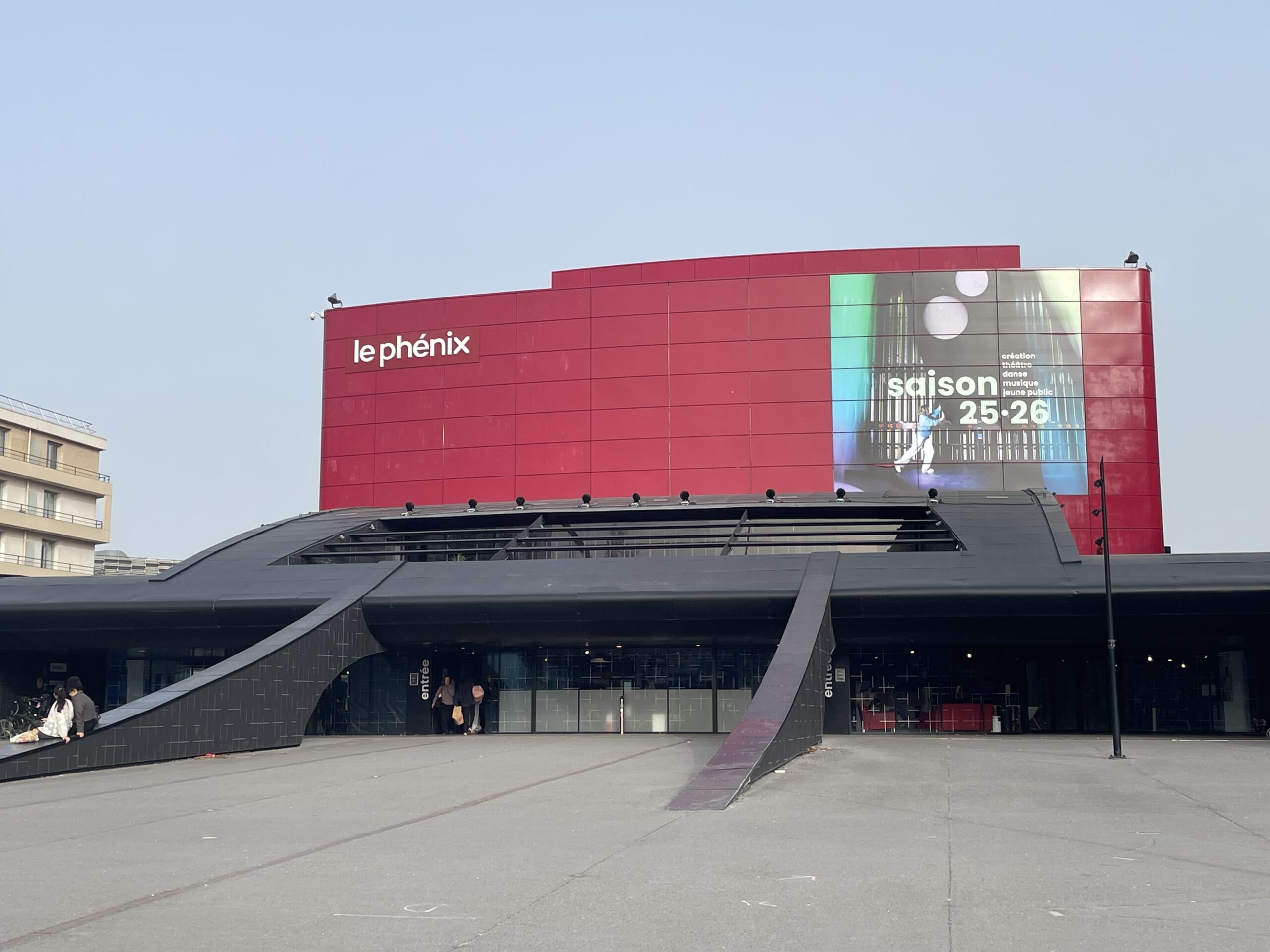En effet, si on regarde à la tête des grandes institutions françaises, privées ou publiques, on retrouve le plus souvent des hommes (majoritairement) et des femmes dont l’âge approche ou a dépassé la retraite : on a beaucoup glosé sur Catherine Pégard, 69 ans, à la tête du Château de Versailles, ou encore sur Jack Lang, qui à 84 ans, essaye toujours d’occuper le plus d’espace médiatique possible.
Mais il faut également compter sur Didier Fusilier (65 ans) à la tête de la RMN-Grand Palais, Chris Dercon (66 ans) fraîchement arrivé à la Fondation Cartier, Béatrice Salmon (64 ans), directrice du CNAP, Louis Langré (63 ans) la tête de l’Opéra Comique, Jean-Jacques Aillagon (78 ans tout de même) toujours présent à la Collection Pinault, sans parler de l’indéboulonnable Suzanne Pagé (83 ans !) à la tête de la Fondation Vuitton.
Il est rare de trouver des présidents ou directeurs de grandes institutions qui ont moins de 60 ans – heureusement que Laurent Le Bon (Centre Pompidou, 55 ans), Sybille Weil (Radio France, 47 ans) et Alexander Neef (Opéra National de Paris, 50 ans) sont là pour un peu faire rajeunir la moyenne des présidents de grandes institutions culturelles.
Malgré la volonté affichée par les Ministres de la Culture successifs et par Emmanuel Macron lui-même de rajeunir et bouleverser les habitudes d’un secteur vieillissant, des programmes comme La Relève apparaissent comme des pansements sur une jambe de bois et les nombreux sont ceux qui restent frustrés de voir le sommet de la pyramide obstrué par une génération de boomers et post-boomers qui ne veulent en aucun cas partager le pouvoir.
En bas de la pyramide des âges, les jeunes sont en revanche moins intéressés par le secteur qu’il y a quelques décennies et les postes vacants dans les institutions, lieux et compagnies sont nombreux, faute de candidats. Cela s’explique par plusieurs éléments.
Tout d’abord, depuis un peu moins de 10 ans, nous sommes arrivés à la fin du mythe sur les métiers passion où l’on « ne compte pas ces heures ».
La jeune génération aspire légitimement à ne plus être dans le sacrifice permanent et souhaite obtenir un équilibre de vie relativement acceptable. Cette manière de travailler, qui fut la norme pendant des décennies n’est plus acceptée alors qu’en même temps, à la suite de 20 ans de décorrélation entre l’évolution d’un côté des salaires et de l’autre, des loyers et revenus du patrimoine, la question de la rémunération devient cruciale dans un secteur qui fut longtemps habitué à payer chichement ses salariés non énarques.
Pour les nouveaux entrants du secteur, il existe par ailleurs de nouvelles voies professionnelles qui ont émergé et qui promettent des carrières plus riches dans tous les sens du terme, mais aussi plus internationales : le divertissement se porte bien et de nouvelles start-ups permettent de repenser le rapport à celui-ci, que ce soit dans sa production ou sa diffusion.
Cette nouvelle donne détourne les jeunes des métiers plus institutionnels, qui sont par ailleurs de plus en plus en recherche de financements – mécénat, locations d’espace, co-branding… ce qui détourne le travail de son aspect créatif, de loin le plus exaltant.
Cette recherche de financement s’inscrit dans une évolution globale des conditions de travail qui – problème que l’on retrouve dans l’ensemble des secteurs professionnels – s’endurcissent. Cependant, le secteur culturel, de part son objet d’abord, son amplitude horaire et sa non-prise en compte des éléments matériels du travail ensuite, est particulièrement sujet aux déraillements divers.
Dans les années 1980 et 1990, le secteur est en pleine effervescence. De nouveaux lieux, de nouvelles institutions, de nouvelles compagnies furent créés et les enjeux d’organisation ou de bien-être au travail n’étaient (absolument) pas prioritaires. Les organisations et institutions existantes, quant à elles, ont grossi et développé de nouvelles expertises, mais sans se repenser dans leur globalité, créant des baronnies internes.
Or aujourd’hui, alors que les candidatures sont moins nombreuses, ces organisations et institutions ne parviennent pas à se transformer. Pour le dire autrement, on a connu durant les décennies 1980 et 1990 une nouvelle génération de directeurs et de directrices qui, plein d’énergie et de vision, ont tout construit en partant de rien. Contrairement à aujourd’hui, il y avait de l’argent et ils et elles avaient le temps et la place pour construire leur projet et leur vision. De là ont émergé une grande créativité, mais aussi des egos et la mise en avant de personnes qui mêlaient intimement leur fonction et leur identité.
Des décennies plus tard, on constate que la nécessaire professionnalisation du secteur ne s’est pas faite partout et que les egos restent très présents. Une des raisons en est le très faible turn-over du secteur : entre fonctionnariat et marché du travail resserré, le secteur ne pousse pas à la prise de risques.
De ce faible turn-over découle la perpétuation d’habitudes et méthodes de travail où la jeune génération ne trouve pas son compte ; et aussi des organisations qui à force d’immobilisme et de compétition entre pairs deviennent toxiques.
La face visible de cet iceberg a été mise en avant dans la presse : c’est par exemple la révocation pour cause « d’atmosphère anxiogène mettant en danger les agents » d’Anne Baldassari au Musée Picasso en 2014, le départ forcé de Sandrine Treiner en 2023 de France Culture, ce sont les grèves des salariés du 104 en 2022 pour lutter contre le surrégime ou encore ceux de la Tour Eiffel en ce moment pour protester contre un modèle économique défaillant avec une augmentation de la redevance due à la Ville de Paris de 300%.
La face invisible est encore moins reluisante, entre salariés mécontents qui cherchent désespérément un nouveau port d’attache, organisations mal pensées, souffrance généralisée au travail et rumeurs qui circulent à demi-mots sur tel lieu, telle fondation ou telle compagnie – en attendant peut-être qu’un jour, le scandale éclate.
En 2024, rares sont les institutions, entreprises, lieux ou compagnies qui font encore rêver vues de l’intérieur et de l’extérieur.
Alors, comment mener carrière dans ces conditions, dans un pays où les plus hautes nominations se font selon le bon vouloir du Président de la République? Comment avoir de la visibilité sur son évolution, son développement et vivre de manière saine ses ambitions? Ni le secteur public, ni le secteur privé ne semblent aujourd’hui en mesure de répondre à cette question et Rima Abdul Malak, ancienne Ministre de la Culture remerciée brutalement en janvier 2024, est elle-même à la recherche d’un endroit où atterrir.
Olympe du Fil