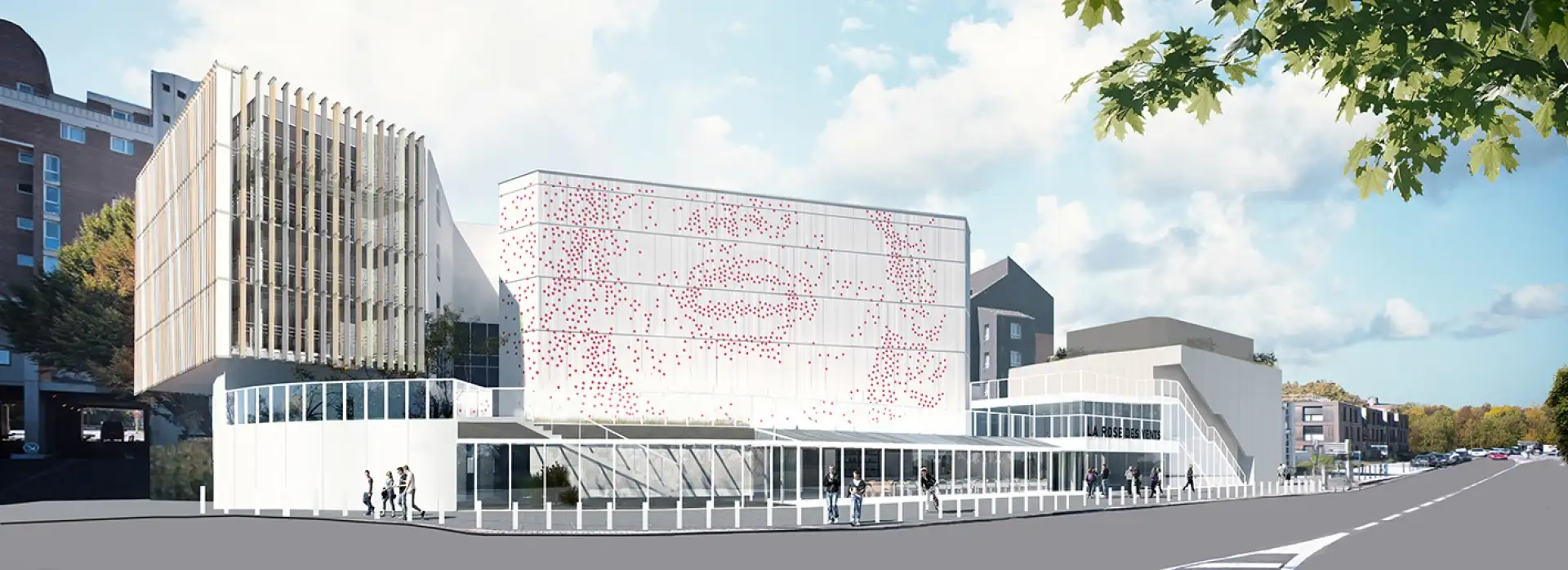Dorothée Gilbert : « C’est une saison cadeau pour moi »
par La redaction14.10.2025

La reprise de Giselle au Palais Garnier présent la richesse artistique de toutes les générations : pour certains, il s’agit d’un début ; pour d’autres, d’un adieu au rôle.
C’est le cas de Dorothée Gilbert, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, qui a illuminé ses scènes pendant près de vingt ans avec une jubilation intacte. Elle entame aujourd’hui sa saison d’adieu. Une rencontre, juste avant les derniers levers de rideau.
Par Maria Sidelnikova
Dans quel état d’esprit commencez-vous cette saison ?
C’est un peu une saison bonus, une année « cadeau », parce que j’ai eu 42 ans le 25 septembre. J’aimerais profiter au maximum de chaque spectacle, prendre conscience de la chance que j’ai de pouvoir danser encore un an sur cette scène avec des partenaires que j’aime, dans de beaux ballets. La programmation s’y prête aussi. Il y a des ballets exigeants, bien sûr, mais moins que la saison précédente, où il y avait Sylvia, Paquita… Cette saison est un peu plus « faite pour les vieilles », donc je suis très heureuse de pouvoir rester et de profiter.
Vous ferez donc vos adieux à 43 ans ? C’est plutôt exceptionnel.
Je pars le 15 octobre 2026, en Manon. J’aurai alors 43 ans, ce qui est un peu exceptionnel, c’est vrai. Mais administrativement, je serai mise à la retraite à la fin de la saison et je reviendrai en tant qu’artiste invitée.
Pourquoi Manon ? Avec Hugo Marchand ?
C’est le ballet que j’aime le plus danser et évidemment, avec Hugo. On s’est rencontrés en Manon, il y a 11 ans, et on se quitte avec ce même ballet. Donc ça a du sens : la boucle est bouclée, c’est beau.
Et vous commencez par Giselle.
J’ai énormément dansé Giselle à l’étranger, comme à Paris. La dernière fois, je me suis blessée au mollet. Donc je suis heureuse de la reprendre : je la connais tellement bien que j’ai envie de m’y lancer à fond, mais je dois rester prudente et raisonnable.
Ce le ballet qui a dépassé les 300 représentations à l’Opéra de Paris. Vous-même, vous le dansez depuis 20 ans. Qu’est-ce qu’on peut encore en dire de nouveau ?
On ne peut rien en dire de nouveau, on peut juste être plus soi. Avec le temps, on épure beaucoup dans l’interprétation. Plus on vieillit plus on est pur. J’ai toujours eu envie d’être sincère sur scène, de ne pas plaquer quelque chose de juste préparé, mais de ressentir les émotions et de les transmettre. Simplement, on ne les transmet pas de la même manière quand on a plus d’expérience. Avec les années, on apprend à se faire confiance, à faire confiance au « rien ». Quand on est jeune, on a tendance à vouloir prouver qu’on est capable d’interpréter, on a souvent envie de se cacher derrière un mouvement, une expression et, parfois, on en fait un peu trop. Mais le « rien », c’est très dur parce que cela implique de s’assumer et de s’accepter totalement.
Comment travaillez-vous le personnage ? Avez-vous besoin de vous projeter ? Certaines ballerines parlent, par exemple, de la scène de la folie comme d’un moment qu’elles ont vécu, une sorte de déclenchement personnel.
Ça dépend, mais pour Giselle, je trouve que le déroulé du rôle se fait assez naturellement. Il n’y a pas besoin de se forcer à entrer tout de suite dans une émotion. Il faut simplement être un peu plus réservée, plus timide et naïve que je ne le suis dans la vie, c’est un petit travail d’ajustement au début. Mais ensuite, tout s’enchaîne assez facilement. Par exemple, quand les chasseurs entrent et qu’elle voit son amoureux saluer Bathilde, cette situation suffit à déclencher quelque chose. La musique à ce moment-là est magnifique, ce qui aide énormément. Concernant la scène de la folie, à part quelques éléments techniques – certaines inclinaisons de tête, des positions du corps – que je dois penser car elles ne sont pas naturelles pour moi, tout le reste vient de manière assez instinctive. Je me glisse dans la peau du personnage et je ne pense plus du tout à moi : c’est Giselle, je vois ce qu’elle voit, je ressens ces sentiments.
Au-delà de Giselle, que réserve encore cette saison ?
O zlozony / O Composite de Trisha Brown, en décembre. Je l’avais dansée il y a 21 ans, en 2004, lors de la creation. J’étais dans la deuxième distribution et on n’a pas vraiment travaillé avec Trisha. Et puis, j’étais jeune, je n’avais pas encore la maturité nécessaire pour réellement comprendre sa pièce. Ensuite, normalement, ce sera Le Parc que je danserai peut-être avec Guillaume Diop. Après il y a La Dame aux camélias, mais on n’a pas toujours les distributions de la part de John Neumeier. Donc, si ce n’est pas La Dame, ce sera Roméo et Juliette
À l’Opéra, vers 40 ans, on a tendance à arrêter le répertoire classique. Mais pas vous : la saison dernière, vous avez fait la prise de rôle dans La Belle au bois dormant, cette saison, vous prévoyez de redanser Juliette. Qu’est-ce qui vous motive ?
J’essaie de me forcer à me maintenir en forme : plus je fais des ballets disons « difficiles », plus Manon et la Dame aux Camélias, si je la danse, vont me paraitre simples. C’est un peu comme miser sur quelque chose de dur maintenant, pour mieux en profiter après. Si on ne le fait pas sous prétexte qu’on est « trop vieille », on galère même sur les ballets simples. Et c’est dommage, parce qu’on ne profite de rien.
Est-ce que 42 ans, c’est l’âge juste pour partir ?
Je pense, mais c’est très personnel. Il y a des gens pour qui ça va très bien, d’autres qui ont de gros problèmes physiques et qui sont obligés d’arrêter même avant. Se pose aussi la question de l’envie : l’envie de continuer à travailler, à se remettre en question, à se pousser en cours, etc. Donc c’est propre à chacun. Certains pourraient danser jusqu’à 45 ans, voire plus. Personnellement je trouve que 45, c’est vraiment la limite, surtout à l’Opéra de Paris. On a un répertoire tellement varié, et il y a aussi beaucoup de ballets très exigeants physiquement. On ne peut pas occuper un poste si c’est pour ne danser que trois ballets dans la saison. Ce n’est pas possible. D’ailleurs c’est ce qui m’est arrivé l’année dernière : il y avait plein de choses que je n’ai pas pu faire.
Après, évidemment, il y a l’aspect artistique, les petits rôles, ou même une bascule vers le contemporain. Mais maintenant, le contemporain est devenu tellement spécialisé. Ceux qui en font se consacrent presque exclusivement à ça, ils passent d’un chorégraphe à un autre. Ce qui fait qu’il n’y a plus tellement d’opportunités pour ceux qui n’ont pas été formés à ce langage dès le début de leur carrière, surtout passé un certain âge.
C’est un peu votre cas, car votre parcours est très classique.
Oui, mais avec Brigitte Lefèvre (directrice de la danse de l’Opéra de Paris de 1995 à 2014 – MS), j’étais aussi très contemporaine. À son époque, je faisais vraiment les deux. Elle me faisait danser aussi bien du classique que du contemporain.
Ça dépend vraiment de la direction ? Ce n’est pas une question de volonté personnelle ?
Ça dépend beaucoup de la direction, mais c’est aussi, à un moment donné, une volonté.
Au départ, avec Brigitte, je faisais les deux. Quand Benjamin Millepied est arrivé – même s’il n’est pas resté très longtemps – je continuais encore à toucher aux deux styles. Puis Aurélie est arrivée (Aurélie Dupont, directrice de la danse de l’Opéra de Paris de 2016 à 2022), et elle a dit clairement que je n’étais pas du tout contemporaine. Donc, à partir de là, je n’en ai plus du tout fait, je suis restée uniquement sur du classique.
Aujourd’hui, c’est un choix. Même si, Trisha Brown ce n’est pas vraiment du contemporain dans le sens physique du terme. A 42 ans, on ne peut plus enchaîner les deux. C’est trop difficile de retrouver la forme nécessaire pour le classique après avoir dansé un contemporain exigeant. Par exemple, après Mats Ek, revenir au classique, c’est très dur. On prend le risque de se blesser. Disons qu’il y a eu une période où j’ai un peu “subi” la situation avec Aurélie, puis c’est devenu un choix pleinement assumé. Quand il y a un ballet classique face à un ballet contemporain, je choisis toujours le classique, parce que ce que j’aime avant tout, c’est raconter des histoires. Dans le contemporain, à part les œuvres de Mats Ek, il est assez rare de trouver un véritable récit, une vraie narration.
Pina Bausch, non?
Brigitte avait essayé de me mettre sur du Pina. J’avais dansé Orphée et Eurydice dans le corps de ballet, mais ça n’avait pas vraiment « matché » avec les répétitrices de Pina.
Qu’est-ce qui n’a pas « matché » ? Comment vous l’avez senti ?
Avec Pina Bausch, ce qui est bien, c’est qu’il existe un vrai groupe de fidèles. En général, ceux qui ont dansé ses pièces continuent à les interpréter. Ça a ses limites, quand des éléments extérieurs arrivent : j’ai senti que je n’étais pas vraiment intégrée, que j’étais un peu mise à l’écart. C’était légèrement déprimant. Après, si j’avais été exceptionnelle, même en étant nouvelle, ils m’auraient prise. Donc je pense qu’il y avait une part des deux. Je ne sais pas, peut-être que tout simplement je ne faisais pas partie de leur canon de danseuses. C’est un mélange de choses, et puis j’étais encore jeune, peut-être que je n’avais pas vraiment compris le but.
Donc, le fameux “effet Pina” – je quitte tout pour elle – n’a pas vraiment marché sur vous ? Vous êtes restée fidèle au classique.
On peut faire les deux, c’est un peu dur ce que je vais dire : se diriger vers le contemporain c’est un choix facile, parce que c’est quand même beaucoup moins exigeant que la danse classique. Je ne dis pas que ça use moins le corps, je pense qu’en termes d’usure physique, c’est à peu près la même chose. Mais en termes de stress et de mise en danger, le classique est bien plus difficile.
Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’en classique, des centaines de danseuses sont déjà passées par ces rôles, donc il y a une attente du public, le cahier des charges est strict. Alors que dans le contemporain, c’est la pièce qui est mise en valeur, on va voir davantage une œuvre qu’un rôle de soliste. Il y a moins de pression, moins de risques de vraiment “rater”
C’est facile de se laisser glisser dans le contemporain, parce que c’est un peu moins exigeant. Autrement dit, si on fait uniquement du contemporain, on n’est pas obligé de prendre tous ces cours classiques tous les jours, on peut se préparer autrement, se chauffer différemment. C’est une autre manière de travailler.
Est-il plus difficile de commencer sa carrière ou de la finir ?
De la commencer, je pense, parce qu’on ne sait pas jusqu’où on va aller. Quand on la finit on sait ce que l’on a fait. Il y a un sentiment d’accomplissement malgré tout. Et puis ça ne s’arrête qu’à l’Opéra.
Qu’est-ce que vous allez faire après ?
Je sais ce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas prendre un poste fixe, j’ai envie d’être en freelance pour pouvoir accepter des projets différents. Par exemple, cet été je tournais dans le film le Fantôme de l’Opéra d’Alexandre Castillogni, qui va sortir en septembre 2026. J’ai le rôle de Victoire, et c’est une expérience que j’ai beaucoup aimée. D’octobre 2026, à 2027 je vais danser à l’extérieur, j’ai pas mal choses prévues. J’ai envie de me laisser très libre pour accepter des projets qui me plaisent. Pourquoi pas l’enseignement, donner des cours, remonter des rôles, coacher les gens, ça me plaira bien, mais pas un poste fixe ni à l’Opéra, ni ailleurs. Je veux être libre, parce que je ne l’étais pas depuis trente ans.
Giselle,Jean Coralli, Jules Perrot,Palais Garnier, jusqu’au 31 octobre 2025
Visuel : ©James Bort