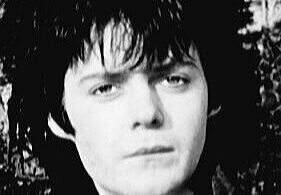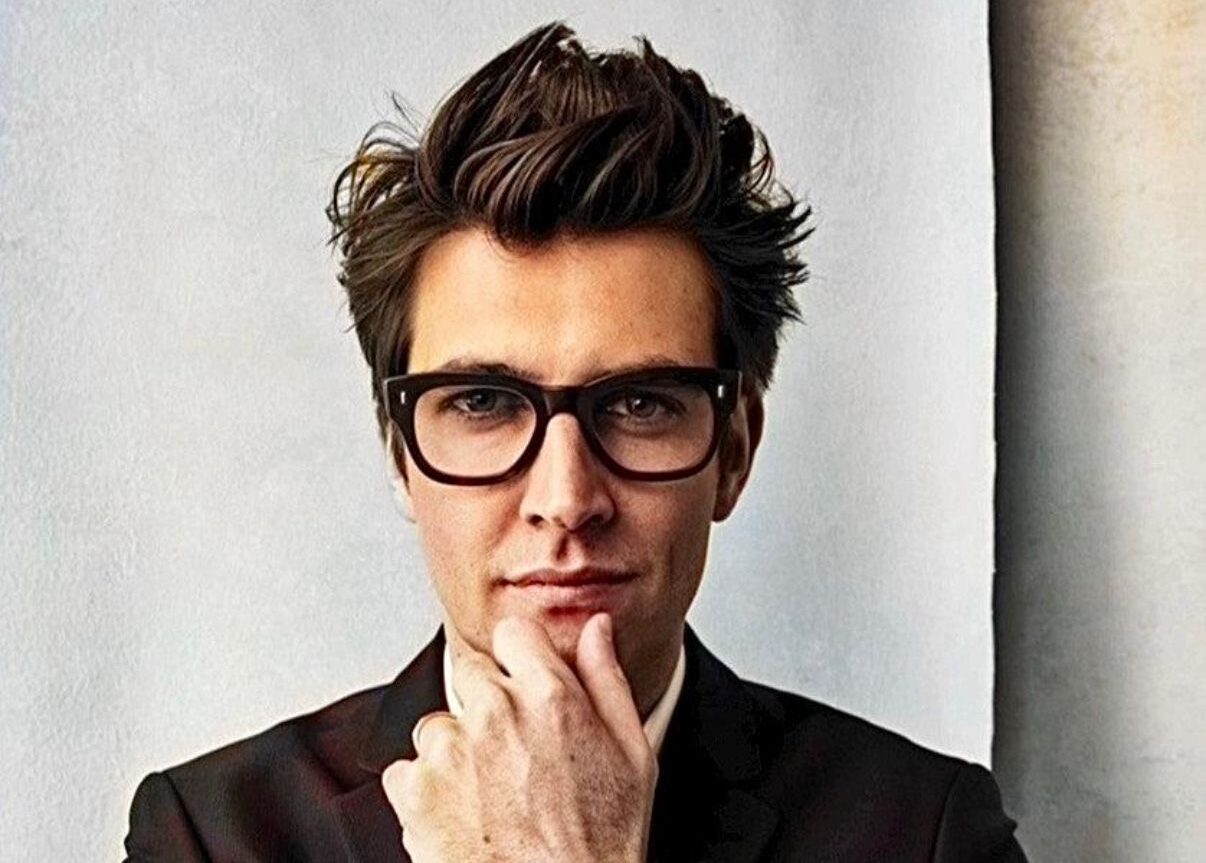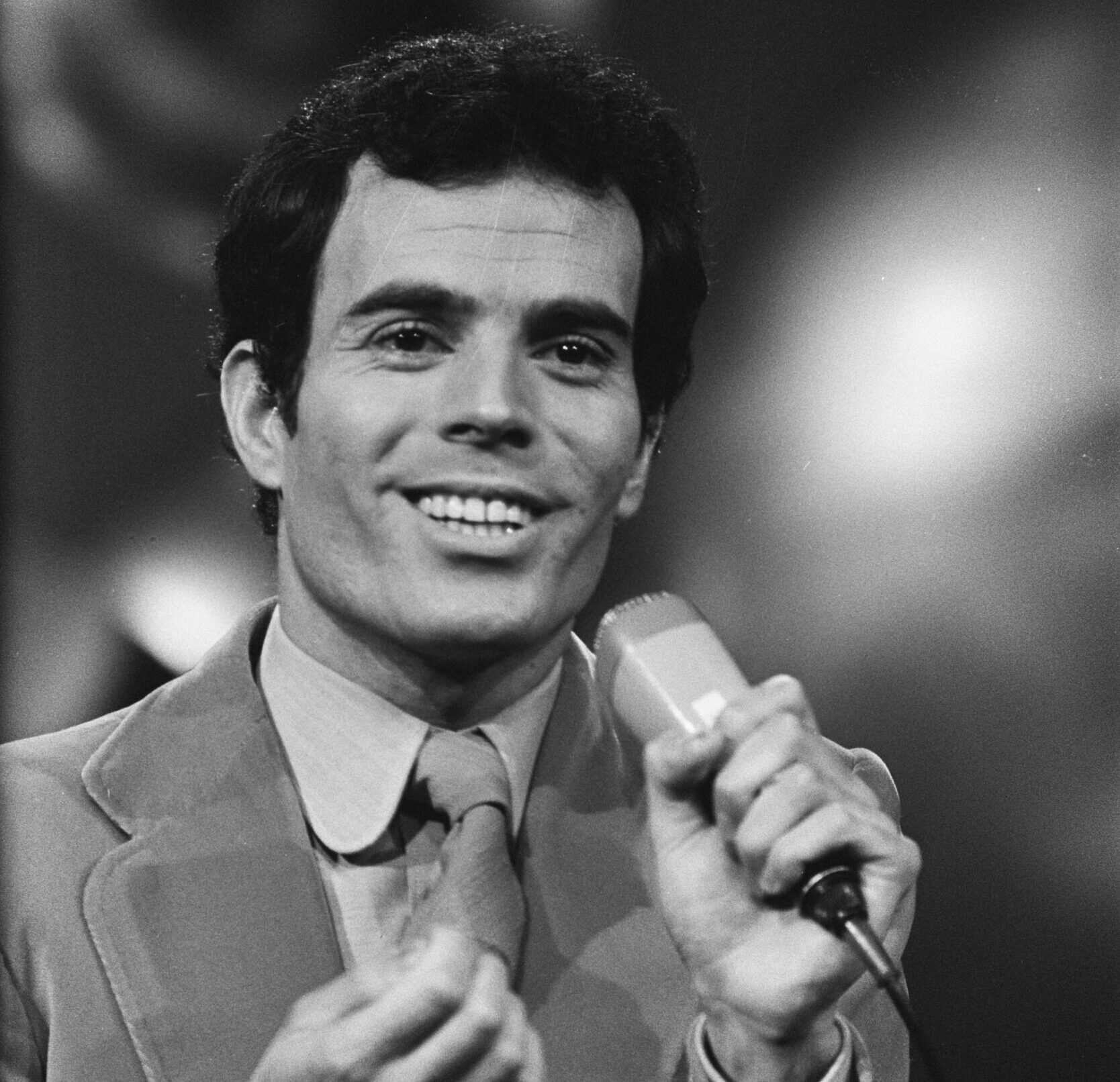« de dIAboli » rencontre avec Christine Armanger « Et si le nouveau visage du diable au XXIe siècle était l’IA ? »
par Amélie Blaustein-Niddam16.07.2025

Dans le cadre du festival d’Avignon nous avons rencontré Christine Armanger. Elle nous présente le processus de sa pièce de dIAboli, où dans une scénographie innovante elle nous offre une nouvelle façon de représenter et de penser le diable.
Vous êtes actuellement à Avignon, où vous avez présenté, les 7 et 8 juillet, de dIAboli, une étape de travail au Grenier à Sel. Ma première question est la suivante : dans quel cadre cela s’inscrivait-il ? Que se passait-il exactement dans ce lieu, le Grenier à Sel ?
Il s’agissait de deux journées organisées dans le cadre des Rencontres SVSN, pour Spectacle Vivant, Scènes Numériques. Ces journées sont portées conjointement par le Grenier à Sel et Dark Euphoria. Elles réunissent artistes et professionnels autour de conférences, de présentations, de rencontres et de formats « showcase ». C’est un espace propice aux échanges, très identifié dans le milieu, notamment pour celles et ceux qui s’intéressent aux croisements entre les arts vivants et le numérique, dans ses formes les plus variées.
Je suis votre travail depuis un certain temps, et il me semble que c’est la première fois que vous explorez véritablement le champ de l’art numérique.
Pas tout à fait. Dans mon parcours, j’ai déjà abordé des questions liées au numérique, mais jamais de cette manière, aussi affirmée. C’est en effet une première dans ce registre.
Avant d’aborder le fond du sujet, parlons un instant de la distribution de ce spectacle.
La pièce repose sur la présence de trois danseuses qui se livrent à un sabbat chorégraphique dont la montée en intensité physique va fonctionner comme une incantation. Va ensuite apparaître dans un second temps une nouvelle incarnation du diable sous la forme… d’un chien robot. Celui-ci entrera alors en interaction avec les spectateurs. Le trio se transforme donc en quatuor, avant de redevenir un solo.
Pourquoi avoir choisi un chien robot ?
Parce que la pièce s’intéresse à la figure du diable, qui traverse les époques avec une capacité remarquable de métamorphose. Le diable reflète, dans chaque société et à chaque époque, les angoisses et les peurs de son temps. Le diable du Moyen Âge n’est pas celui de la Renaissance, ni celui du XIXe ou du XXIe siècle. C’est une figure polymorphe, capable d’adopter toutes les apparences et de prendre tous les visages, les plus innocents, les plus inattendus, pour venir tromper son monde.
Or l’un des partis-pris de la pièce consiste à interroger l’intelligence artificielle (IA), notamment d’un point de vue éthique, comme endroit d’une possible réinvention du diabolique. Le chien robot est pour partie piloté par IA, et d’autres IA seront mises à contribution. Surtout, en plus du bouc canonique qui inspire les costumes des danseuses, le chien est une autre incarnation privilégiée du diable — pour l’anecdote Luther en avait une sainte horreur. J’ai écrit un monologue que ce chien robot va interpréter, de manière la plus crédible possible. En travaillant avec la reconnaissance faciale des spectateurs, le chien robot va révéler ses potentiels diaboliques.
Votre travail s’inscrit dans un intérêt plus large pour le sacré.
Oui, je m’intéresse énormément au sacré, aux rituels et aux iconographies, notamment religieuses. Mes créations débutent par de longues recherches en histoire de l’art, avec un rapport très fort à la peinture – mais aussi à la sculpture. L’art chrétien occidental est une grande source d’inspiration dans mon travail, mais je m’intéresse aussi à des artistes plus contemporains.
Le diable serait-il une sorte d’incarnation inaccessible du sacré ? Une figure que vous n’aviez pas encore explorée ?
Effectivement. J’ai d’abord travaillé sur les figures de saints et de martyres (Edmonde et autres saint·es), puis sur la vanité (MMDCD), ensuite sur l’Apocalypse (Je vois, venant de la mer, une bête monte). Le diable s’est imposé naturellement à la suite de ce parcours. Dans ma précédente pièce, j’avais une scène où je nommais les différentes appellations du diable – Satan, Béhémoth, Lucifer, etc. Je me suis interrogée : pourquoi cette profusion de noms ? S’agit-il de différentes incarnations ? Cette question a ouvert un champ de recherches passionnant, à la croisée de l’histoire, de la philosophie, de la théologie et de l’histoire de l’art. Pour simplifier, le diable, c’est une personnification du mal. Or en tant qu’êtres humains, nous sommes en lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Le diable peut être envisagé de deux façons : est-ce un être extérieur, comme on le pensait au Moyen Âge, qui vient nous pousser aux mauvaises actions – à l’image enfantine de Milou dans Tintin, tiraillé entre un ange et un démon ? Ou est-ce une entité intérieure, constitutive de notre humanité même, et avec laquelle nous devons sans cesse négocier ? Les sciences humaines ont déplacé le débat théologique. La psychanalyse, par exemple, associe parfois le diable à l’inconscient. J’aime beaucoup cette citation de Karl Kraus : « Le diable est optimiste s’il pense pouvoir rendre les hommes pires qu’ils ne sont. »
Il y a chez vous ce goût du lien entre l’actuel et l’inactuel?
C’est fondamental. J’aime partir de figures ou de récits que l’on considère désuets et qui pourtant nous constituent, pour en révéler la résonance contemporaine. Pour l’Apocalypse, par exemple, j’avais été frappée par la fréquence de ce mot dans le langage populaire. On parle sans cesse d’apocalypse – mais de quoi parle-t-on vraiment ? En revenant au texte de Saint Jean, on découvre que l’Apocalypse signifie, dans son étymologie grecque, « dévoilement », et non « fin du monde ».
Dans mes pièces, je travaille à la collision et à la friction des images et des imaginaires, j’aime user des grands écarts de tons et de styles. Mes dramaturgies sont constituées d’un maillage de sens et de signes qui donnent une direction tout en permettant au spectateur une réception ouverte, j’y suis très attachée.
Concernant le diable, il a une activité confondante ces derniers temps, c’est le moins qu’on puisse dire. Ce qui m’intéresse c’est qu’au cours des siècles, le diable s’est déplacé : de fait religieux il est petit à petit devenu fait culturel. Aujourd’hui le diable est partout : dans les séries, la pop culture, l’humour, la publicité… Il a traversé les siècles en changeant de visage. Un excellent ouvrage, Une histoire du diable de Robert Muchembled, retrace cette évolution, de la terreur médiévale à l’esthétique fantastique, puis au registre humoristique.
Au Moyen-Âge, on avait vraiment peur d’être damnés, il y avait vraiment quelque chose de très inquiétant, et puis au XIXe siècle c’était plus fantastique déjà, puis au XXe le diable s’est déplacé vers l’humour et la publicité.
Alors que je commençais à travailler sur le sujet au printemps 2023, il y a eu toute une levée de boucliers de la communauté scientifique autour de l’IA. Des appels à cesser de la développer, à faire connaître les risques qu’elle représentait. Des figures diverses dont Elon Musk (pas encore trumpisé puis détrumpisé), utilisaient une rhétorique démoniaque – je pense à son tweet : “With AI, we are summoning the demons.” Des ingénieurs de Google démissionnaient… Et soudain, dans mon esprit d’artiste, tout s’est connecté. L’IA posait de véritables enjeux éthiques, et j’ai vu là un espace de réinvention possible du diabolique.
Et si le nouveau visage du diable au XXIe siècle était l’IA ?
Vous êtes une artiste très visuelle. La peinture, les tableaux vivants…
Absolument. Je suis une obsédée rétinienne, j’ai une vraie volonté de produire des images. Il y a une dimension profondément plastique dans mon travail chorégraphique. Avec de dIAboli, j’aimais aussi l’idée de sortir du format du solo – que j’ai beaucoup pratiqué – pour travailler en trio. C’est très stimulant pour la construction des images, cela permet de travailler des compositions corporelles plus riches, plus complexes.
La figure du diable, vous l’avez donc abordée à partir de ses représentations médiévales ?
Oui. J’ai puisé dans l’iconographie médiévale : le diable assimilé au bouc, qu’on retrouve fréquemment représenté sur les manuscrits enluminés du XIIIe au XVe siècle, dont je suis totalement fan. J’ai découvert les « diableries », scènes de danse démoniaque qui précédaient les Mystères religieux. Un jour, ce serait fou de pouvoir monter un Mystère médiéval…
Dans la pièce, du diable canonique représenté sous forme de bouc, j’ai choisi une stylisation en ne conservant que certains éléments. Les danseuses portent des sabots qui les transforment en créatures hybrides, comme des faunes, ni tout à fait humaines ni complètement animales. Cela faisait aussi écho aux figures de Pan, aux fêtes dionysiaques, et, dans un registre plus contemporain, au cosplay.
J’ai imaginé ce projet comme une sorte de sabbat pour le temps présent, avec une pointe d’humour. Il s’agissait de créer un rituel chorégraphique, sans tomber dans les clichés de la « sorcière féministe ». Je voulais aussi éviter l’écueil du feminism washing. J’avais d’abord imaginé une distribution plus androgyne, mais pour diverses raisons, ce sont trois femmes qui portent le projet aujourd’hui.
Le public est disposé en cercle, pour renforcer la dimension rituelle et permettre un contact direct avec ces êtres diaboliques. Je voulais créer un magma de corps, une forme d’enchevêtrement, de chimères, de créatures tordues – c’est vraiment ma signature chorégraphique, de travailler autour des corps tordus, fragmentés, dont l’unité est questionnée.
La première image dans cette étape de travail est très marquante : une respiration presque magique, comme si les corps et la lumière ne faisaient plus qu’un. Est-ce un effet recherché ?
Oui, cette sensation de magma vivant était intentionnelle. Je pensais à la Pangée – ce moment où tous les continents ne formaient qu’un seul bloc. Il s’agissait de créer un agglomérat grouillant, un être pluriel, où l’on ne distingue plus à qui appartient tel bras ou telle tête. J’aime beaucoup ces figures-là, proches de la célèbre sculpture Die Puppe de Hans Bellmer, où l’indistinction et le bizarre stimule l’imaginaire.
Chorégraphiquement, je travaille une évolution qui passe par un processus de séparation, puis de naissance, une montée en puissance rituelle. La danse est en grande partie écrite – notamment tout ce qui est au sol. Les séquences debout sont construites à partir de matériaux que l’on peut adapter.
Pour SVSN, c’était la première fois que nous testions la disposition du public en cercle. Chorégraphiquement c’est très intéressant, car cela permet des orientations et des adresses multiples. On peut voir une scène de dos, pendant que quelqu’un d’autre en découvre le visage. Ce jeu de perspectives, l’intégration des spectateurs à la séquence, cela me semblait fondamental dans une proposition qui touche au rituel.
Et où pourra-t-on voir cette création dans sa forme finale ?
La pièce sera créée dans le cadre du festival Faits d’hiver à l’Atelier de Paris, les 5 et 6 février 2026.
de dIAboli se jouera dans le cadre des Faits d’hiver à l’Atelier de Paris
© Photos de recherche réalisées lors de la première résidence laboratoire au CCN de Caen en août 2024.