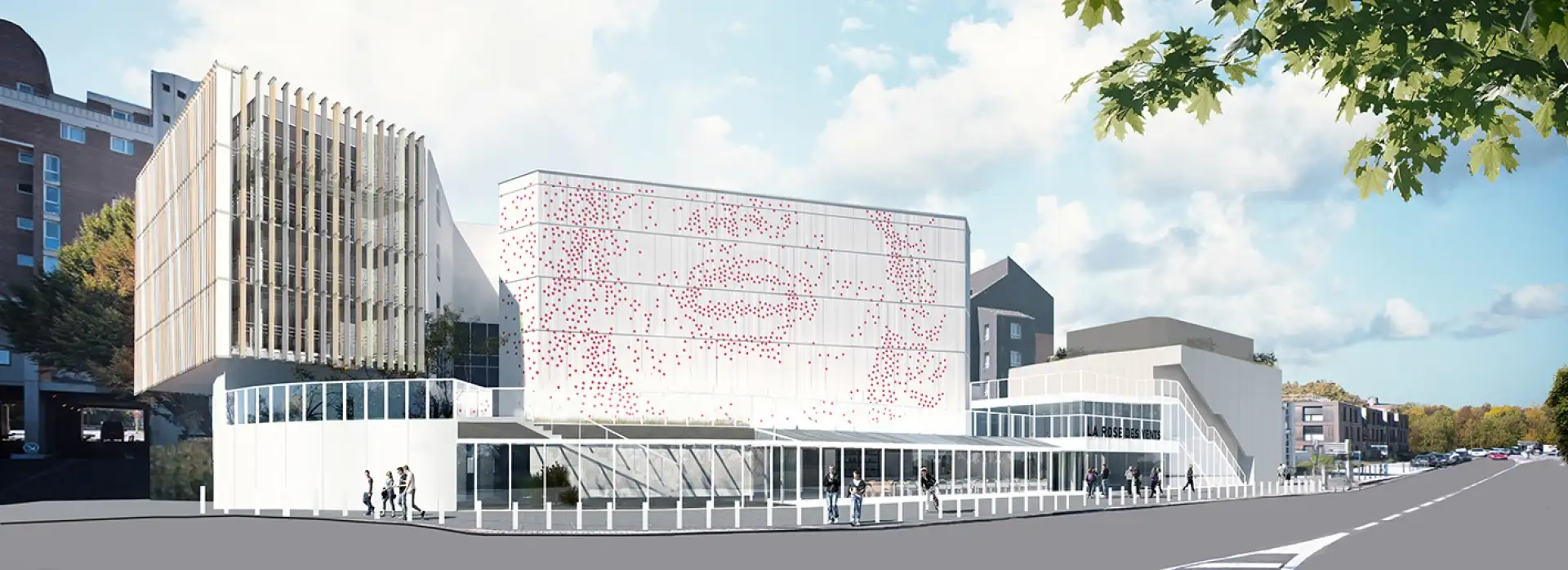Comment la danse s’empare-t-elle de l’intelligence artificielle ?
par Amélie Blaustein-Niddam21.10.2025

À l’Atelier de Paris, deux créations en cours interrogent la rencontre entre danse et intelligence artificielle : This Is Unreal de Liz Santoro et Pierre Godard, et de dIAboli de Christine Armanger. L’IA sort de la fascination pour se transformer en une matière à penser. Ces artistes explorent ce que peut devenir la danse lorsqu’un double machinique surgit à ses côtés. Effrayant ? Fascinant ?
This Is Unreal : danser avec un simulacre
Docteur en informatique théorique, Pierre Godard a consacré sa thèse à la théorie de l’information et à la modélisation des systèmes complexes. Ce bagage irrigue depuis plus de dix ans le travail qu’il mène avec la chorégraphe Liz Santoro, à la croisée du langage, des algorithmes et du mouvement. Avec This Is Unreal, il et elle assument pour la première fois frontalement la confrontation avec l’IA, en l’inscrivant au cœur du plateau.
Le parcours de Liz Santoro et Pierre Godard témoigne depuis dix ans d’une recherche où le geste se conjugue avec les systèmes et les langages. Dès For Claude Shannon (2016), leur pièce pour trois danseuses et un danseur, le mouvement devient expression codifiée, réglée au cordeau, explorant les interactions entre corps et théorie de l’information. Avec Noisy Channel (2018), il et elle élargissent le spectre en mêlant leur écriture aux sons de Greg Beller, cherchant à faire résonner les mots, le son et le corps dans une même expérience sensorielle. Dans Maps (2020), les projections de mots au mur et les déplacements circulaires des danseurs et danseuses prolongent cette investigation, où la danse aléatoire dialogue avec les flux linguistiques et sonores, montrant combien chaque geste est à la fois imprévisible et structuré, vivant et codé.
This is unreal, la prochaine pièce donc, naît d’un protocole simple et vertigineux : générer un double numérique de Liz Santoro grâce à la motion capture. Ce clone se meut, reproduit, déforme, contorsionne des fragments de sa danse. Mais ce qui frappe, c’est ce qui manque. « Un corps sans organes » pour citer une nouvelle fois Deleuze. « Certains mouvements évoquent mes cours de danse moderne d’il y a vingt ans, d’autres n’ont aucun sens. Mais il n’y a pas d’air, pas de résistance, pas d’oxygène. Et surtout, il n’y a pas d’empathie », dit Liz Santoro.
Le corps généré est un corps sans souffle, sans mémoire du sentir. La danse devient ainsi une épreuve d’altérité radicale : non plus partager l’espace avec un autre humain, mais avec une figure qui vous ressemble et qui pourtant ignore le poids, la fatigue, le désir.
Pierre Godard mobilise Deleuze pour penser cette expérience. Dans Logique du sens, le philosophe décrit le simulacre comme force qui « subvertit le vrai et le faux ». Ni copie ni modèle, mais prolifération qui déstabilise la perception. C’est exactement ce que cherche This Is Unreal : créer une zone d’incertitude où le spectateur se demande, à chaque instant, ce qui est vivant et ce qui est fabriqué.
Cette incertitude ne se limite pas au geste. Pierre raconte avoir cloné la voix de Liz : « Sa propre fille croyait que c’était elle. » Ou encore avoir généré de la musique sur Chopin et Schubert : « À l’oreille, indiscernable. Conceptuellement vertigineux, mais scéniquement un non-événement. » L’illusion parfaite ne fait pas spectacle. Ce qui compte, ce sont les fissures, les glitchs, les déraillements qui ouvrent un espace critique.
« L’illusion purement réussie n’apporte rien. C’est dans la faille que naît la pensée. »
Ainsi, la création se construit comme un équilibre fragile : trop de démonstration, et l’œuvre se réduit à une conférence ; trop de silence, et elle devient un simple numéro d’illusionnisme. Le chantier, encore ouvert, cherche à inventer un langage qui maintienne l’incertitude comme moteur poétique.

de dIAboli : convoquer le diable
Tout le travail de Christine Armanger réside dans un corps performatif. En 2013, Christine Armanger questionnait le désir, en 2020, elle s’attaquait enceinte de neuf mois à la mort de son père, en 2023 elle regarde en face la fin du monde. Cette fois, le corps est très augmenté. Elle nous le dit : « j’ai le goût à la jouissance des grands écarts ». Dans une précédente interview en juillet dernier, elle nous rappelait :« dans mon parcours, j’ai déjà abordé des questions liées au numérique, mais jamais de cette manière, aussi affirmée. C’est en effet une première dans ce registre.»
Christine Armanger, elle, aborde l’IA à partir d’une image de cauchemar : « J’ai vu une photo d’un chien-robot armé d’un fusil. J’ai eu peur. J’y ai vu le diable. » De là est né de dIAboli, titre qui convoque l’étymologie grecque : diabolos, « qui désunit, qui disperse ».
Sur scène, Christine Armanger imagine un rituel où se rencontrent figures médiévales et technologies futuristes, possession démoniaque et programmation algorithmique. Un chien-robot, doté d’une voix générée, entre en scène comme partenaire de danse.
Elle résume son projet dont nous avons pu voir une étape de travail très prometteuse lors du dernier festival d’Avignon. Elle nous expliquait alors : «La pièce repose sur la présence de trois danseuses qui se livrent à un sabbat chorégraphique dont la montée en intensité physique va fonctionner comme une incantation. Va ensuite apparaître dans un second temps une nouvelle incarnation du diable sous la forme… d’un chien robot. Celui-ci entrera alors en interaction avec les spectateurs. Le trio se transforme donc en quatuor, avant de redevenir un solo.»
Trois mois plus tard, jointe par téléphone, elle ajoute « On sait bien qu’il est faux. Mais sa voix ressemble à celle d’un acteur. Le simulacre est là. Le chien contrefait un désir d’humanité ».
Chez elle, l’iconographie religieuse peut être kitsch, violente, mais elle n’est jamais décorative, elle sert à penser la fracture ouverte par l’IA. Le diable, dans la tradition chrétienne, n’est jamais une simple créature : il est une puissance de désunion, une force qui fissure la perception, qui rend douteux ce qui semblait stable. C’est exactement ce que produit l’intelligence artificielle dans nos vies, et désormais sur scène : elle brouille notre confiance dans le visible et l’audible.
Christine Armanger convoque aussi le bouddhisme comme contrepoint. Là où la théologie chrétienne redoute le simulacre comme tromperie, la pensée bouddhiste insiste sur l’impermanence des formes et la vacuité des apparences. « L’IA, dit-elle, c’est aussi une manière de voir l’illusion, d’expérimenter la fragilité de ce qui nous semble réel. ».
Son geste artistique consiste à détourner la machine de sa logique utilitaire : « Un robot est un maillage de coordonnées très précis. Ce qui m’intéresse, c’est de l’amener vers la grâce, la lenteur, la virtuosité. » Ce qui est conçu pour la rapidité militaire se métamorphose en danseur accompli. Le diable devient danseur, le chien armé devient figure de grâce.
Christine Armanger envisage déjà d’étendre cette recherche : « J’ai commencé à écrire des films de danse avec l’IA, pour explorer des impossibles du spectacle vivant. » Mais elle souligne aussi l’instabilité de ces technologies : « Tout est obsolète en six mois. Les mains générées ont parfois sept doigts. » L’étrangeté de l’IA réside aussi là : elle promet le réalisme et produit souvent le monstrueux.
L’IA comme fracture poétique
Chez LizSantoro et Pierre Godard comme chez Christine Armanger, les pièces sont encore en cours de création. Mais elles partagent une intuition commune : l’IA ne doit pas être lissée, domestiquée, rendue invisible. Elle doit être montrée là où elle inquiète, là où elle se fissure.
La danse, art du souffle et de l’empathie, ne peut rivaliser avec la perfection machinique. Mais elle peut montrer ce que la machine ne sait pas faire : éprouver, respirer, partager. D’où l’importance de maintenir le trouble, d’installer une zone de doute.
Deleuze écrivait : « La répétition ne change rien dans l’objet répété, mais elle change quelque chose dans l’esprit qui la contemple. » De même, l’IA ne modifie pas seulement la danse, elle modifie notre perception du vivant. Elle oblige à regarder autrement, à douter de ce que l’on croit voir.
« Il y a urgence, conclut Pierre Godard, à ce que des artistes, des gens qui connaissent le corps, pèsent sur ce que sera notre vie demain. » Christine Armanger souligne « jusqu’où avons-nous encore le droit d’aller tour de faux pour de vrai, dans le contexte de la convention du théâtre ? Quand ce hiatus s’attaque à l’information, c’est terrifiant, mais pour le spectacle, je trouve cela fascinant »
This Is Unreal : 18 et 19 novembre : à l’Atelier de Paris et 28 et 29 novembre : à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette. Visuel : ©Jérôme Fouber
de dIAboli : 5 et 6 février : à l’Atelier de Paris l’Atelier de Paris avec le festival Faits d’hiver, dans le cadre du Paris Réseau Danse
20 et 21 mai : à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, en coréalisation avec la Scène de recherche dans le cadre de Danses en territoires. Visuel :©Alban van Wassenhove