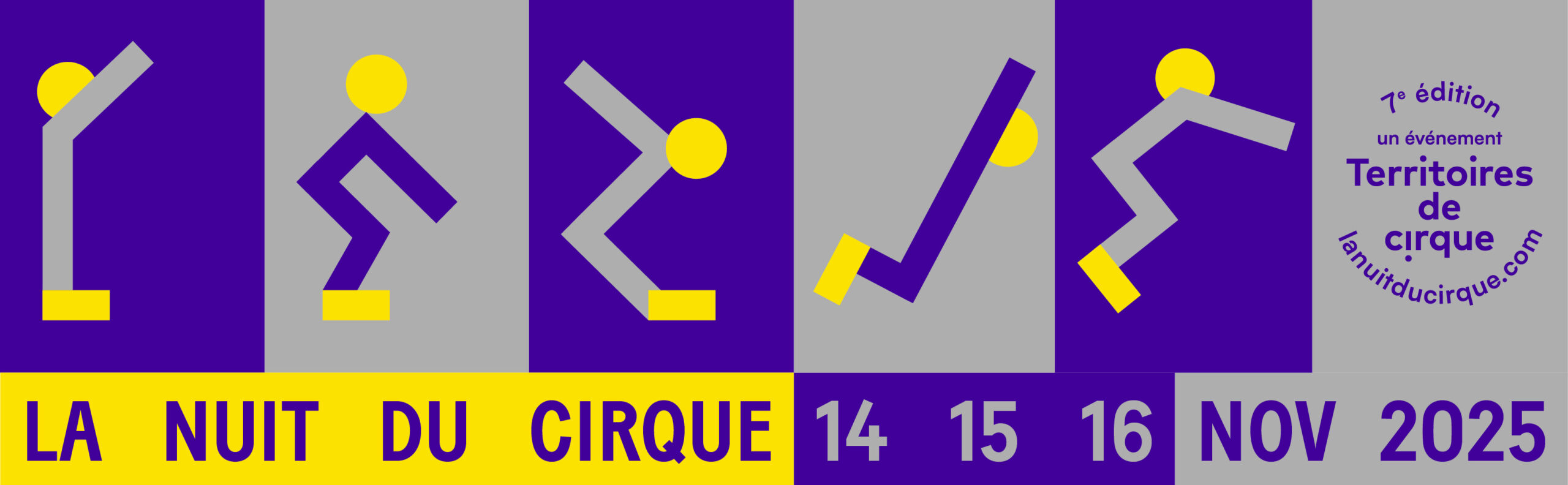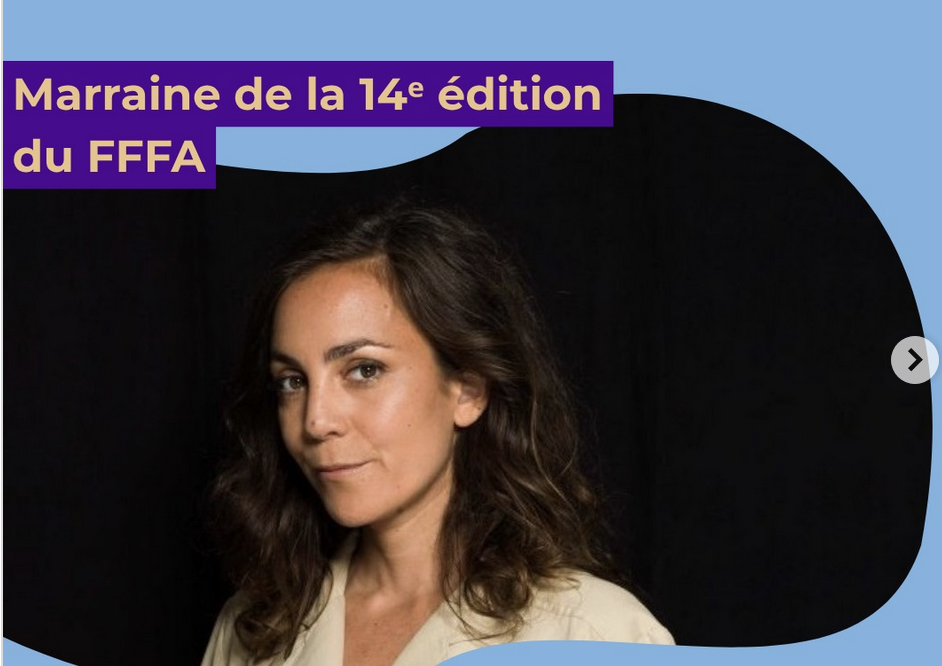Big 2025 : l’audace culturelle s’invite au cœur de l’économie
par La redaction24.09.2025

Hier à Accor Arena, le Big de Bpifrance a fait résonner les industries culturelles et créatives comme un véritable moteur d’avenir. Dans cet événement foisonnant et vrombissant,entrepreneur·e·s, artistes et décideur·euse·s culturels·les étaient présent·e·s dans tous les espaces d’intervention pour esquisser ensemble les nouveaux horizons du secteur au prisme de l’innovation, du numérique, de l’écologie et de l’audace créative. Les nombreux débats, retours d’expérience et annonces ont montré à quel point ces industries s’imposent aujourd’hui comme un pilier stratégique de la dynamique économique française. Cult y était, on vous raconte !
Par Luna Baudouin-Goujon, Amélie Blaustein Niddam, David Hanau, Yaël Hirsch et Lou Valette
La vérité
Une foule compacte entre dans l’immense salle du salon Big, grand salon des entrepreneur·e·s en France à l’Accor Arena à Paris. Cette année, le plus grand rassemblement business d’Europe est placé sous le signe de la vérité, « celle de la science, des faits bruts, de la statistique, de l’expérimentation, celle du laboratoire », affirme Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France (banque publique d’investissement), organisateur de l’événement. Alors que de grandes figures de la culture, comme le rappeur Youssoupha, le youtubeur Innoxtag ou l’influenceur Lou Trotignon, ont toute leur place sur l’impressionnante grande scène, la culture et son devenir étaient au cœur de cette 11ᵉ édition de BIG, qui posait par cent voix la question de la « Vérité ».

Bulle French Touch : une première rencontre pour s’immerger
À la Bulle French Touch, où se déroulent des mini-conférences de 30 minutes, la journée commence à 10h avec un débat sur « Comment l’immersion collective réinvente l’expérience culturelle ? », après une présentation rapide et efficace de la French Touch par son directeur Nicolas Parpex, qui rappelle que c’est 5 % de l’économie et 2 millions d’emplois. Maïté Labat, consultante en audiovisuel et innovation, questionne Sophie Chrétien-Kimmel, la fondatrice de Sonorium, une entreprise d’immersion dans des écoutes d’albums, et Delphine De Canecaude, la directrice de Chargeurs Museum Studio, entreprise d’ingénierie culturelle datant de 2018, qui réalise 95 % de son activité à l’international et est présente dans 15 pays. Cette dernière propose des expériences immersives, notamment dans des musées, par exemple prochainement à Chaplin’s World en Suisse, et a pris la majorité des parts du Grand Palais Immersif, que Delphine De Canecaude préside. Devant une foule de curieux·ses, elles ont détaillé leur volonté de créer, via l’immersif, « un rapport nouveau à une œuvre ». Dans ce marché qui n’est « pas structuré », rappelle Delphine De Canecaude, l’enjeu est de se rapprocher de la vérité, thème de cette journée, par « un artefact » qui va donner un sens à l’expérience. Le but : attirer les « 70 % d’adultes qui ne vont pas au musée aujourd’hui ».

Un écho aux enjeux de l’IA dans les industries créatives
À l’écart du tumulte de l’Arena, les salles Echo offraient un temps de respiration propice à l’analyse. La matinée s’est ouverte avec une table ronde percutante sur l’impact de l’intelligence artificielle dans les industries créatives : « Du crayon au prompt ».
Pour Elisha Karmitz, CEO de MK2, l’IA promet de transformer en profondeur l’industrie du cinéma. Encore en phase exploratoire, le groupe préfère aujourd’hui multiplier les initiatives de sensibilisation, comme le Artefact AI Film Festival, et engager un dialogue direct avec les réalisateur·rice·s. Virginie Mosser, narrative director chez Ubisoft, a partagé pour sa part l’enthousiasme de ses premières expérimentations, allant jusqu’à dialoguer avec ses propres personnages : une jubilation qu’elle associe à l’importance d’une approche pédagogique et expérimentale.
Patrick Sigwalt, compositeur et président du conseil d’administration de la SACEM, a rappelé que l’IA est déjà un levier opérationnel majeur, grâce au développement d’outils maison de traçabilité et de transparence dans l’utilisation des œuvres. Michel Reilhac, artiste et fondateur du festival Venice Immersive à la Mostra de Venise, a comparé cette révolution à l’arrivée du numérique dans les caméras : un bouleversement qui suscite autant d’inquiétudes que de promesses, mais qui finira, selon lui, par être pleinement intégré aux pratiques artistiques. En attendant, il souligne la puissance de prototypage immédiat offerte par ces outils capables d’ouvrir de nouveaux terrains de jeu aux cinéastes traditionnel·le·s.
Toutes et tous ont insisté sur la nécessité de vigilance face à des technologies dominées par quelques géants américains et chinois, rappelant les enjeux éthiques et juridiques qu’elles soulèvent. Mais le débat a surtout mis en avant le rôle irremplaçable des artistes. « Si l’IA est prédictive, les artistes, eux, iront toujours là où on ne les attend pas », a résumé Patrick Sigwalt. Michel Reilhac a enfin esquissé une perspective stimulante : celle des contre-cultures non technologiques que ne manqueront pas de susciter ces outils devenus “majoritaires”.
L’écologie sur les plateaux de cinéma à 12h à la French Touch
A priori, environnement et cinéma ne font pas bon ménage. Le sujet de cette nouvelle conférence, animée par Myriam Kittar, chargée des programmes accélérateurs à la BPI France, est pourtant primordial aujourd’hui. Charles Gachet-Dieuzeide, cofondateur de Flying Secoya, cabinet de conseil spécialisé dans les pratiques écologiques sur les plateaux, et Agnès Toullieux, secrétaire adjointe du CNC, soulignent l’intérêt grandissant des productions cinématographiques pour cet enjeu. La responsable se réjouit de la mise en place d’un Observatoire de la transition qui collecte les données à partir de bilans carbone. De plus, « 138 expert·e·s planchent sur 28 actions pour continuer à accompagner nos filières », ajoute-t-elle. Si la mise en place d’une certification RSE (responsabilité sociale des entreprises) lancée en septembre peut paraître coûteuse, Charles Gachet-Dieuzeide tempère : « C’est davantage un retour sur investissement accompagné d’une prime qui engage les productions. Depuis le lancement en septembre, j’ai vu un gros changement. »

Les passionné·e·s du monde de l’art s’appuient sur des IA
Dans la bulle dédiée à la French Touch, pas le temps de déjeuner ! Arnaud Oliveux, commissaire-priseur chez Artcurial, et Vanessa Clairet Stern, directrice communication chez Perrotin, débattent avec Marion Carrée d’Ask Mona : quand l’algorithme mène aux œuvres, que deviennent nos métiers ?
L’IA compile les données de ventes, aide à la mise à prix et participe à l’authentification. Pour le commissaire-priseur, « l’idée n’est pas de remplacer notre travail, mais de l’améliorer ». Car derrière chaque algorithme, il faut un œil expert, cette intuition qui fait reconnaître la pépite.
Chez Perrotin, 450 personnes par jour viennent voir une œuvre de leurs yeux. L’expérience reste « difficilement remplaçable ». On peut accélérer les processus, certes, mais « ce qui compte, c’est l’expérience culturelle qualitative ». « Tout démarre par un bon prompt » – une bonne intention humaine. « Sur la fin, ce qui compte, c’est le partage humain ».
Cette réalité contredit les esprits chagrins. L’engouement persiste chez les jeunes générations. Mais attention à l’effet « pharaon » : l’IA joue un double jeu redoutable. Elle génère des faux d’une qualité inédite, difficiles à discerner. Mais elle devient aussi l’arme absolue pour débusquer ces contrefaçons, offrant aux expert·e·s des outils d’analyse jamais égalés.
À Versailles, les statues nous parlent
À 14h, nous avons envie de voyager, loin, très loin même, puisque Murmuration nous emmène dans l’espace, en fait, dans ce que l’espace peut apporter à nos comportements. Vinci Concessions, en partenariat avec la start-up Murmuration, utilise l’intelligence artificielle et l’imagerie satellite pour surveiller et gérer la végétation sur les terrains de ses 73 aéroports mondiaux. Cet outil, qui utilise la vision par ordinateur, cartographie et classe finement les sols, mesurant la végétation, les installations photovoltaïques, les parkings, etc. Le but est d’optimiser la gestion des actifs, de suivre les actions de régénération de la biodiversité et d’évaluer le potentiel de séquestration du carbone.
Cette solution, issue d’une collaboration avec France Tourisme Tech, offre une vue globale sans nécessiter d’intervention humaine sur place. Elle permet d’anticiper les impacts du changement climatique et de prendre des décisions éclairées pour une mobilité plus durable. Le projet démontre comment une technologie initialement développée pour un usage (suivi des coureurs de l’UTMB) peut être transposée à un autre secteur pour répondre à des enjeux environnementaux et de gestion de flux.
Mais comme la France est souvent une bonne idée, nous nous amusons à entendre comment le Palais de Versailles a su prendre le pouls de l’époque. Marion Carré, cofondatrice d’ASK Mona, et Paul Chaine, en charge du développement numérique au Château de Versailles, racontent comment l’IA est utilisée de façon vertueuse dans une collaboration avec le Bot Ask Mona. Concrètement, « On peut parler à 20 statues qui nous répondent », nous confie Paul Chaine. L’objectif est de répondre à la curiosité de chacun·e, qu’il s’agisse de questions sur l’artiste, l’époque, les figures mythologiques représentées, ou des questions plus insolites.
Le projet vise à rendre la culture plus accessible en permettant aux visiteur·euse·s de poser des questions qu’ils n’oseraient pas poser à un guide humain, favorisant ainsi la connaissance culturelle. Les réponses de l’IA, validées par les expert·e·s du château, puisent dans une base de connaissances fiable. Le dispositif est un succès, avec plus de 1 000 questions par jour, montrant qu’il complète, et ne remplace pas, les autres outils de médiation comme les audioguides. Ce succès s’explique aussi par un bon timing avec l’engouement du grand public pour l’IA, qui peut ici être testée de manière concrète et ludique. Le château étudie également les données des conversations pour mieux comprendre les intérêts de ses publics. Il nous confie vouloir aller plus loin à l’occasion « d’un hackathon qui se tiendra les 29 et 30 septembre avec des professionnel·le·s qui vont travailler à un outil de préparation de visite grâce à l’intelligence artificielle ».
Financer l’innovation dans les industries culturelles
Au cœur de l’après-midi, Bpifrance est intervenu dans la bulle French Touch pour rappeler son rôle dans le programme France 2030, ce plan d’investissement de 54 milliards d’euros lancé par l’État pour soutenir les grandes transitions écologiques, technologiques et industrielles. Comme l’a rappelé Fabrice Casabaig, conseiller Culture du Secrétariat Général pour l’Investissement, plus d’un Md d’euros y sont consacrés aux enjeux culturels. Près d’une centaine de projets culturels et créatifs ont déjà été retenus partout en France. L’enjeu : placer l’innovation au service de la culture, qu’il s’agisse de technologies numériques pour les artistes, d’outils immersifs pour les publics ou de nouveaux formats audiovisuels et interactifs. Au cœur des appels à projets actuellement en cours, l’intelligence artificielle et les expériences immersives s’imposent comme leviers stratégiques, avec des initiatives allant de la capture de mouvements en 3D à la visite virtuelle de musées. Ces projets, souvent ambitieux et coûteux, bénéficient d’un accompagnement spécifique pour structurer durablement la filière. Les intervenant·e·s ont encouragé les participant·e·s à candidater, même avec des dossiers imparfaits, afin de stimuler une dynamique d’expérimentation et d’accélérer la transition numérique des industries culturelles.

L’intelligence artificielle, nouvelle frontière du jeu vidéo
Lors d’un débat animé par Vanessa Kaplan, trois ingénieur·e·s intervenant·e·s — Romain De Wauber, Côme Demarigny et Max von Knorring — ont partagé leur vision de l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur l’industrie du jeu vidéo. Leurs échanges ont mis en lumière les promesses technologiques, les défis créatifs et les questions éthiques que soulève cette révolution.
Pour les studios, l’IA constitue avant tout un levier considérable de productivité et un gain de temps précieux. Là où la création d’un jeu pouvait s’étendre sur plusieurs années, les outils intelligents permettent désormais de tester des centaines de variantes en un temps record. Les tâches répétitives et complexes sont automatisées, libérant ainsi les équipes pour se consacrer pleinement à la dimension créative du jeu. Cette transformation ouvre également de nouvelles perspectives d’accessibilité et l’accès à des marchés encore inexplorés.
Pourtant, les ingénieur·e·s intervenant·e·s rappellent que les défis restent immenses. Dans le domaine des jeux de stratégie, par exemple, la complexité du design, les coûts et les délais explosent. L’IA apparaît alors comme une solution stratégique pour réduire ces contraintes, optimiser les processus et recentrer l’effort sur la création.
Du côté des joueur·euse·s, l’IA promet des expériences inédites : chats interactifs intégrés aux jeux, dialogues et situations de négociation avec des personnages, mécaniques centrales animées par l’intelligence artificielle. Ces innovations transforment le gameplay, offrant des expériences impossibles auparavant. L’IA ouvre ainsi un champ d’expérimentation nouveau, où immersion et interaction se réinventent.
Mais toutes et tous insistent sur la nécessité d’une réflexion éthique. Il ne s’agit pas seulement de se demander si l’on doit travailler avec l’IA, mais comment. Les ingénieur·e·s intervenant·e·s soulignent que les équipes doivent décider ce qui mérite d’être automatisé et ce qui doit rester une création humaine. Un jeu entièrement généré par IA perdrait sa dimension sociale : l’essence même du jeu vidéo réside dans le partage et l’expérience collective. L’IA doit rester un outil, permettant de délester les équipes des tâches répétitives, tout en laissant place à la créativité artistique.
En se projetant dans dix ans, les intervenant·e·s dessinent un horizon ambitieux : un univers vidéoludique plus diversifié, plus accessible, profondément social, et intégrant pleinement la réalité virtuelle. L’IA permettra de créer des expériences inédites, faisant du jeu vidéo bien plus qu’un produit : une plateforme d’expérimentation, un espace social et un lieu d’émotions partagé·e·s.
Sous l’animation de Vanessa Kaplan, ce débat a révélé une conviction forte : l’intelligence artificielle ne se contente pas de transformer le jeu vidéo, elle en redéfinit la nature même, en associant innovation technologique et création humaine.
Transition écologique et musique : un projet futuriste ?
Lors d’une discussion autour des enjeux environnementaux, Matthias Leullier, directeur général adjoint de Live Nation, Malika Séguineau, directrice générale d’Ékhoscènes, et Octave Delaye, consultant climat chez Ekodev, ont présenté le projet Matrice. Ce programme ambitieux vise à inscrire la transition écologique au cœur du spectacle vivant.
Ékhoscènes se positionne comme un espace de coopération, réunissant acteurs et partenaires pour expérimenter de nouvelles pratiques. Dans un secteur très concurrentiel, il joue un rôle de lieu neutre pour construire collectivement des solutions concrètes.
Soutenu par le CNC sur 36 mois, le projet Matrice entend intégrer l’écoconception dès la conception des tournées. Du choix des salles à la technique, chaque décision sera évaluée selon son impact environnemental. Le projet fonctionne comme un étalon de mesure mobile, collectant et modélisant des données pour guider toute structure, grande ou petite. Six partenaires, dont Bleu Citron, Live Nation et Spectacle, participent à cette initiative.
Pour Matthias Leullier, la transition écologique est un défi majeur pour Live Nation, qui produit et représente des centaines d’artistes. Le spectacle vivant est un écosystème complexe, impliquant artistes, publics et prestataires. Malika Séguineau rappelle que l’adhésion des producteurs est essentielle : il s’agit de tester des modèles pour garantir des tournées durables. Un comité des parties prenantes a été créé pour fédérer l’écosystème autour de ce projet.
Octave Delaye insiste sur l’importance d’indicateurs variés pour mesurer et réduire l’impact environnemental, tout en garantissant la pertinence de la démarche pour tous les acteurs. La phase 2 prévoit l’écoconception de quatre tournées tests, confrontant les idées à la réalité du terrain et impliquant tout l’écosystème musical.
Parmi les leviers identifiés : réduire les déplacements en diminuant le nombre de dates et en restant plus longtemps dans chaque ville. Mais les obstacles sont nombreux : volonté des artistes, habitudes de production, contraintes économiques.
L’objectif reste clair : permettre à la filière de continuer à produire des tournées, tout en réduisant leur empreinte écologique. Le projet Matrice se veut une démarche transformatrice, capable de réinventer le spectacle vivant dans le respect des enjeux climatiques.
Matthias Leullier nous a partagé un moment cult de sa carrière: « L’un des moments qui m’a marqué le plus ces dernières années c’est la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. J’étais responsable des shows, ce qu’on a appelé les Top Artistes, les shows des artistes de musique, à savoir Lady Gaga, Ayana Kamara, Céline Dion. Être dans ma ville, dans des lieux aussi exceptionnels, et pouvoir produire ces concerts devant des milliards de téléspectateurs, ça a été quelque chose d’émotionnellement très fort.»
De l’effervescence à l’action
Quand la rumeur de l’Accor Arena s’estompe et que nos pas quittent le parterre du Big, il nous reste l’impression d’avoir traversé un territoire en effervescence, où la culture dialogue avec l’innovation, l’écologie et l’économie, un laboratoire vivant où se dessinent de nouvelles alliances entre artistes, entrepreneur·euse·s et institutions. De cette journée, nous repartons encore plus convaincu·e·s de la force motrice essentielle de la création pour redéfinir nos manières de produire, de rêver et de vivre ensemble.
Visuels : ©YH

Égalité et hospitalité, Moving in November bouscule l’idée de représentation à Helsinki
par Amélie Blaustein-Niddam09.11.2025

Drag Race France All Stars à l’Accor Arena : la fête et le combat
par Melodie Braka08.11.2025